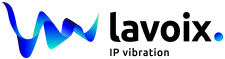Des approches et des conclusions différentes dans l’affaire Advanced Cell Diagnostics vs. Molecular Instruments
1.1 Advanced Cell Diagnostics (ACD) a assigné Molecular Instruments (MI) pour contrefaçon d’un de ses brevets européens aussi bien devant la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB – Chambre Locale de La Haye) que devant la Haute Cour de Justice (High Court of Justice of England and Wales – EWHC). Devant les mêmes faits, les deux juridictions ont rendu des jugements divergents.
JUB : https://www.unifiedpatentcourt.org/en/node/159761
EWHC : https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/pat/2024/898
Ci-après, différents aspects de ces deux jugements seront comparés.
1.2 Le brevet à la base de l’action en contrefaçon, EP1910572B1 (« EP572 »), est relatif à un procédé de détection d’une ou de plusieurs cibles d’acides nucléiques au sein d’une cellule individuelle (Détection d’ARN in situ) ; le procédé ayant une efficacité de détection améliorée.
L’invention repose sur le principe d’interposer entre une cible d’acides nucléiques à détecter et une sonde de marquage au moins deux sondes de capture et ceci « in situ ».
1.3 La JUB et la EWHC se sont exprimées sur la validité de la revendication 1 en présence du même état de la technique : Collins et al, « A branched DNA signal amplification assay for quantification of nucleic acid targets below 100 molecules/ml » (dans ce qui suit « Collins ») et Kern et al, « An enhanced-sensitivity branched-DNA assay for quantification of human immunodeficiency virus type 1 RNA in plasma. » (dans ce qui suit « Kern »).
1.4 L’état de la technique le plus proche, Collins divulgue un mode de réalisation d’une méthode de détection « in vitro » utilisant une (seule) sonde de capture. Dans un autre mode de réalisation, présenté comme théorique, Collins divulgue l’aspect « in situ » et une pluralité de sondes de capture (« Label extender » en forme de croix) et ceci en combinaison avec d’autres caractéristiques.
1.5 Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques d’une version simplifiée de la revendication 1 en cause et la structure de caractéristiques retenue par la JUB et par la EWHC. Le tableau indique les caractéristiques ayant été considérées comme anticipées par l’état de la technique le plus proche « Collins » :
| Claim 1 | JUB – EWHC | Anticipation par « Collins » / JUB | Anticipation par « Collins »/ EWHC |
| A method of detecting one or more nucleic acid targets within an individual cell, the method comprising: | 1(a) – A | Non (in vitro et non pas in situ – point 54 du jugement) | Oui (in situ – point 358 du jugement) |
| providing a sample comprising the cell, which cell comprises […] one or more nucleic acid targets; | 1(b) – B | Non | Oui (in situ) |
| fixing and permeabilizing the cell; | 1(c) – C | Non | Non (point 359 du jugement)[mais : implicite – point 360 du jugement] |
| for each nucleic acid target, providing | 1(d) – D | Oui | Oui |
| (i) one or more label probes, wherein each label probe comprises one or more labels, […] | 1(d)(i)-
D (i) |
Oui | Oui |
| for each nucleic acid target, providing two or more different capture probes, | 1(e) – E | Non (uniquement un (seul) “Label Extender/Capture Probe” par cible acide nucléiques) | Oui (cruciform design – point 358 du jugement) |
| wherein each of the two or more capture probes comprises a section T complementary to a section on the nucleic acid target and a section L complementary to a section on the label probe, […], | 1(f) – E(i) | Non (car caractéristique 1(e) n’est pas anticipée) | Oui |
| and the L sections are complementary to nonoverlapping regions of the label probe, […]; | 1(h) –
E(ii) Part 2 |
Non (car caractéristique 1 (c) n’est pas anticipée) | Non (point 359 iii) du jugement) |
| hybridizing, in the cell, the two or more capture probes to a single copy of the nucleic acid target, when present in the cell; | 1(i) – F | Non (car caractéristique 1 (c) n’est pas anticipée) | Oui |
| capturing the label probe to the two or more capture probes, thereby capturing the label probe to the nucleic acid target, | 1(j) – G | Non | Oui |
| by simultaneously hybridizing at least two different capture probes to single copy of the label probe, […] | 1(k) (i) –
G(i) |
Non | Oui |
| detecting a signal from the label. | 1(l) – H | Oui | Oui |
2.1 La JUB applique une approche stricte et considère que la caractéristique « in situ » et la pluralité de sondes de capture ne sont pas divulguées dans le même contexte du mode de réalisation de Collins pris comme point de départ (JUB : points 55./56 du jugement). Les caractéristiques 1(e)/E et 1(f)/E(i) ne sont donc pas anticipées.
La EWHC estime, par contre, que ces caractéristiques sont divulguées par Collins et ne fait donc pas de distinction entre différents modes de réalisation dans un seul document (EWHC : point 358 du jugement).
2.2 Une attaque de défaut de nouveauté par MI était basée sur la combinaison de Collins et Kern en raison d’une référence de Collins à Kern.
La JUB et la EWHC n’ont pas fait droit à cette attaque, étant donné que la référence de Collins à Kern n’était pas suffisamment spécifique. Combiner Collins et Kern afin de créer un état de la technique artificiel a été considéré comme n’étant pas possible (JUB : point 58 du jugement – EWHC : point 364 du jugement).
3.1 Concernant l’activité inventive, les deux cours prennent Collins comme point de départ et, en résumé, considèrent que la différence réside dans l’utilisation « in situ » et dans la pluralité de sondes de capture (« label extender » ou sondes cruciformes) (JUB : point 59 du jugement – EWHC : point 368 du jugement).
3.2 La JUB considère que l’enseignement technique de Collins rendait l’utilisation de sondes cruciformes obsolètes tout en obtenant le même effet technique d’une réduction du rapport signal à bruit (point 59 – phrase entre pages 20 et 21)
C’est pourquoi la personne du métier n’aurait pas de motivation à prévoir une pluralité de sondes de capture par l’utilisation de sondes de capture cruciformes.
3.3 La EWHC considère que la question principale est de savoir si, partant de Collins, la personne du métier aurait eu un préjugé à utiliser des sondes cruciformes dans un environnement in situ. La EWHC estime que ceci n’est pas le cas, étant donné que la personne du métier s’attendrait à ce que la tâche soit de nature empirique, même s’il fallait s’attendre à rencontrer quelques difficultés pratiques mais surmontables (EWHC : point 369 du jugement).
3.4 En résumé, la JUB considère que la personne du métier ne chercherait pas au-delà de Collins, car l’effet technique est déjà atteint, tandis que la EWHC considère que Collins enseigne que la sensitivité du procédé est bonne, mais qu’il existe une motivation pour l’améliorer encore plus (EWHC : points 370, 375, 376) avec une attente raisonnable de succès (EWHC : point 382).
3.5 La JUB reconnait donc l’activité inventive tandis que la EWHC ne l’admet pas.
4.1 Au-delà de la question de validité, les avis des deux cours diffèrent également sur la question de la reproduction des caractéristiques du produit argué de contrefaçon.
4.2 La caractéristique sujet des divergences est la caractéristique 1(h)/E(ii) : “[…] the L sections [of the capture probes] are complementary to nonoverlapping regions of the label probe […]”.
Le produit argué de contrefaçon comporte des régions de la sonde de marquage où des parties de deux sondes de capture se chevauchent partiellement.
4.3 La JUB interprète la caractéristique 1(h)/E(ii) comme étant limitée à l’absence complète de régions de chevauchement, entre autres car le brevet ne divulgue pas d’exemple montrant un chevauchement partiel, et arrive donc à la conclusion de non-reproduction des caractéristiques (JUB : point 101 du jugement).
4.4 La EWHC interprète cette caractéristique comme englobant des situations de chevauchement partiel, dès lors que l’invention fonctionne et que l’avantage clé de l’invention est obtenu. (EWHC : point 273 du jugement). En conséquence, la EWHC considère les caractéristiques comme littéralement reproduites.
5. On voit que devant les même faits, la JUB et la EWHC rendent des jugements assez divergents en présence des même faits.
Avant de décider devant quelle juridiction une action en contrefaçon est à engager, il convient d’analyser les chances de succès en fonction des approches de la juridiction considérée.
Si l’on généralise l’enseignement du présent cas, en présence d’un état de la technique assez pertinent, il est préférable de porter le litige devant la JUB et en présence d’un objet argué de contrefaçon qui nécessite une interprétation large des revendications, il est préférable de s’adresser à l’EWHC.