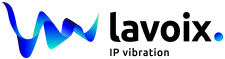La saisie-contrefaçon, une mesure probatoire connue de longue date par le praticien français de la propriété intellectuelle, a été intégrée avec succès au dispositif régissant la Juridiction unifiée du brevet (« JUB »), en vigueur depuis deux ans. Les principaux points à retenir sont présentés ci-dessous.
Le droit français de la propriété intellectuelle bénéficie depuis longtemps d’une mesure exorbitante du droit commun pour établir l’existence et la matérialité des actes de contrefaçon allégués : la saisie-contrefaçon.
Cette mesure se retrouve aussi dans les droits belge et italien.
Qualifiée de « reine de la preuve » du fait de son élément de surprise (en France, elle est obtenue par requête ex parte), de son spectre large, et de la difficulté qu’il y a à la remettre en cause (par le biais d’un référé-rétractation, pour obtenir la rétractation de l’ordonnance l’ayant autorisée ; ou par le biais d’une demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en résultant), les praticiens français étaient satisfaits de la voir intégrée aux règles applicables à la JUB depuis le 1er juin 2023.
Pour mémoire, la JUB regroupe, à ce jour, 18 Etats Membres de l’Union européenne, dont la France. Elle propose un cadre uniforme, spécialisé et efficace pour les litiges en matière de brevets au niveau européen, en connaissant des actions en contrefaçon et en nullité. La Juridiction dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens dit « classiques » et ceux ayant un effet unitaire (brevets unitaires)[1].
Si la terminologie change (il ne s’agit plus de demander à être autorisé à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, mais de présenter une demande de conservation des preuves et/ou de descente sur les lieux), son objectif probatoire reste le même : obtenir « des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguées » (article 60 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée, ou « AJUB »), avec un champ territorial beaucoup plus vaste qu’auparavant.
Cette demande, utilisée de manière efficace dans plusieurs procédures ces deux dernières années, peut être faite avant l’introduction d’une action au fond, ou en cours de procédure.
Conditions d’obtention de cette ordonnance
Cette ordonnance de conservation des preuves doit en principe être requise inter partes, l’ex parte étant l’exception devant la JUB.
Pour obtenir une ordonnance ex parte, le requérant doit le demander et en justifier, « notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve » (article 60(5) AJUB et règle 197(1) des règles de procédure ou « RoP »). La Cour décide de manière discrétionnaire sur ce point, et peut notamment prendre en compte un critère d’urgence. La Cour d’appel a récemment jugé acceptable un délai de deux mois entre le moment où le requérant a été informé des faits de contrefaçon, et le moment où la demande de conservation des preuves a été faite[2].
Pour décider si l’ordonnance peut être rendue ex parte, la Juridiction n’a pas pour autant besoin d’apprécier la validité du brevet, ce sujet étant de la compétence du juge statuant au fond, ou sur une demande de mesures provisoires, sauf lorsque la présomption de validité peut clairement être remise en cause[3].
En pratique, la Juridiction semblent avoir adopté une approche pratique et flexible de cette condition.
Le requérant doit aussi présenter « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait, ou qu’une contrefaçon est imminente » (article 60(1) AJUB). La Juridiction veille au respect de cette condition, et regardera en détail les preuves apportées par le requérant.
De manière classique, le requérant a un devoir de loyauté dans la présentation des faits, que ce soit pour établir la vraisemblance de la contrefaçon ou pour justifier de sa demande ex parte.
Enfin, le requérant peut devoir fournir une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses exposés ou susceptibles de l’être par le défendeur, et pour la réparation de tout dommage dont il pourrait être responsable. Une telle garantie peut notamment être demandée lorsque l’ordonnance est rendue ex parte.
Exécution et utilisation des résultats des mesures de saisie
Le requérant peut notamment demander une saisie descriptive, avec ou sans prélèvement d’échantillons ; une saisie réelle des produits argués de contrefaçon, des matériels et instruments utilisés pour la production ou la distribution de ces produits, « ou tout document s’y rapportant » ; la conservation et la divulgation de médias et données numériques (article 60(2) AJUB et R.196(1) RoP).
Des mesures de confidentialité peuvent être demandées, pour assurer la protection des informations confidentielles saisies.
Au niveau de la JUB, la personne chargée d’exécuter les mesures « est un professionnel ou un expert dont l’expertise, l’indépendance et l’impartialité sont garanties » (R.196(5) RoP). Si le droit national l’autorise, cette personne peut être un commissaire de justice, ou assisté d’un commissaire de justice.
Cette personne devra rendre un rapport écrit à la Juridiction, conformément au droit national applicable du lieu où les mesures sont exécutées, dans un délai fixé par la Juridiction.
Enfin, le résultat des mesures de saisie ne peut être en principe utilisé que dans le cadre de la procédure au fond. Cette précision est importante, dans la mesure où il est fréquent qu’un contentieux brevet soit multi-juridictionnel.
Obligation d’engager une action au fond
L’article 60(8) AJUB prévoit que le requérant doit engager une action au fond dans les 31 jours civils ou 20 jours ouvrables (le délai le plus long étant retenu), sous peine d’abrogation ou de cessation des effets des mesures de conservation de preuves.
Si ces délais paraissent familiers au praticien français, leur point de départ diffère : en droit français, le délai court à compter des opérations de saisie, tandis que devant la JUB, c’est la Juridiction elle-même qui fixe la date de départ dans son ordonnance.
La Cour d’appel a considéré que le point de départ pouvait être la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués au requérant, ou la date à laquelle la Juridiction a rendu une décision définitive refusant au requérant l’accès aux éléments de preuve. Ces points de départs répondent à l’objectif d’une mesure de conservation des preuves, à savoir pouvoir utiliser les résultats qui en découlent dans la procédure au fond[4], tout en restant pragmatique et en ligne avec le l’objectif premier de la JUB : assurer une justice rapide et efficace en matière de brevets.
Anticiper la demande de conservation des preuves par le dépôt d’une protective letter
La JUB étant le résultat d’une construction européenne, l’usage des protective letter (« mémoire préventif »), connues notamment en droit allemand, y a été intégré.
Une protective letter est déposée auprès du greffe de la JUB par une personne estimant « probable qu’une demande de mesures provisoires puisse être prochainement formée à son encontre », où elle indique notamment les faits escomptés, ainsi que toute affirmation de la nullité du brevet, justifiée en faits et en droit (règle 207 RoP). Valable six mois (renouvelable), elle n’est pas publique et sera transmise au juge et au requérant si une demande de mesures provisoires ou de conservation des preuves est faite.
Dans le cas d’une demande de conservation des preuves, le juge évaluera ainsi cette demande à l’aune de la protective letter.
Conclusion
En deux ans d’existence, une quinzaine de décisions ont été rendues par les différentes divisions de la JUB sur ce sujet, notamment par les divisions française, italienne et belge qui avaient déjà une pratique régulière des saisies-contrefaçons. Les juges ont démontré qu’ils savaient réagir de manière rapide et pragmatique, en autorisant de telles mesures dans le cadre de salons et foires professionnels, où la durée d’exposition de l’objet argué de contrefaçon est courte.
[1] https://www.unifiedpatentcourt.org/fr/juridiction/presentation
[2] JUB, Cour d’appel, 15 juillet 2025, UPC_CoA_002/2025
[3] JUB, Cour d’appel, 15 juillet 2025, UPC_CoA_002/2025
[4] JUB, Cour d’appel, 23 juillet 2024, PMA v AWM and Schnell, UPC_CoA_177/2024
Cet article est également paru dans le Magazine Option Droit & Affaires (ODA 737 du 17 septembre 2025).