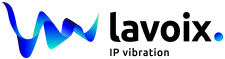Publications, articles de presse, classements, awards et évènements à venir
Artificial intelligence system DABUS
Artificial intelligence system called DABUS cannot be named as inventor according to Decisions J 8/20 and J 9/20 of the Board of Appeal of the EPO
Legal background
Article 81 EPC stipulates that the European patent application shall designate the inventor.
Article 60 defines that the right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title.
Rule 19(1) EPC defines that the request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor.
Present case
An applicant has filed two patent applications in which an artificial intelligence system called DABUS was designated as inventor in the application forms. Corresponding applications have been filed in other jurisdictions.
The applicant argued that the inventions had been created autonomously by DABUS.
The Receiving Section of the EPO refused the two applications, because it concluded that only a human inventor could be an inventor within the meaning of the EPC and consequently a machine did not comply with the above stated requirements of Article 81 and Rule 19(1) EPC. Further, it considered that a machine could not transfer any rights to the applicant and thus the argument claiming that the owner of the machine is the successor in title does not satisfy the requirements of Article 81 EPC in conjunction with Article 60(1) EPC.
In the appeal proceedings the applicant filed as auxiliary request an amended description providing information as to the conception of the invention by the AI (artificial intelligence) system DABUS and an amended designation of inventor form stating that no person is identified as being the inventor with an annex that there is no other appropriate location to indicate that the applicant derives the right to the European Patent by virtue of being the owner and creator of DABUS.
Decisions of the Legal Board of Appeal of the European Patent Office (EPO)
The Legal Board of Appeal confirmed the decision of the Receiving Section of the EPO.
The designation of the inventor is a formal requirement which a patent application must fulfil according to Article 81 EPC. Therefore, the assessment of the formal requirement takes place before and independently from the substantive examination.
The inventor has to be a person with a legal capacity. The Legal Board of Appeal also refused the auxiliary request according to which no person had been identified as inventor but merely a natural person was indicated to have « the right to the European Patent by virtue of being the owner and creator of » the artificial intelligence system DABUS, ruling that a statement indicating the origin of the right to the European patent under Article 81 has to be in conformity with Article 60(1) EPC. Further, it decided that the EPO was competent to assess this.
Thus, under the current provisions the inventor has to be a person with a legal capacity.
Droit de la PI et inventions de non salariés
Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs, ni salariés, ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.
Une ordonnance publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 modifie les règles sur la titularité des droits sur les travaux réalisés par le personnel accueilli par des entités de recherche, publiques ou privées.
L’ordonnance a des conséquences pratiques importantes pour les services de propriété intellectuelle des entreprises. Elle s’intéresse à deux domaines du droit de la propriété intellectuelle : les logiciels et les inventions.
1/ Le contexte légal de l’ordonnance
Jusqu’à présent, les droits sur les logiciels et les inventions n’étaient soumis à un régime particulier que s’ils étaient réalisés par des salariés ou des agents publics (articles L.113-9 et L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle). Cela devait s’entendre de manière stricte. Toute autre personne membre d’une entreprise, mais non salarié (stagiaire, intérimaire, ou autre) était considérée comme un tiers à l’entité l’accueillant[1].
Cela posait des difficultés pratiques pour les entités accueillant des stagiaires ou ayant recours à des intérimaires, ou d’autres membres du personnel ne bénéficiant pas d’un contrat de travail.
L’Ordonnance vise à étendre les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et les brevets à toute personne physique « accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ». Cela peut s’entendre de manière large. Le Rapport au Président de la République fait état des « stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d’une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche. »
[1] Cour de cassation, 25 avril 2006, n°04-19.482, CNRS c. M. Puech
2/ Les droits sur les logiciels
Les droits patrimoniaux d’auteurs sur les logiciels réalisés par ces personnes sont régis par un nouvel article L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que ces droits sont immédiatement dévolus à la structure d’accueil.
Pour s’adapter à la spécificité des contrats de stage, notamment, cette dévolution de droits n’intervient qu’à la condition que la personne physique perçoive une « contrepartie » et soit placée sous l’autorité d’un responsable de la structure d’accueil.
3/ Les droits sur les inventions
Les droits sur les inventions sont régis par un nouvel article L.611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il reprend la classification fixée à l’article L.611-7 du même Code pour les inventions de salariés, entre les inventions de missions, les inventions hors missions attribuables et les inventions hors missions non attribuables, selon des critères identiques.
La personne physique accueillie ne bénéficie pas d’une rémunération supplémentaire, mais d’une « contrepartie financière ».
Le texte prévoit aussi que l’attribution d’une invention hors mission attribuable réalisée par une personne accueillie se fera « pendant la durée de son accueil ». Il conviendra alors pour les entités de recherche de veiller à réagir à temps, si elles souhaitent profiter de cette prérogative.
L’ordonnance renvoie aussi à un décret, qui prévoira les modalités pratiques de déclaration d’invention, comme c’est le cas pour l’article L.611-7 (articles R.611-1 et suivants du Code).
L’ordonnance élargit enfin le recours à la CNIS pour toute invention réalisée par une personne accueillie par une personne morale réalisant de la recherche.
4/ Conséquences
L’ordonnance vise donc à simplifier la gestion des travaux de recherche réalisés dans les entreprises, en étendant les mécanismes de dévolution automatique de droits de propriété intellectuelle à leur profit.
Elle repose néanmoins sur certaines définitions ambigües (en particulier celle de « personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche »), que la jurisprudence pourra venir clarifier à l’avenir.
Si l’objectif du législateur est clair, la mise en place de ce mécanisme pourra poser quelques questions d’ordre pratique. Il faudra veiller, en particulier, à la rédaction des clauses prévues dans les conventions d’accueil et à réagir suffisamment tôt pour l’attribution d’inventions hors mission.
Marques pharmaceutiques et demandes en déchéance auprès de l’INPI (loi Pacte)
I. Appréciation de l’usage au regard des produits
Dans le cadre de notre précédente revue de jurisprudence sur les marques pharmaceutiques nous avions examiné les différences de pratique entre les instances de l’Union Européenne et les tribunaux français pour identifier les produits dont la marque faisait l’objet d’un usage sérieux lors de l’examen d’une demande en déchéance pour non usage.
Il avait ainsi été constaté que l’EUIPO procède à une requalification du libellé de produits en le restreignant aux produits spécifiques qu’il considère comme faisant l’objet d’un usage, alors que les tribunaux français identifient dans le libellé les produits correspondants aux produits dont il est fait usage, sans modifier la portée du libellé.
Il convient donc d’examiner à présent la position qu’adopte l’INPI dans le cadre de la nouvelle procédure en déchéance prévue par les articles L.716-1 et suivants le Code de la Propriété Intellectuelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi Pacte.
La décision CD20-0005 du 3 juin 2021 relative à une demande en déchéance engagée le 2 avril 2020 contre la marque GELOX N°1533727 présente un double intérêt dès lors que :
(i) L’INPI doit se prononcer sur la qualification d’une sous-catégorie de produits pharmaceutiques
(ii) Et que, pour ce faire, il se base sur :
a. les critères dégagés par la jurisprudence de la CJUE récemment rappelé dans les décisions des 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, Ferrari SpA / DU et 16 juillet 2020, C‑714/18 P, ACT / EUIPO) et
b. une appréciation concrète des produits en tenant compte des définitions des produits pharmaceutiques et médicaments résultant de la jurisprudence et du code de la santé publique.
L’INPI décide ainsi que l’usage de la marque pour un médicament prescrit contre les douleurs, brûlures ou aigreurs d’estomac ou de l’œsophage constitue un usage sérieux de la marque pour la sous-catégorie des « médicaments à usage humain » dans la mesure où les médicaments sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des produits pharmaceutiques, qui se distinguent par leur destination humaine ou animale.
L’appréciation de l’INPI diffère donc de celle de l’EUIPO en ce qu’elle identifie une sous-catégorie autonome d’un produit identifié dans le libellé, et qu’elle ne reformule donc pas le libellé.
L’INPI écarte ainsi (i) la requête du demandeur à l’action consistant à réduire le libellé de cette marque aux « produits pharmaceutiques pour combattre les brûlures d’estomac qui seraient selon lui une sous-catégorie autonome des « produits pharmaceutiques », et (ii) l’argument du titulaire selon lequel la marque devrait être reconnue valablement utilisée pour la sous-catégorie des « médicaments à usage humain » au motif que la définition des sous-catégories des « produits pharmaceutiques », devrait être fonction de leur usage humain ou vétérinaire.
L’analyse de l’INPI se fonde sur les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE et rappelle en particulier :
- qu’il faut apprécier de manière concrète si les produits dont il est fait usage constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits couverts par la marque de manière à mettre en relation les premiers avec les seconds, (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46)
- que le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constituée du critère de la finalité et de la destination des produits en cause, (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, point 41 ),
- que, « lorsque les produits visés par une marque revêtent …/…plusieurs finalités, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 47).
Concrètement, l’INPI rappelle que :
- les « produits pharmaceutiques » s’entendent des médicaments et compositions ayant un but thérapeutique, curatif ou préventif (CA Paris, 25 septembre 2020, RG 19/16330),
- selon l’article L5111-1 du Code de la santé publique, « on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonction physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique »,
puis l’INPI considère qu’il ressort
- de la définition des produits pharmaceutique précité que les produits pharmaceutiques ont la même finalité, à savoir traiter les affections de l’organisme, et que prendre en considération isolément chaque indication thérapeutique spécifique pour déterminer une sous-catégorie autonome, pourrait conduite à limiter excessivement les droits du titulaire de la marque,
- et de cette définition ainsi que de la définition des médicaments, que les médicaments sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des produits pharmaceutiques, qui se distinguent par leur destination humaine ou animale,
- des preuves d’usage que la marque est utilisée pour des « médicaments à usage humain ».
Dans une décision précédente, en date du 15 février 2021 (DC20-0015) relative à une demande en déchéance engagée le 29 avril 2020 contre une marque française ODEX N°11/3860413 au nom de SC IOHNSON PROFESSIONNEL SA, l’INPI avait pu identifier les produits d’usage au sein du libellé de la marque attaquée, considérant que l’usage de cette marque pour (i) des mousses lavantes pour les mains et le corps, gels douches corps et cheveux, crèmes lavantes nacrées pour mains et corps, crèmes lavantes d’atelier pour les mains sans solvants et (ii) pour des mousses et lotions lavantes bactéricides pour les mains démontrent un usage sérieux respectivement pour (i) les « préparations pour nettoyer et dégraisser; savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux » et (ii) pour les « produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants » couverts par l’enregistrement de marque, et non pas pour les autres produits dont notamment les produits pharmaceutiques.
II. Appréciation de l’usage au regard des signes
a. Usage du signe sous une forme modifiée
Selon l’article L714-5, 3° du code de la propriété intellectuelle, constitue un usage valable de la marque « L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Dans la décision en date du 15 février 2021 (DC20-0015) relative à une demande en déchéance engagée le 29 avril 2020 contre une marque française verbale ODEX N°11/3860413 au nom de SC JOHNSON PROFESSIONNEL SA, l’INPI a considéré que la marque avec une stylisation et l’ajout d’un élément figuratif telle que représentée ci-dessous ne modifient pas l’impression générale produite par celle-ci et valide donc cet usage.
La position de l’INPI est en phase avec la jurisprudence de l’Union Européenne dès lors que le terme distinctif constitutif de la marque est repris à l’identique et que le graphisme ajouté ne possède qu’un faible pouvoir distinctif et n’est donc pas de nature à modifier l’impression d’ensemble produite par la marque.
b. Usage de la marque en combinaison avec une autre marque
Dans la décision du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à une demande en déchéance déposée le 7 avril 2020 contre une marque ASSAINOL N° 96614247 l’INPI a considéré que l’usage de cette marque avec l’ajout d’un élément figuratif sous la forme complexe ne modifie pas l’impression générale produite par la marque et n’altère donc pas son caractère distinctif.
L’INPI a également considéré que la marque ASSAINOL était bien utilisée à titre de marque et non pas à titre de référence d’un panel de produits vendus sous la marque ombrelle DEO, la marque ASSAINOL ayant vocation à distinguer plus spécifiquement certains produits de la gamme, et que la seule présence du symbole ® du mot « Registered »accompagnant le signe DEO, sans valeur juridique en France, n’est pas de nature à démontrer que les produits sont commercialisés sous la marque DEO et non sous le signe ASSAINOL.
III. Lieu de l’usage
Aux termes de l’article L.714-5, 4°) du Code de la propriété intellectuelle est assimilé à un usage de marque « L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. »
Dans la décision précitée du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à la demande en déchéance contre la marque ASSAINOL N° 96614247 l’INPI considère que les pièces présentées par le titulaire (factures, brochures, bon à tirer daté de 2015 d’une étiquette destinée à être apposée sur les flacons 5L sur laquelle figure la marque ainsi que la mention « Formulé et produit en France ») démontrent que les produits sur lesquels est apposée la marque ont été vendus depuis la France à destination de la Russie.
IV. Point de départ de la période suspecte
Au titre de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée ».
Dans la décision précitée du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à la demande en déchéance déposée le 7 avril 2020 contre lamarque ASSAINOL N° 96614247 , le demandeur en déchéance invoque avoir adressé au titulaire le 3 décembre 2019 une lettre le mettant en demeure de justifier l’usage sérieux de la marque si bien que les pièces produites datées postérieurement à ce courrier ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier l’usage de la marque car relevant de la période suspecte issue de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
L’INPI refuse de retenir cette date et au contraire considère que le point de départ de la période suspecte à prendre en considération est le 7 janvier 2020, soit trois mois avant la demande en déchéance formée le 7 avril 2020, dès lors que l’article précité vise un « délai de trois mois précédant la demande en déchéance ».
Or, comme le titulaire de la marque avait déposé des preuves de l’usage de sa marque pour la période quinquennale précédant la période suspecte, l’INPI aurait dû écarter cet argument.
En outre, si la période quinquennale à prendre en compte doit en effet exclure la période suspecte de trois mois précédant le dépôt de la demande en déchéance, il convient de considérer que le point de départ de la période suspecte est la date à laquelle le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée contrairement au point de vue de l’INPI dans la décision précitée.
V. Date d’effet de la déchéance
L’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle stipule que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu »
Par application de cette disposition, et contrairement aux prétentions des demandeurs réclamant que la déchéance prenne effet à compter de la date de la publication de l’enregistrement de la marque attaquée, l’INPI décide que la déchéance des droits prend effet à compter de la date de la demande en déchéance (décision du 15 mars 2021 (DC20-0009) – marque ASSAINOL N° 96614247).
VI. Répartition des frais
L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
Dans la décision du 28 juillet 2021 (DC 20-0047) relative à une demande en déchéance formée contre la partie française de la marque internationale n°756236 P’tit Chambourcy, l’INPI a déclaré que la demande en déchéance est devenue sans objet suite à l’annulation pour déchéance de la marque dans le cadre d’une procédure parallèle dont le demandeur à l’action (ainsi que l’INPI) ne pouvait pas avoir connaissance
Par conséquent, la demande en déchéance est clôturée pour défaut d’objet et non pour irrecevabilité, et il n’a donc pas été fait droit à la demande en déchéance, si bien qu’aucune des deux parties ne peut être déclarée gagnante et que leursdemandes de répartitions des frais ont été rejetées.
Dans la décision CD20-0005 du 3 juin 2021 – marque GELOX N°1533727 on peut relever que suite à la renonciation partielle de la marque attaquée GELOX le demandeur à l’action en déchéance n’a pas justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond pour ces produits si bien que l’INPI ne s’est pas prononcé sur le remboursement des frais suite à cette renonciation.
Par conséquent, suite à une renonciation partielle, il est recommandé de faire valoir un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond afin de pouvoir obtenir le remboursement des frais.
VII. Délais pour rendre une décision
On relève que l’INPI rend des décisions dans un délai compris entre 5 à 6 mois lorsque le titulaire de la marque attaquée ne dépose pas de preuves d’usage (décisions des 05 juillet 2021 (DC21-0027) et du 19 mars 2021 (DC 20-0097) suite à des demandes en déchéance respectivement du 8 février 2021 et du 30 septembre 2021), et 10 à 15 mois en cas de dépôt de preuves et d’échanges d’arguments entre les parties
Nous recommandons donc de recourir aux demandes en déchéance auprès de l’INPI à l’encontre de marques françaises ou de désignations françaises de marques internationale qui constituent la base d’une réclamation précontentieuse ou si de telles marques ont été révélées dans le cadre d’une recherche d’antériorités.
European Patent Office rated top for patent and service quality
The Intellectual Asset Management (IAM) once again initiated a benchmarking survey and let users vote among the world’s five largest patent offices for the quality of its patents and services. Again, the EPO has topped the survey this year in both categories like it has ever since this annual survey was started by IAM in 2010.
The survey’s results showed that 26 % of the participants rate patents of the EPO as « excellent ». This is in increase from 23% last year and places the EPO well ahead of the other IP5 offices. The respondents also agreed that the EPO is maintaining its high level of quality. Overall, more than 87% of respondents describe the service of the EPO as « good », « very good » or « excellent », also putting the EPO well ahead of the other IP5 offices.
Moreover, the EPO is the only office of the IP5 offices for which patent quality ranks as the top motivation for filing among the respondents. In the other jurisdictions, the commercial importance of the local market is the key factor to file patent application.
This year’s survey was conducted in September and October 2021 among several hundred IP professionals. Participants were asked
about the EPO, Japan Patent Office (JPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), US Patent and Trademark Office (USPTO) and the China National Intellectual Property Administration (CNIPA).