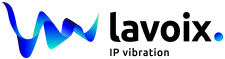Publications, articles de presse, classements, awards et évènements à venir
Cession de droit de PI à titre gratuit : le prix à payer
La cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit doit être qualifiée de donation, et à ce titre se conformer aux exigences propres à la matière. (Décision du TJ de Paris, 8 février 2022, No. 19/14142).
Il était ici question d’une marque et de dessins et modèles communautaires détenus par deux personnes physiques, MM. X et Z . Les droits ont été cédés en 2015 à la société A, dont M. Z est le seul associé et gérant.
Monsieur X a dénoncé, en 2018 la cession intervenue en 2015 et a assigné M. Z et la société A en nullité du contrat de cession.
Le tribunal Judiciaire de Paris a fait droit aux demandes de Monsieur X et a :
- Requalifié le contrat de cession de la marque et des dessins et modèles en donation ;
- Annulé celui-ci au motif du non-respect du formalisme imposé par l’article 931 du code civil.
En ce qui concerne la requalification en donation, celle-ci se justifie par le fait que le contrat conclu en 2015 emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit ».
S’agissant du formalisme à respecter, l’article 931 CC prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
La jurisprudence admet cependant deux dérogation à ce formalisme. La première est le cas des dons manuels qui imposent la remise physique de la chose donnée. La seconde concerne les donations déguisées ou indirectes dont il est admis que les conditions de forme suivent l’acte dont elles empruntent l’apparence.
Le code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune dérogation supplémentaire, mais uniquement que le transfert de propriété doit être constaté par écrit (article L. 714-1, alinéa 4 du CPI dans sa rédaction d’alors)
En l’occurrence, les choses cédées étant des droits incorporels et donc insusceptibles de remise physique, et l’acte de cession mentionnant clairement que le transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit », l’acte attaqué ne pouvait bénéficier d’aucune des deux dérogations.
Le tribunal en conclu, à juste titre, qu’il s’agit donc par définition d’une donation non dissimulée et portant sur des droits incorporels, de sorte qu’elle aurait dû être conclue devant notaire sous peine de nullité. Le contrat de cession est donc déclaré nul.
La cession en cause concernait des donataires « personnes physiques », toutefois une solution identique aurait pu être prononcée, à notre sens, s’il avait été question de donataires « personnes morales ». En effet l’article 902 du CC prévoit que « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables », ce qui n’exclue pas les personnes morales. Une telle appréciation a notamment été confirmée par la Cour de Cassation (C. Cass, com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-15.621).
La prudence est donc de mise dans le cadre de cessions de vos droits de propriété intellectuelle, et notamment en cas de cessions intra-groupe pour lesquelles il peut être tentant de s’affranchir d’une cession à titre onéreux. Les équipes de LAVOIX sont à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans ces démarches.
Données personnelles Janvier-Février 2022
Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période janvier-février 2022.
1. Actualités légales et jurisprudentielles – France
Bilan 2021 de l’action répressive de la CNIL : année record
A l’occasion de la journée européenne de la protection des données du 28 janvier 2022, la CNIL a réalisé un bilan de son action répressive pour 2021.
Le montant cumulé des amendes prononcées en 2021 s’élève à plus de 214 millions d’euros, soit une augmentation de 55% par rapport à 2020.
En 2021, la CNIL a prononcé 18 sanctions, 15 amendes et 135 mises en demeure. La moitié des sanctions concerne un manquement à la sécurité des données personnelles.
Validation par le Conseil d’Etat de la sanction prononcée par la CNIL à l’encontre de Google en matière de cookies
Par une décision du 28 janvier 2022, le Conseil d’Etat a validé la sanction prononcée par la CNIL à l’encontre de Google le 7 décembre 2020 pour plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés (LIL) en matière de cookies.
Les sociétés Google LLC et Google Ireland contestaient la compétence de la CNIL pour prononcer une telle sanction et invoquaient le mécanisme du guichet unique, qui aurait réservé une compétence exclusive de l’Autorité de contrôle irlandaise.
Dans la lignée de sa décision du 4 mars 2021, le Conseil d’Etat précise que le mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD n’est pas applicable en matière de cookies, ceux-ci étant régis par la LIL.
Le Conseil d’Etat confirme les violations de l’article 82 de la LIL prononcées par la CNIL, concernant le dépôt de cookies sans consentement préalable de l’utilisateur, le défaut d’information de l’utilisateur et la défaillance partielle du mécanisme proposé pour refuser les cookies.
Mise en demeure de la CNIL concernant l’utilisation de Google Analytics
La CNIL a été saisie de plaintes par l’association NOYB concernant le transfert vers les Etats‑Unis de données collectées lors de visites de sites web utilisant Google Analytics.
A cette occasion, la CNIL a constaté que Google Analytics implique un transfert de données vers les Etats-Unis en violation des articles 44 et suivants du RGPD, tirant les conséquences de l’arrêt Schrems II de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) ayant invalidé le Privacy Shield.
La CNIL a mis en demeure un gestionnaire de site web de se mettre en conformité avec le RGPD, de ne plus utiliser Google Analytics en l’état, et de recourir si besoin à un outil n’impliquant pas de transfert hors UE.
L’Autorité autrichienne a rendu une décision analogue le 13 janvier 2022.
Précisions de la CNIL concernant la réutilisation par un sous-traitant de données confiées par un responsable de traitement
La CNIL a précisé en janvier 2022 les modalités de réutilisation de données par un sous‑traitant, venant compléter les lignes directrices déjà établies concernant les relations entre responsable de traitement et sous-traitant.
Une réutilisation de données est subordonnée à la réalisation préalable d’un test de compatibilité, destiné à déterminer si ce traitement ultérieur est compatible avec la finalité initiale pour lesquelles les données ont été collectées. L’autorisation ne peut pas être préalable ni générale, et doit être écrite.
Une fois l’autorisation obtenue, le responsable de traitement a l’obligation d’informer les personnes concernées de l’existence de ce traitement ultérieur, et le sous-traitant (devenu responsable de traitement lui-même) est tenu de garantir la conformité du traitement à la réglementation.
Introduction d’une nouvelle procédure simplifiée de sanction CNIL pour les dossiers considérés de faible importance
Un nouveau régime de sanction CNIL a été introduit par la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et sécurité intérieure, insérant notamment un nouvel article 22-1 dans la loi Informatique et Libertés.
Ce texte aménage les pouvoirs du Président de la formation restreinte pour les dossiers considérés de faible importance. Il pourra statuer seul et prendre trois catégories de mesures : enjoindre la production des éléments demandés en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, et prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.
Cette nouvelle procédure répond à l’augmentation du nombre de plaintes reçues par la CNIL.
Le CNnum met en débat de nouveaux droits et obligations
Le Conseil National du Numérique (CNnum) a publié le 13 janvier un dossier proposant des solutions pour remédier aux problèmes créés par l’économie de l’attention, fondement des plateformes numériques via la collecte des données et la publicité personnalisée.
A cette occasion, le CNnum met notamment en débat la création de nouveaux droits pour les internautes et obligations pour les plateformes numériques, tels que la consécration d’un droit d’être informé sur les dispositifs de captation attentionnelle, le renforcement du droit à la déconnexion, et la création d’un droit à l’interopérabilité entre plateformes.
2. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe et international
Projet de règlement sur les données (« Data Act »)
La Commission européenne a publié le 23 février 2022 son projet de règlement sur les données, dit « Data Act », en faveur d’une économie des données équitable et innovante.
Les objectifs du Data Act sont notamment d’assurer l’équité dans l’environnement numérique, stimuler le développement d’un marché des données concurrentiel, ouvrir des perspectives pour l’innovation fondée sur les données et rendre les données plus accessibles à tous.
Lignes directrices du CEPD sur le droit d’accès
Le 18 janvier, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté ses lignes directrices sur le droit d’accès des personnes concernées, faisant l’objet d’une consultation publique de six semaines.
Ces lignes directrices ont vocation à préciser le champ d’application du droit d’accès, les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée, le format de la demande d’accès, les modalités d’accès et la notion de demandes manifestement infondées et excessives.
Lignes directrices du CEPD sur les violations de données
Le CEPD a publié le 3 janvier dix-huit cas pratiques, faisant office de lignes directrices, pour accompagner les responsables de traitement dans leur gestion des violations de données personnelles, conformément aux articles 33 et 34 du RGPD.
Le CEPD traite des principales menaces que peuvent rencontrer les responsables de traitement, classés en six catégories : les rançongiciels, les attaques d’exfiltration de données, les risques humains internes, la perte ou le vol de documents papier, les erreurs d’envoi et l’ingénierie sociale.
Pour chaque pratique, le CEPD présente les mesures préalables à mettre en œuvre, la méthode d’évaluation du risque, les mesures d’atténuation du risque et les obligations concrètes du responsable de traitement.
Sanction d’IAB Europe par l’autorité de contrôle belge
L’Autorité de contrôle belge a condamné l’IAB Europe à une amende de 250 000 euros pour non-respect du RGPD concernant son standard de « transparence et de consentement » (« Transparency and Consent Framework ») utilisé par les acteurs de la publicité numérique pour mettre leurs outils de profilage publicitaire en conformité avec le RGPD.
L’Autorité identifie la base légale sur laquelle se fonde l’IAB, à savoir le consentement des internautes, comme une garantie insuffisante. Sans interdire l’outil, l’Autorité ordonne des mesures de correction. L’IAB a indiqué avoir fait appel de la décision.
Injonction du CEPD au Parlement européen pour des transferts de données hors UE
Le CEPD a constaté qu’un site internet lancé par le Parlement européen pour permettre aux membres et au personnel du Parlement de réserver des créneaux pour effectuer des tests de Covid-19 n’était pas conforme au RGPD, notamment concernant des transferts de données personnelles en dehors de l’UE, vers les Etats-Unis, sans démonstration d’un niveau équivalent de protection.
Ce contrôle intervient à la suite d’une plainte. Le Parlement européen est enjoint de corriger son site internet dans un délai d’un mois.
Sanction de l’opérateur de téléphonie grec COSMOTE
L’Autorité de contrôle grecque a sanctionné le 31 janvier 2022 l’opérateur de téléphonie COSMOTE par une amende de 6 millions d’euros. Celle-ci collectait les données de trafic des abonnés et les conservait pendant une durée de 90 jours à compter de la date d’appel, puis les conservait de manière pseudonymisée pendant 12 mois supplémentaires.
L’Autorité a considéré que ce traitement portait atteinte aux principes de légalité et transparence des traitements, ne démontrait pas de mesures de sécurité suffisantes et était mis en œuvre à la suite d’une analyse d’impact dont l’évaluation était inexacte.
Article rédigé par : Alix CAPELY, Pierre-Emmanuel MEYNARD et Camille PECNARD
National, regional and international offices to implement the standard WIPO ST.26 for the sequence listings as of july 1, 2022
The Committee on WIPO Standards (CWS) adopted new WIPO Standard ST.26, which represents nucleotide and amino acid sequences listings in XML, replacing WIPO Standard ST.25.
The representation of sequence listings in XML format rather than TXT format intends to improve access to international sequence databases. The new standard further harmonizes sequence listing practice among patent offices and requires mandatory annotation of additional sequence types (nucleotide analogues, D-amino acids, branched sequences), so that more sequence data will be searchable.
The filing date (not the priority date) is the reference date that determines if the new ST.26 rules apply. Refiling a sequencing listing when a divisional application is made is a matter of national or regional law. As of today, the EPO is understood to require filing a divisional application filed on or after July 1, 2022 in the new ST.26 format.
A newly developed global software tool “WIPO Sequence” that enables the preparation amino acid and nucleotide sequence listings according WIPO Standard ST.26 is provided on the WIPO homepage.
More details on the standard WIPO ST.26 may be found under the WIPO and EPO websites.
La criticité de l’apport de preuves d’exploitation des marques dans les nouvelles procédures en nullité
La procédure en nullité a été modifiée par les dispositions de la « loi Pacte » (en vigueur depuis le 11 décembre 2019) en particulier au regard de ses conditions de recevabilité qui, en ce qui concerne les preuves d’exploitation de la marque antérieure invoquée, sont de deux ordres :
1. Preuves d’usage de la marque antérieure soumise à obligation d’usage
L’article L 716-2-3 prévoit, sous peine d’irrecevabilité que, sur requête du titulaire de la marque attaquée, le titulaire de la marque antérieure servant de base à l’action, doit apporter la preuve :
- si celle-ci est soumise à obligation d’usage à la date d’introduction de l’action, de l’usage sérieux (ou un motif de non usage) de sa marque au cours des cinq années précédant la date à laquelle cette demande en nullité a été formée ;
et
- si celle-ci était soumise à obligation d’usage à la date de dépôt ou de priorité de la marque attaquée, de l’usage sérieux (ou un motif de non usage) de sa marque au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque attaquée.
La preuve de l’exploitation doit donc porter sur deux périodes de référence distinctes.
La dernière disposition peut amener à une situation surprenante dans l’hypothèse où la marque attaquée serait très ancienne et où le titulaire de la marque antérieure invoquée se verrait refuser son action au motif qu’à la date de dépôt de la marque dont la nullité est requise, il n’exploitait pas sa marque. Cela reviendrait à interdire l’introduction d’une demande en nullité alors même que l’action est imprescriptible !
Un exemple en pratique :
Enfin et pour rappel, la preuve de cet usage a des conséquences non seulement sur la recevabilité de l’action, mais également sur l’étendue de l’opposabilité de la marque invoquée qui ne sera réputée enregistrée que pour chacun des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.
2. Preuves de la distinctivité de la marque antérieure aux fins de l’appréciation du risque de confusion
Le nouvel article L 716-2-4 dispose que la demande en nullité fondée sur une marque antérieure est irrecevable si cette marque n’avait pas acquis un caractère suffisamment distinctif à la date de dépôt de la marque attaquée justifiant l’existence d’un risque de confusion.
La question qui se pose est de savoir comment va être appréciée cette condition « d’acquisition d’un caractère distinctif ».
A notre connaissance, aucune décision n’est venue à ce jour définir cette nouvelle condition que nous interprétons comme mettant à la charge du titulaire de la marque antérieure la démonstration d’une exploitation telle de sa marque que le risque de confusion aurait été évident au jour de dépôt de la marque attaquée. Cela revient à établir un dossier notoriété de la marque antérieure !
Une attention toute particulière devra donc être portée sur la capacité du titulaire de la marque invoquée à prouver son usage et son caractère distinctif à ces différentes périodes.
Lavoix est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de protection et défenses de vos marques dans les nouvelles procédures en nullité.
L’Irak adhère au traité de coopération PCT
Le 31 janvier, le gouvernement de l’Irak a déposé son instrument d’adhésion au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) auprès du Directeur général de l’OMPI.
L’Irak devient ainsi le 155e membre de l’Union du PCT. Il entrera en vigueur pour l’Irak le 30 avril 2022.
À partir du 30 avril 2022, il sera ainsi possible d’obtenir une protection brevet en Irak via un dépôt PCT.
Brevetabilité des simulations mises en œuvre par ordinateur – Retour sur la décision G1/19 de l’OEB
Le 25 février 2022, la Chambre de Recours à l’origine de la saisine G1/19 sur les simulations mises en œuvre par ordinateur a annoncé qu’elle émettrait sa décision écrite d’ici la fin du mois de mars 2022. Cette décision viendra clore cette affaire et illustrer une application pratique des enseignements de la saisine G1/19.
Plus généralement, nous vous proposons de revenir sur la décision G1/19 qui, tout en confirmant la jurisprudence établie sur les inventions mises en œuvre par ordinateur, a introduit certaines précisions importantes, que nous aurons plaisir à vous présenter, avec quelques implications pratiques.