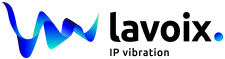Publications, articles de presse, classements, awards et évènements à venir
Différents angles de vue : JUB et Haute Cour de Justice anglaise
Des approches et des conclusions différentes dans l’affaire Advanced Cell Diagnostics vs. Molecular Instruments
L’OEB ajuste son barème de taxes à compter du 1er avril 2026
1. L’Office européen des brevets (OEB) ajustera son barème de taxes à compter du 1er avril 2026.
Technologies quantiques – Projet « OQULUS » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
Le paquet pharmaceutique : faciliter l’accès aux médicaments et protéger l’innovation
Le 11 décembre 2025, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur le paquet pharmaceutique européen, qui comprend une nouvelle directive et un nouveau règlement. Bien qu’un accord politique ait été trouvé, ce paquet n’est pas encore entré en vigueur.
Indications géographiques et marques : entre conflit et coexistence
Les indications géographiques (IG) protègent la dénomination d’un produit issu d’une certaine origine géographique et qui doit ses qualités ou sa réputation à son origine. Il est fréquent que des marques comprennent des termes identiques ou évocateurs d’une IG ou, inversement, qu’une IG reprenne des termes inclus dans des marques antérieures, ce qui peut susciter des conflits.
La division locale de la JUB confirme sa compétence dans l’affaire Sun Patent Trust c/ Vivo
Le 30 octobre 2025, la division locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) a rendu une ordonnance (UPC_CFI_361/2025) rejetant l’exception d’incompétence soulevée par Vivo dans le litige l’opposant à Sun Patent Trust.
Le PACE ne sera plus disponible pour la recherche à compter du 1er février 2026.
Le programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») ne sera plus disponible pour la phase de recherche à partir du 1er février 2026.
Optique – étude d’une décision relative à un dispositif d’éclairage automobile
La décision T 0502/15 [1] concerne un dispositif d’éclairage pour véhicule automobile, avec en particulier un éclairage diurne (DRL).
Digital Omnibus : quel enjeux et perspectives dans votre mise en conformité ?
La Commission européenne a publié le 19 novembre dernier un projet de réforme du cadre numérique européen acquis, dénommé le « Digital Omnibus », présenté comme simplifiant les principaux textes de l’écosystème numérique européen. Visant principalement les règles relatives aux données personnelles issues du RGPD2, il s’agirait de la première réforme de ce texte depuis son adoption en 2016.
Décision JUB : La division centrale de Paris précise sa méthode d’évaluation de l’activité inventive
Dans une décision clé du 20 octobre 2025 (UPC_CFI_189/2024), opposant Meril Life Sciences à Edwards Lifesciences, la division centrale de Paris de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) a fourni des éclaircissements importants sur son approche de l’appréciation de l’activité inventive.
« Marcher sur une corde raide » : les praticiens évaluent l’impact de la hausse des frais de la JUB
Managing IP consacre son dernier article – “‘Walking a tightrope’: practitioners assess impact of UPC fee hike” – aux enjeux liés à l’évolution récente des frais devant la Juridiction unifiée du brevet.
JUB – Admission d’Apple en intervention dans un litige sur le régime de confidentialité
La Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) a rendu le 23 septembre 2025 une ordonnance importante (UPC_CoA_631/2025 et 632/2025) relative à l’admission d’Apple comme intervenant dans des recours formés par Ericsson dans le cadre d’actions en contrefaçon lancées devant la division locale de Milan contre ASUS, Arvato et Digital River.
Modification des frais de justice de la JUB à compter du 1er janvier 2026
Le comité administratif de la juridiction unifiée du brevet (JUB) a adopté des modifications des frais de procédure.
L’approche de la JUB en matière d’activité inventive
Les avocats de Lavoix proposent un aperçu de l’approche de la JUB en matière d’activité inventive, et s’interrogent sur le point de savoir si la juridiction développe sa propre méthode plutôt que de suivre celle de l’OEB.
La médiation judiciaire en propriété intellectuelle : un outil efficace de résolution des litiges
La médiation intègre la stratégie contentieuse en propriété intellectuelle (PI) et doit être anticipée, que ce soit devant les juridictions nationales, ou les offices de PI internationaux (OMPI, EUIPO pour les marques et dessins et modèles de l’UE).
Depuis le 1er octobre 2025, l’OEB accepte les dessins en couleur
Comme vous le savez peut-être déjà, l’Office européen des brevets (OEB) a modifié les règles formelles afin d’accepter des dessins en couleur ou en niveaux de gris.
JUB – la contrefaçon par équivalence se précise mais un arrêt de la Cour d’appel est toujours attendu
Comme le dispose l’article 69(1) CBE, « l’étendue de la protection conférée par le brevet européen (…) est déterminée par les revendications ».
Technologies quantiques – Projet « QMEMO » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
La Cour d’appel de la JUB définit les critères d’évaluation des « éléments ajoutés »
Dans sa décision UPC_CoA_774/2024, datée du 2 octobre 2025, la Cour d’appel de la JUB a estimé que le même critère s’applique pour évaluer les « éléments ajoutés » dans les revendications accordées d’un brevet, que ce soit au regard de la demande telle qu’elle a été déposée ou au regard de chaque demande mère dont le brevet est issu, lorsque le brevet est délivré à partir d’une demande divisionnaire.
Juridiction unifiée du brevet : la consécration du mécanisme français de la saisie-contrefaçon au niveau européen
La saisie-contrefaçon, une mesure probatoire connue de longue date par le praticien français de la propriété intellectuelle, a été intégrée avec succès au dispositif régissant la Juridiction unifiée du brevet (« JUB »), en vigueur depuis deux ans. Les principaux points à retenir sont présentés ci-dessous.
Deuxième épisode de Magicobus : nouvelle intervention du ministère pour simplifier la procédure civile
Dans la continuité du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, a été publié le 8 juillet 2025 le deuxième épisode du même nom : « Magicobus II » (pour son nom complet : décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile).
Plainte UDRP : contrefaçon n’équivaut pas cybersquatting
La procédure relative aux principes directeurs UDRP (« Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy ») est une procédure arbitrale initiée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI permettant aux titulaires de droits de marque de s’opposer à l’enregistrement abusif d’un nom de domaine.
Optique – étude d’une décision sur un système d’éclairage
La décision de la Cour d’Appel de Paris [1] porte sur un système d’éclairage comprenant une pluralité de sources lumineuses dont la couleur de la lumière est commandée à distance en utilisant notamment des filtres dichroïques.
Technologies quantiques – Projet « QCOMMTESTBED-RESEARCH » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
La JUB déploie progressivement la nouvelle version de son CMS
Le CMS est l’outil de gestion de la Juridiction Unifiée des brevets (JUB – https://www.unified-patent-court.org ) : il permet notamment l’enregistrement des conseils et avocats représentants, le dépôt des pièces par les parties, la consultation des dossiers, ou encore l’enregistrement des dérogations (opt-out).
Données personnelles – Janvier-Juin 2025
Cette newsletter LAVOIX présente une sélection des actualités de janvier à juin 2025 dans le domaine de la protection des données personnelles.
La règle du jeu…vidéo
L’industrie du jeu vidéo a changé depuis la sortie du jeu d’arcade Pong, en 1972. Le droit a toujours eu des difficultés à appréhender le jeu vidéo.
Aujourd’hui, la jurisprudence qualifie un jeu vidéo, composé de plusieurs éléments, comme une « œuvre complexe ». Cette notion prétorienne a des contours flous et pose des questions notamment quant à ses conséquences.
Technologies quantiques – Projet « PQTLS » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
La règle du jeu… vidéo
Depuis la sortie du jeu d’arcade Pong, en 1972, le droit a toujours rencontré des difficultés à appréhender le jeu vidéo.
Compétence temporelle de la JUB
Dans sa décision APL_8790/2025, rendue le 2 juin 2025, la Cour d’appel de la JUB a confirmé la compétence temporelle de la JUB pour les actes ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’accord JUB et pendant la période d’opt-out lorsque l’opt-out a été retiré avant l’introduction de l’action devant la JUB.
L’OEB renouvelle ses certifications ISO et obtient la certification pour son système de gestion environnementale
1. Le système de gestion de l’OEB a été audité en avril 2025 en vue de renouveler les certifications déjà obtenues par le passé et d’obtenir pour la première fois la certification ISO 14001.
Panorama de jurisprudence en droit des logiciels
La jurisprudence récente en matière de droit des logiciels témoigne de certaines tendances, qu’il est intéressant de synthétiser.
24 juin 2025
Petit déjeuner d’affaires : Deux ans de la JUB – Où en sommes-nous ?
Après avoir célébré avec succès sa première année, Lavoix se réjouit de partager avec vous le deuxième anniversaire de la Juridiction Unifiée du Brevet !
19 juin 2025
Petit déjeuner d’affaires : Deux ans de la JUB – Où en sommes-nous ?
Après avoir célébré avec succès sa première année, Lavoix se réjouit de partager avec vous le deuxième anniversaire de la Juridiction Unifiée du Brevet !
5 juin 2025
Petit déjeuner d’affaires : Protéger vos innovations quantiques – Tendances, enjeux et solutions
Quelles sont les spécificités des inventions dans le domaine quantique et comment les protéger ?
JUB : Nouveaux éclairages sur la méthode d’interprétation des revendications par la Cour d’appel
Dans la décision d’appel APL_64374/2024, en date du 1er mai 2025, la Cour d’appel de la JUB a apporté des précisions supplémentaires sur la manière dont l’interprétation des revendications doit être menée devant la JUB.
L’accord de validation avec le Laos est entré en vigueur le 1er avril 2025
Le 13 mai 2024, le Laos a conclu un accord avec l’Office européen des brevets permettant aux déposants d’étendre la protection de leur brevet européen sur son territoire.
JUB : Le pouvoir discrétionnaire de la JUB en cas d’absence de mémoire en défense
Décision de la Cour d’appel de la Cour unifiée des brevets rendue le 5 mai 2025, UPC_CoA_635/2024, APL_58934/2024
Ordonnance du Tribunal de première instance de la division centrale de la Juridiction unifiée du brevet (siège de Paris) rendue le 2 avril 2025, n° App_61657/2024, 61782/2024 et 61784/2024 UPC_CFI_164/2024
Technologies quantiques – Projet « EPIQ » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
Optique – étude d’une décision sur un hologramme pour un document d’identité
La décision de la Cour d’Appel de Paris [1] porte sur un document d’identité sécurisé par un hologramme particulier schématisé ci-dessous.
1er mai 2025 – Le paquet modèle se concrétise !
Avec l’entrée en vigueur de la phase 1 de la réforme des dessins et modèles de l’Union Européenne, des nouveautés sont à prendre en compte.
La marque ombrelle, un rayonnement limité
La marque ombrelle est une notion issue du domaine du marketing que le droit des marques s’est approprié.
Nouvelles versions des directives de l’OEB
En avril, l’Office européen des brevets (OEB) a publié une nouvelle version des Directives relatives à l’examen, au brevet unitaire et au PCT-OEB.
Interprétation large de la donnée de santé par la CJUE
En matière de données personnelles, les données de santé sont spécifiques, leur régime de protection étant davantage protecteur pour la personne physique concernée.
Technologies quantiques – Projet « NISQ2LSQ » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
Optique – étude d’une décision sur une fibre optique
La décision T 1460/21 [1] porte sur une fibre optique présentant un noyau interne, un noyau externe et une gaine intérieure comme schématisé ci-dessous.
Double objectif ambitieux du règlement sur l’IA : encadrer et encourager l’innovation
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA), entré en vigueur le 1er août 2024, est le premier règlement régulant l’IA. Il aura un impact significatif pour les entités qui déploient des systèmes d’IA.
Référé-interdiction devant la JUB : panorama de jurisprudences dans le secteur des sciences de la vie en 2024
L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) le 1er juin 2023 a marqué un tournant majeur dans le domaine du droit des brevets en Europe.
Adoption d’un langage neutre en matière de genre dans le règlement d’exécution de la CBE
Avis de l’Office européen des brevets en date du 12 février 2025 concernant l’adoption d’un langage neutre en matière de genre dans le règlement d’exécution de la CBE.
Arrêt BSH v. Electrolux : compétence étendue en matière de contrefaçon transfrontalière de brevets
Arrêt BSH v. Electrolux : compétence étendue des juridictions des Etats membres de l’Union européenne en matière de contrefaçon transfrontalière et validité de brevets.
Optique – étude d’une décision sur un amplificateur optique
La décision T 1542/10 [1] porte sur un amplificateur optique dont le coefficient de gain est réglé de manière spécifique. Un exemple de l’évolution de ce coefficient de gain en fonction de la longueur d’onde est illustré sur la figure ci-dessous du brevet.
Esport et DPI : les règles du jeu
L’esport est défini comme étant « la pratique compétitive du jeu vidéo en multi-joueurs, dans le cadre de ligues ou compétitions en ligne ou d’évènements physiques, essentiellement entre joueurs professionnels ».
Rapport statistique de l’IP5 2023
Le rapport annuel des statistiques IP5 des cinq plus grands offices de propriété intellectuelle du monde (IP5) a été publié récemment.
Lavoix annonce la nomination de quatre nouvelles associées
Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle annonce la nomination de nouvelles associées : Ariane Chauveau, Eva Laur, Marie-Anne Milon et Bertille Thémé, toutes quatre Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires en Brevets Européens.
Copaxone – publication de la décision
Suite à notre dernière IP Alert du 23 janvier 2025, la décision de la Commission Européenne publiée le 8 avril 2025 (seulement en anglais) est désormais disponible sous la référence AT.40588 : https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/AT.40588
Données personnelles – Juin-Décembre 2024
Cette newsletter présente une sélection des actualités de juin à décembre 2024 dans le domaine de la protection des données personnelles.
Lavoix confirme son positionnement en Chimie et Biologie avec le recrutement de deux nouveaux associés
Lavoix, cabinet européen reconnu pour son expertise en Propriété Industrielle, accélère la croissance de son équipe en Chimie et Biologie avec l’arrivée de deux nouveaux associés dans ces domaines d’activité. En 2024, Isabelle Bosser rejoint le bureau de Lyon, tandis que Michael Schlauch intègre l’équipe de Munich, apportant chacun leur expertise dans des domaines stratégiques de l’innovation scientifique.
Protection par brevet des méthodes chirurgicales en Europe et aux US
Pour les brevets européens, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique sont explicitement exclues de la brevetabilité par la législation (Article 53 CBE), bien que la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets (OEB) ait évolué vers une pratique plus permissive que par le passé. Les dispositifs médicaux ne sont toutefois pas exclus et peuvent faire l’objet d’une demande de brevet européen.
Réformes multiples en droit de la procédure civile : la première instance et l’appel sont impactés
La pause estivale a annoncé diverses modifications de la procédure civile du fait de l’entrée en vigueur le 1 septembre 2024 de l’essentiel des dispositions du décret du 29 décembre 2023 [1] et du décret du 3 juillet 2024 [2].
Révision du barème des taxes de brevets de l’USPTO
Le 20 novembre 2024, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) a annoncé une révision du barème des taxes pour les brevets, qui entrera en vigueur le 19 janvier 2025.
Retrait effectif d’un opt-out lorsque des procédures nationales sont pendantes
Décision de la Cour d’appel de la JUB du 12 novembre 2024
AIM SPORT DEVELOPMENT AG vs SUPPONOR
Nouvelle demande à la Grande Chambre de Recours de l’OEB – G 2/24
La chambre de recours technique de l’OEB a posé une requête à la Grande Chambre de recours afin de clarifier le statut d’un tiers intervenant au cours d’une procédure de recours.
Rappels sur la pratique européenne concernant la brevetabilité des méthodes chirurgicales
La jurisprudence de l’Office européen des brevets (OEB) concernant la brevetabilité des méthodes chirurgicales a connu une évolution significative suite à la décision G1/07 de la Grande Chambre de recours de l’OEB en février 2010.
Nouveaux développements concernant le programme pilote CNIPA-EPO
À partir du 1er décembre 2024, les taxes de recherche pour la désignation de l’OEB en tant qu’administration chargée de la recherche internationale pour les demandes participant au programme pilote CNIPA-OEB peuvent être payées en yuans chinois directement auprès du CNIPA.
Copaxone : La Commission européenne inflige une amende pour utilisation abusive du système des brevets et dénigrement
Copaxone – La Commission européenne inflige à Teva une amende de 462.6 millions d’euros pour utilisation abusive du système des brevets et dénigrement.
Russie : nouvelle législation en matière de brevets
Le Règlement N° 1278 publié le 27 septembre 2024 apporte plusieurs modifications à la loi Russe.
Modification des pratiques dans l’accès aux documents de la littérature en matière de brevets
Avis de l’Office européen des brevets du 2 juillet 2024 concernant une modification des pratiques en matière d’accès aux documents de la littérature brevets cités dans les procédures de recherche et d’examen.
17 septembre 2024
Petit déjeuner d’affaires – Dispositifs médicaux : Conseils pratiques pour une protection en Europe et aux US
Les dispositifs médicaux et leurs utilisations font l’objet de spécificités en matière de brevets. Pour autant, les acteurs du domaine ont tout intérêt à sécuriser leur marché en utilisant à bon escient les outils de Propriété Intellectuelle.
10 septembre 2024
Petit déjeuner d’affaires – Dispositifs médicaux : Conseils pratiques pour une protection en Europe et aux US
Les dispositifs médicaux et leurs utilisations font l’objet de spécificités en matière de brevets. Pour autant, les acteurs du domaine ont tout intérêt à sécuriser leur marché en utilisant à bon escient les outils de Propriété Intellectuelle.
Poursuite des procédures d’examen et d’opposition en vue de la saisine G 1/24
Avis de l’Office européen des brevets daté du 1er juillet 2024 concernant la poursuite des procédures d’examen et d’opposition en vue de la saisine G 1/24.
Lavoix : Votre partenaire de confiance pour les litiges devant la Juridiction Unifiée du Brevet
Depuis l’instauration de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) il y a un an, Lavoix, groupe européen spécialisé en propriété intellectuelle, s’est affirmé comme un leader dans la gestion des litiges en matière de brevets.
La valorisation des évènements sportifs : un exercice de haute voltige
La publicité et la communication dans le cadre d’évènements, comme les Jeux Olympiques de Paris 2024, sont souvent des sujets qui amènent leur lot de contentieux, communément appelé « ambush marketing ».
Optique – étude d’une décision sur un endoscope
La décision T 0305/06 [1] porte sur un endoscope présentant un système optique avec plusieurs agencements de lentilles, visibles ci-dessous.
Milan : the place to be pour la PI !
Le 27 juin 2024, la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) a ouvert une nouvelle section de la Division Centrale à Milan faisant suite à la décision du comité administratif du 26 juin 2023 modifiant l’Accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB) en vue d’établir une section de la Division Centrale à Milan.
Lavoix intensifie son expansion pan-européenne et se rapproche du cabinet italien Giambrocono
Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), annonce l’acquisition du cabinet italien Giambrocono.
La saisie-contrefaçon, une mesure probatoire efficace
Le succès d’une action en contrefaçon repose sur la solidité des éléments de preuve à disposition du demandeur.
La Roumanie adhérera à l’accord sur la JUB le 1er septembre 2024
La Roumanie a déposé son instrument de ratification le 31 mai 2024 et adhérera à l’accord sur la JUB le 1er septembre 2024. À partir de cette date, l’accord sur la JUB comptera 18 membres en Europe.
Changements législatifs en Inde
Le Ministère Indien du Commerce et de l’Industrie a publié le 15 mars 2024 dans la Gazette Officielle des amendements venant modifier certaines règles sur les brevets datant de 2003.
(suite…)
Première année de la juridiction unifiée du brevet : « Un tel nombre de décisions en aussi peu de temps est assez marquant »
Le 1er juin 2023 était officiellement lancée la juridiction unifiée du brevet, rassemblant 17 États européens et visant à simplifier la gestion des brevets pour les entreprises.
Projet « QAFCA » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
Données personnelles – Actualités de l’année 2023-2024
Cette newsletter présente une sélection des actualités de l’année 2023-2024 du domaine de la protection des données personnelles.
Quel est l’intérêt de déposer sa marque patronymique pour un sportif ?
De nombreux sportifs bénéficient de la protection à titre de marque qui leur permettent de lutter efficacement contre l’opportunisme de certains mais aussi d’accroitre nettement leur visibilité.
Protection cumulative dans le cadre de la JUB
Protection cumulative : brevet européen et brevet national vs brevet unitaire et brevet national
Juridiction unifiée du brevet : le bilan après un an d’exercice
Lavoix fait le bilan de la première année d’activité de la juridiction unifiée du brevet (JUB).
La protection cumulée dans le cadre de la JUB
Cumul : brevet européen et brevet national vs brevet européen à effet unitaire et brevet national (suite…)
Sportifs : à vos marques… !
L’image et le nom des sportifs sont les deux actifs les plus importants dans leur communication. Plusieurs options sont possibles pour les protéger, dont la protection des noms patronymiques et le droit des marques.
Innovation & Hydrogène – L’Europe et le Japon en tête des dépôts de brevets
Le rapport « Hydrogen patents for a clean energy future », préparé conjointement par l’OEB et l’Agence Internationale de l’Energie, analyse la géographie des dépôts de brevets concernant l’hydrogène au cours de la dernière décennie.
Digital Services Act : attention aux sanctions, il est encore temps de vous mettre en conformité
Le règlement européen connu sous le nom de « Digital Services Act » (DSA) est entré en vigueur pour l’ensemble des plateformes en ligne le 17 février dernier : rappels et recommandations.
Aperçu du plan stratégique 2028 de l’OEB
L’OEB a récemment publié son nouveau plan stratégique pour les années à venir jusqu’en 2028.
13 juin 2024
Petit déjeuner d’affaires : JUB et Brevet Unitaire – Bilan un an après
L’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet, commune à la majorité des États européens est entré en vigueur le 1er juin 2023.
6 juin 2024
Petit déjeuner d’affaires : JUB et Brevet Unitaire – Bilan un an après
L’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet, commune à la majorité des États européens est entré en vigueur le 1er juin 2023.
Langue de procédure devant la JUB : Anglais 1 – Allemand 0
Dans cette décision intéressante (UPC_CoA_101/2024 ApL_ 12116/2024 10x Genomics, Inc contre Curio Bioscience Inc), la Cour d’appel a ordonné que la langue de la procédure soit changée de l’allemand à l’anglais.
Innovation & Hydrogène – Stockage et distribution d’hydrogène : développements récents des technologies établies
Le stockage et la distribution d’hydrogène gazeux ou liquide implique des technologies matures, telles que les conteneurs d’hydrogène, les pipelines et la liquéfaction.
L’Office européen des brevets (OEB) a publié un tableau de bord relatif à la qualité
Le tableau de bord présente des indicateurs clés de performance (KPI) et vise à améliorer la transparence en fournissant des mises à jour trimestrielles sur la satisfaction des utilisateurs quant à la qualité du processus de délivrance des brevets à l’OEB.
L’étiquetage du vin : créativité sous contrainte(s)
…ou comment profiter des nouvelles indications obligatoires pour préciser l’image de votre vin et vous assurer de sa protection.
Clause grand-père pour les mandataires OEB
Un mandataire en brevets européens peut représenter une partie devant la JUB sous réserve de disposer des qualifications appropriées. Ces qualifications sont définies par le « Règlement sur le certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets et autres qualifications appropriées » (ou RCECB).
Innovation & Hydrogène – La France en première ligne pour un hydrogène propre
Afin d’accélérer la transition écologique, la France a fixé une stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène, avec notamment pour objectifs le développement de mobilités propres, en particulier pour les véhicules lourds, et la création d’une filière industrielle.
Suspension de procédure en cas de procédures parallèles devant la JUB et l’OEB
Dans une ordonnance du 8 janvier 2024, la Division centrale de Paris a interprété pour la première fois l’article 33(10) de l’Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (JUB) concernant la suspension de la procédure lorsqu’une procédure parallèle devant l’OEB est susceptible de mettre en cause la validité du brevet.
Sursis à statuer en cas de procédures parallèles devant la JUB et l’OEB
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la Division centrale de Paris fait une première interprétation de l’article 33 (10) de l’Accord relatif au sursis à statuer en cas de procédure parallèle susceptible de mettre en cause la validité du brevet devant l’OEB.
Accélération des procédures d’opposition en cas d’actions judiciaires parallèles
L’OEB accélérera le traitement des oppositions s’il est informé de l’existence d’une procédure parallèle de contrefaçon ou de révocation devant la Juridiction unifiée du brevet, une juridiction nationale ou toute autre autorité compétente d’un État contractant.
Règlement IA, le bouleversement attendu est-il artificiel ?
Beaucoup de débats existent autour de l’intelligence artificielle (IA) et son déploiement soulève des questions juridiques que tentent d’encadrer les législations naissantes, comme la proposition de règlement européen sur l’intelligence artificielle (règlement IA) proposé par la Commission en 2021, et adopté par les 27 membres de l’Union le 2 février 2024.
Protection par marque du bonhomme Lego® : un jeu d’enfant ?
Le Tribunal de l’Union Européenne a rejeté le 6 décembre 2023 deux actions en nullité déposées par la société BB Services GmbH à l’encontre de deux marques tridimensionnelles portant sur des figurines-jouets, car leurs formes ne sont pas exclusivement dictées par la nature même du produit ni par une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (arrêts du Tribunal de l’Union Européenne TUE T-297/22 et T-298/22).
Implication des juges techniques dès le stade de la demande de mesures provisoires
Ordonnance de procédure, 25 janvier 2024 – Division locale de Düsseldorf – UPC_CFI_452/2023
Avis de l’OEB concernant les changements de taxes entrant en vigueur le 1er avril 2024
L’OEB a publié un système de taxes simplifié qui introduit désormais des taxes réduites pour les micro-entités.
L’Italie et la Juridiction unifiée du brevet signent un accord de siège
L’Italie et la Juridiction unifiée du brevet (JUB) ont signé un accord de siège, voir le communiqué de presse du gouvernement italien.
Innovation & Hydrogène – Quelles tendances pour le stockage et la conversion de l’hydrogène ?
Le rapport « Hydrogen patents for a clean energy future », préparé conjointement par l’OEB et l’Agence Internationale de l’Energie, analyse les tendances globales dans l’innovation concernant les chaines de valeur de l’hydrogène.
19 mars 2024
Petit déjeuner d’affaires : Breveter vos inventions en optique
Quel est le point commun entre l’aéronautique, le spatial, les transports, la santé, les télécommunications, la défense ou encore l’énergie ?
Contentieux des brevets Pharma et Biotech : la JUB change‑t‑elle les stratégies contentieuses ?
Le sommet Pharma and Biotech Patent Litigation Europe, qui s’est tenu à Amsterdam, a été une bonne occasion d’obtenir un aperçu de l’OEB sur l’état des lieux.
Innovation & Hydrogène – Importance des droits de PI pour les start-ups en recherche de financement
L’Office Européen des Brevets a publié un rapport concernant l’innovation dans le secteur de l’hydrogène.
Rapport statistique de l’IP5 2022
Le rapport annuel des statistiques IP5 des cinq plus grands offices de propriété intellectuelle du monde (IP5) a été publié récemment.
LIVRE BLANC – Droit des marques à l’international
La PI en Chine, anticipation et adaptation : les maîtres mots d’un relais de croissance majeur
Revue de jurisprudence française et des instances de l’Union Européenne marques pharmaceutiques et modèles 2023
Lavoix vous présente une revue de décisions rendues en matière de marques pharmaceutiques et modèles par les instances françaises et de l’Union Européenne.
Le formulaire informant les demandeurs de l’entrée du PCT dans la phase EP a été interrompu
L’OEB a annoncé que l’avis de l’OEB informant de l’entrée dans la phase européenne avant celle de l’OEB est interrompu.
Nouvelle édition du Baromètre de la PI
Créé il y a plus de 10 ans pour mieux appréhender les évolutions de la propriété intellectuelle, le Baromètre de la PI nous permet également de faire évoluer nos prestations pour répondre au mieux aux attentes de nos clients en termes de protection et de valorisation de leurs actifs immatériels.
11 janvier 2024
Petit déjeuner d’affaires : Intelligence artificielle & PI – Enjeux et risques
L’intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de notre présent et de notre futur. Malgré les questions ouvertes et les problématiques non résolues, les entreprises doivent appréhender son impact sur leurs droits de propriété intellectuelle.
Projet « QUBITAF » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
(suite…)
Marcuria, cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle rejoint le groupe Lavoix
Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), annonce l’acquisition de Marcuria, cabinet d’avocats dédié au droit des marques, fondé par Claire Ardanouy et Emmanuelle Jaeger, toutes deux avocates au Barreau de Paris et diplômées en propriété intellectuelle.
Droit formel de priorité : décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB
La Grande Chambre de Recours a rendu une décision sur les recours consolidés G 1/22 et G 2/22, statuant que l’OEB est compétent pour évaluer le droit de priorité et que l’approche des « codemandeurs PCT » est valide.
Augmentation substantielle des taxes officielles au Canada et en Argentine
Les taxes officielles pour le dépôt de demandes de brevet augmenteront jusqu’à 36% au Canada à partir du 1er janvier 2024.
30 novembre 2023
Petit déjeuner d’affaires : Intelligence artificielle & PI – Enjeux et risques
L’intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de notre présent et de notre futur. Malgré les questions ouvertes et les problématiques non résolues, les entreprises doivent appréhender son impact sur leurs droits de propriété intellectuelle.
Fin de la fiction postale des 10 jours à l’OEB
Une nouvelle fiction de notification et de calcul des délais entrera en vigueur le 1er novembre 2023.
Projet « ROBUSTSUPERQ » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
(suite…)
Projet « PRESQUILE » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
(suite…)
Douanes : quelles bonnes pratiques pour les marques ?
Philippe LODS a évoqué les bonnes pratiques en termes de contrefaçon et de surveillance en douanes pour les marques dans LexInside. Une interview menée par Arnaud Dumourier pour DECIDEURS TV.
Tolérer, c’est risqué !
Souvent commenté, l’arrêt FREE contre FREE SBE (Cour d’appel de Paris – Pôle 05 ch. 02, 14 janvier 2022 / n° 20/05019, S. A.S. FREE/S. A.S. FREE SBE) pose la question du point de départ du délai de la forclusion par tolérance.
28 novembre 2023
Forum Perspectives 2023
Venez découvrir la propriété industrielle, le métier d’Ingénieur Brevets et nos opportunités de carrière.
14 novembre 2023
Forum Vitae 2023
Nos ingénieurs seront présents pour répondre à vos questions sur la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets.
3-7 novembre 2023
Asian Patent Attorneys Association (APAA)
3 – 7 novembre 2023
Philippe Blot et Valérie Genin participeront à la 20ème Assemblée générale et aux 74ème et 75ème réunions du Conseil de l’Asian Patent Attorneys Association (APAA), à Singapour.
22-25 octobre 2023
2023 AIPPI World Congress
22 – 25 octobre 2023
Camille Pecnard et Pierre-Emmanuel Meynard participent au congrès annuel de l’AIPPI à Istanbul.
17-18 octobre 2023
5ème édition des French Photonics Days
17 – 18 octobre 2023
Anne-Sophie Auriol sera présente à la 5ème édition des French Photonics Days, au Pavillon Joséphine à Strasbourg.
Le thème principal de ces rencontres sera : » Procédés Photoniques pour la Santé et l’Industrie « . L’évènement est organisé par SupOptique Alumni, Photonics France et l’Université de Strasbourg (Laboratoire ICube).
4-7 octobre 2023
PTMG Autumn Conference 2023
4 – 7 octobre 2023
Béatrice Daubin et Pierre-Emmanuel Meynard participeront à la conférence d’automne du Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG) à Athènes, en Grèce.
29 sept. – 1 oct. 2023
Conférence AIDV 2023
29 septembre au 1er octobre 2023
Venez discuter du droit de la vigne, du vin et de la propriété intellectuelle avec David Millet et Gwénaël Toussaint lors de la conférence annuelle de l’AIDV.
L’Association internationale du droit du vin tiendra cette année sa conférence dans la vallée de l’Okanagan, au Canada.
20 septembre 2023
France Digital Day (FDDAY) 2023
20 septembre 2023
Lavoix participe au France Digital Day 2023, l’événement startup le plus exclusif d’Europe, au Musée des Arts Forains à Paris.
19-22 septembre 2023
Marques 37th Annual Conference
19 – 22 septembre 2023
Gwénaël Toussaint participe à la 37ème conférence annuelle de MARQUES à Berlin (Allemagne).
18 octobre 2023
Forum Trium 2023
Curieux de découvrir la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets ?
Nos ingénieurs seront présents au Forum Trium pour répondre à vos questions, vous faire découvrir la Propriété industrielle ainsi que le métier d’Ingénieurs Brevets.
Brevet unitaire européen : peser le pour et le contre avant de s’engager
Depuis le 1er juin 2023, des PME s’emparent du brevet unitaire européen pour se protéger de manière plus efficace.
Si cette nouveauté réduit les coûts et fait gagner du temps, elle n’est toutefois pas toujours nécessaire.
Conditions de validité d’une clause prévoyant la cession de droits d’auteur sur des œuvres futures
La Cour d’Appel de Paris reconnait la validité d’une clause de cession de droits d’auteur des œuvres futures dans un contrat de travail.
14 septembre 2023
Petit déjeuner d’affaires : Modèle d’utilité & propriété industrielle
Le terme de modèle d’utilité ou encore certificat d’utilité, peut paraître assez énigmatique. Il s’agit pourtant, au même titre que son « grand-frère », le brevet, d’un titre de propriété industrielle.
Easyfinance – Nouveau module disponible dans IP data²
easyfinance est un nouveau module disponible dans IP data² qui vous permet de consulter et d’extraire de façon autonome vos informations comptables et financières, complétées de quelques informations métiers. (suite…)
Projet « QCOMMTESTBED-INFRA » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
(suite…)
Droit de propriété de marque et limitations légales : usage nécessaire et publicité comparative
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services couverts par celle-ci (article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle – CPI) qui se caractérise en particulier par le droit d’en interdire l’usage dans la vie des affaires.
Données personnelles Mars-Mai 2023
Cette newsletter trimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période mars-mai 2023.
Nouvelles Directives d’examen de l’OEB
Projet « AQCESS » pour 2030
Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.
Projet « e-DIAMANT » pour 2030
Brevet unitaire & JUB : état des lieux de la Sunrise Period et prochaines actions
Propriété industrielle : les 5 questions clés du brevet européen unitaire
(suite…)
Un mot sur la plausibilité et la reprise ultérieure des procédures suspendues
Les réticences des déposants face au lancement du brevet unitaire européen
Longtemps attendus, le brevet unitaire européen et la juridiction unifiée du brevet verront le jour ce 1er juin.
(suite…)
Des conditions de preuves alourdies pour les titulaires des marques de renommée
La décision du Tribunal de l’Union européenne (TUE, 7 décembre 2022, T-623/21, EU:T:2022:776, Puma SE / EUIPO – Vaillant GmbH) a été très largement commentée par les professionnels de la propriété intellectuelle.
Propriété industrielle : quelles évolutions pour le brevet unitaire à partir de juin ?
(suite…)
Journée Mondiale de la Quantique
L’entrée en vigueur de la Juridiction Unifiée du Brevet approche, comment s’y préparer ?
Affaire MetaBirkin : mise en échec des feintes et faux semblants !
Le tribunal de New York a condamné le 8 février 2023 l’artiste américain Mason Rothschild pour contrefaçon et dilution de la marque enregistrée BIRKIN pour des faits de commercialisation sous le nom « MetaBirkins » de NFTs représentant des sacs à mains en fausse fourrure dont la forme s’inspire du sac iconique Birkin de la maison Hermès.
Données personnelles Janvier-Février 2023
Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période janvier-février 2023.
Start-ups & innovation : Comment les start-ups s’emparent de la propriété intellectuelle
Communiqué de presse
Les start-ups qui détiennent des brevets ont trois fois plus de chances de réussir que les autres. La question de la propriété intellectuelle (PI), omniprésente dans les incubateurs, est parfois mise de côté car jugée complexe ou non prioritaire par ces entreprises en devenir. En protégeant projets, idées et marques, la PI constitue pourtant un vrai levier concurrentiel et un facteur clé de développement des start-ups, comme en témoignent Agrid, Themis et Advanced Biodesign, trois jeunes start-ups françaises engagées dans une démarche de protection de leurs innovations et de leur marque avec le support de LAVOIX.
(suite…)
Décision du Conseil d’administration (14/12/22) : l’OEB a annoncé un ajustement des taxes officielles.
16 mars 2023
Petit déjeuner d’affaires : JUB et Brevet Unitaire : le compte à rebours est lancé
Brevet unitaire et juridiction unifiée des brevets : rebattre les cartes de la protection des entreprises
Le brevet unitaire et la juridiction unifiée des brevets devraient voir le jour au printemps 2023. La réforme prévoit d’obtenir une protection du brevet dans 25 États membres de l’Union européenne et de défendre son titre, en cas de litige, devant une juridiction européenne unique.
(suite…)
Quand déposer des demandes d’opt-out ?
Que signifie « opt-out » ?
L’opt-out est une demande visant à soustraire un brevet européen ou une demande publiée à la compétence de la Juridiction unifiée du brevet (JUB).
L’OEB célèbre le 50ᵉ anniversaire de la CBE
Brevet à effet unitaire et juridiction unifiée du brevet : organisation et impacts sur les droits de PI
Après de nombreux soubresauts, le brevet unitaire (BU) et la juridiction unifiée du brevet (JUB) devraient voir le jour au printemps 2023 et visent à apporter une certaine harmonisation dans la gestion des brevets en Europe. (suite…)
Données personnelles Second semestre 2022
Cette newsletter LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période juillet-décembre 2022. (suite…)
Enquête LE POINT
Quels sont les meilleurs cabinets d’avocats de France ?
Le magazine Le Point prépare la 5ème édition de son Palmarès des meilleurs cabinets d’avocats de France. Cette étude consacre les avocats français les plus recommandés dans 32 spécialités du droit.
Opt-out, stay-in : comment procéder en cas de copropriété ?
Avec l’entrée en vigueur du brevet unitaire, de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) et des dispositions transitoires associées, il sera possible d’échapper à la compétence de la JUB pour les demandes européennes publiées et les brevets européens sans effet unitaire (OPT-OUT), en déposant une déclaration effectuée par le(s) demandeur(s)/titulaire(s) effectif(s), avant l’ouverture d’une procédure.
Intelligence artificielle en Chimie et Brevetabilité
L’intelligence artificielle est partout aujourd’hui mais peut-on la breveter dans tous les secteurs technologiques ?
Dans le domaine de la chimie, et notamment dans la modélisation de molécules (études in silico) ou en cosmétique, les outils d’intelligence artificielle ont fait récemment leur apparition. De multiples applications existent déjà, notamment la prédiction d’interactions entre composés, la modélisation de conformation de protéines ou encore l’évaluation de l’activité d’une molécule. Ces outils sont des aides précieuses pour la synthèse de nouvelles molécules ou de nouvelles compositions chimiques.
Le développement de l’intelligence artificielle dans ces domaines s’accompagne du dépôt de demandes de brevets. Se pose alors la question, des éventuelles spécificités des brevets délivrés par les offices, notamment l’Office Européen des Brevets (OEB), pour des inventions dans ces domaines.
A cet effet, nous avons analysé quatre brevets ayant fait l’objet d’une délivrance récente et visant à protéger l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle appliqué sur des données d’entrée pour estimer des données de sortie souhaitées. La synthèse de cette analyse se trouve dans le tableau suivant :
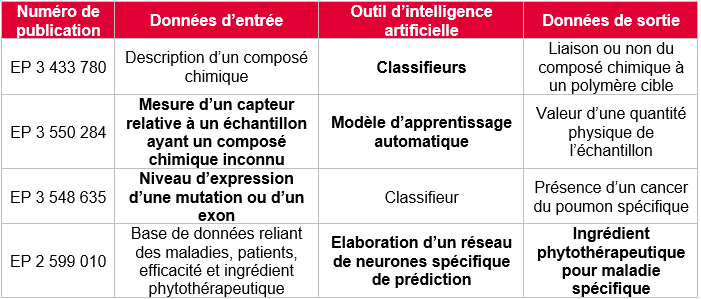 Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.
Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.
Les exemples précités mettent en évidence qu’il est tout à fait possible de breveter des inventions dans le domaine de la chimie et de la biologie mettant en œuvre des technologies d’intelligence artificielle.
Il ressort néanmoins que la brevetabilité n’est pas liée à ces secteurs d’activité, mais provient de données d’entrée/sortie originales et/ou de l’emploi d’un outil d’intelligence artificielle spécifique.
Ainsi, comme pour les secteurs du médical, des transports, et de l’énergie, protéger un outil d’intelligence artificielle dans le secteur de la chimie est tout à fait possible. Pour cela, il suffit d’identifier un élément original parmi les données d’entrée/de sortie et/ou l’outil d’intelligence artificielle (type d’outil et/ou manière d’obtenir l’outil).
Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous aider à une telle identification.
Le début de la Sunrise Period repoussé de deux mois
La Sunrise Period de la Juridiction unifiée du brevet devait commencer le 1ᵉʳ janvier 2023, avec pour objectif que la juridiction devienne opérationnelle le 1ᵉʳ avril 2023.
Dans un communiqué de presse daté du 5 décembre 2022, la Cour indique que ce calendrier est repoussé de deux mois. La Sunrise Period débutera donc le 1ᵉʳ mars 2023, avec l’objectif d’une entrée en vigueur de la Cour au 1ᵉʳ juin 2023.
Qu’est‑ce que la « sunrise period » ?
Le dépôt par l’Allemagne de son instrument de ratification de l’Accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet (AJUB) déclenchera la sunrise period ainsi que l’entrée en vigueur de l’AJUB (trois mois après le début de la sunrise period).
En prévision de l’ouverture de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), actuellement prévue pour le 1er avril 2023, il sera possible de retirer les brevets européens existants et les demandes de brevet européen de la compétence de la JUB, en déposant une demande d’opt‑out.
Demande anticipée d’effet unitaire possible à partir du 1er janvier 2023
Le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») sera prochainement mis en place. Le dernier instrument de ratification manquant devrait être déposé par l’Allemagne en décembre.
22 novembre 2022
Photonics online meetings
Retrouvez Anne-Sophie AURIOL et Arnaud POUDEROUS le 22 novembre prochain lors de la 5ème édition des Photonics Online Meetings et découvrez les nouvelles tendances en photonique et les solutions aux défis à venir.
15 novembre 2022
Lavoix au Forum CentraleSupélec 2022
Nos ingénieurs seront présents au Forum CentraleSupélec, le mardi 15 novembre au Palais des Congrès.
N’hésitez pas à venir leur poser toutes vos questions pour découvrir la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets.
L’OEB supprime le délai de grâce de 10 jours pour la notification
1. Dans le système actuel de la CBE, les courriers de l’OEB sont réputés remis à leur destinataire le dixième jour suivant leur remise au prestataire de services postaux.
2. Le passage aux communications électroniques rend cette règle obsolète, la remise étant beaucoup plus rapide et intervenant généralement le même jour.
En outre, le PCT ne comporte pas un tel décalage de notification de 10 jours.
3. Ainsi, le Conseil d’administration de l’OEB a décidé de supprimer la règle des 10 jours et d’aligner le système de l’OEB sur celui du PCT.
La nouvelle fiction de notification et de calcul des délais entrera en vigueur le 1er novembre 2023.
4. En cas de litige concernant la remise d’un document, la charge de la preuve de la réception (en temps utile) reste à la charge de l’OEB.
Plus d’informations sont disponibles ici.
Cette alerte PI est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas un avis juridique.
Opt-out des CCP
Le fonctionnement de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) est actuellement prévu pour le 1ᵉʳ avril 2023 (https://www.unified-patent-court.org/news/latest-state-play-view-launch-unified-patent-court), ce qui déclenchera la période de « sunrise » dès le 1ᵉʳ janvier 2023.
Pendant cette sunrise period, il sera possible d’opt‑out les titres européens (EP) de la compétence de la JUB. L’opt-out sera possible pour les demandes de brevet européen publiées, les brevets européens délivrés (sans effet unitaire) et les certificats complémentaires de protection (CCP) délivrés pour un produit protégé par un brevet EP (art. 83 AJUB).
8 novembre 2022
Lavoix au Forum Perspectives 2022
Rendez-vous au Forum Perspectives au Centre de Congrès de Lyon le 8 novembre prochain pour découvrir la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets ! Nos ingénieurs lyonnais vous attendent pour répondre à toutes vos questions sur le stand Lavoix.
Informatique Quantique et Brevetabilité
L’informatique quantique fait l’objet de travaux de recherche depuis de nombreuses années. Toutefois, la recherche s’intensifie ces derniers temps et de multiples acteurs se positionnent en vue de préparer l’industrialisation de cette technologie.
De fait, les applications sont nombreuses et variées, et souvent dans des domaines a priori éloignés de l’informatique quantique. Citons, par exemple, la modélisation de molécules en chimie, la prévision de flux logistiques dans l’industrie, ou encore la réalisation de prévisions financières.
Ces changements permettent l’émergence de nouveaux champs de recherche, et donc de nouvelles inventions. La question de ce qui est protégeable par brevet se pose donc, pour les acteurs et dans les différents secteurs d’activité.
L’expérience que nous avons développée dans ce domaine technique montre que les technologies impliquant l’informatique quantique relèvent généralement soit d’une première catégorie, relative à l’ordinateur en lui-même (hardware), soit d’une seconde catégorie relative aux programmes informatiques (software), exécutables en lien avec cet ordinateur.
Les inventions de la première catégorie concernent, a priori, plutôt les acteurs de l’informatique quantique. Ces inventions font l’objet d’une classe de recherche dédiée à l’Office Européen des Brevets, la classe G06N10. Elles incluent notamment la structure de l’ordinateur, ses différents composants et les interactions entre ces composants. Ces éléments sont protégeables par brevets en tant que dispositifs, comme cela aurait été le cas pour un ordinateur classique, si tant est que les conditions standards de brevetabilité (nouveauté, activité inventive…) soient remplies.
Les inventions de la seconde catégorie peuvent émaner de tous les acteurs de l’innovation. Ces inventions regroupent notamment les algorithmes développés pour configurer, contrôler ou effectuer des calculs sur l’ordinateur quantique, en impliquant éventuellement un ordinateur classique. Rappelons que, bien que le code d’un algorithme ne soit pas protégeable par brevet, toutes les fonctions techniques de cet algorithme, qui résolvent un problème technique, le sont. Ainsi, les algorithmes de la seconde catégorie sont protégeables par brevets au même titre que les algorithmes classiques, sous réserve de remplir les conditions de brevetabilité, et notamment de ne pas être assimilés à des méthodes purement mathématiques ou intellectuelles. A cet effet, nous recommandons de mentionner, dans la protection demandée, l’ordinateur mettant en œuvre l’algorithme, et le cas échéant, les composants de l’ordinateur effectuant les différentes étapes de cet algorithme. Il paraît également pertinent de mettre en avant les entrées et/ou sorties originales de l’algorithme et de prévoir au moins une application concrète pour cet algorithme.
Ainsi, les inventions dans le domaine de l’informatique quantique sont tout à fait brevetables, et restent soumises aux mêmes exigences de brevetabilité que les autres inventions.
Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets.
Atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée COGNAC
L’INPI reconnait une atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée COGNAC pour une marque revendiquant des eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac ».
L’appellation COGNAC est notamment protégée en tant qu’Indication Géographique Protégée (IGP) au plan communautaire.
L’utilisation de l’appellation COGNAC est, par conséquent, réglementée de sorte que seuls les spiritueux produits au sein d’une zone de production délimitée et respectant des conditions particulières de production quant à la méthode d’obtention, le vieillissement, le titre alcoolémique définis par le cahier des charges, attaché à cette IGP, peuvent en bénéficier.
Le 3 novembre 2021, la société COGNAPEA a déposé la demande de marque française Cognapea qui, pour faire suite à une objection de l’INPI, revendiquait des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » en classe 33.
Pour faire suite à la publication de cette demande de marque, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le Bureau National Professionnel du Cognac (BNIC) ont conjointement formé opposition à l’enregistrement de cette demande de marque sur la base de l’atteinte à l’indication géographique COGNAC.
L’INPI a rappelé que l’indication géographique COGNAC fait l’objet d’une protection à l’échelle de l’Union Européenne et que toute atteinte doit être exclusivement examinée au regard du Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 qui dispose notamment en son article 21 que les indications géographiques sont protégées contre « toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée (…) ».
L’INPI a, par ailleurs; précisé que, selon l’article précité du Règlement communautaire, les indications géographiques pouvaient être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse respectant le cahier des charges correspondant, mais que selon ce même article, l’« évocation » de ces indications géographiques pour de tels produits n’était pas autorisée.
L’INPI a reconnu que cette demande de marque constituait une atteinte par « évocation » à l’indication COGNAC dans la mesure où elle était constituée de la séquence COGNA- et revendiquait des produits identiques à ceux bénéficiant de l’indication géographique.
Elle a par ailleurs admis qu’une telle évocation, en ne reproduisant que partiellement l’indication géographique COGNAC, risquait d’entrainer un affaiblissement de sa réputation en la banalisant.
Par conséquent, et quand bien même la demande de marque contestée revendiquait exclusivement des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac », l’INPI a prononcé le rejet total de la demande de marque Cognapea (Décision d’Opposition INPI n°OP22-0433 du 26/08/2022).
15-18 octobre 2022
Asian Patent Attorneys Association (APAA)
15 – 18 Octobre 2022
Retrouvez LAVOIX à l’Asian Patent Attorneys Association (APAA) à Busan (Corée).
11 &12 octobre 2022
Life Sciences Strategy Summit on IP & Exclusivity
11 – 12 Octobre 2022
LAVOIX interviendra au Life Sciences Strategy Summit on IP & Exclusivity (by Legal & Compliance Hub) à Munich (Allemagne).
20 & 21 octobre 2022
French Photonics Days
20 – 21 Octobre 2022
LAVOIX sera présent aux French Photonics Days à Saint-Etienne.
Mesures nationales accompagnant la mise en œuvre du brevet unitaire
Il est prévu que l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (AJUB) entre en vigueur au printemps 2023. En même temps, les règlements (UE) 1257/2012 et 1260/2012 entreront en vigueur concernant le brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire) et les modalités de traduction.
La brochure « Mesures nationales accompagnant la mise en œuvre du brevet unitaire » s’inspire de la publication en ligne « Droit national relatif à la CBE » et contient des informations sur les principales mesures nationales accompagnant la mise en œuvre du brevet unitaire. Elle est accessible sur le site de l’OEB.
La brochure contient des informations concernant :
- un filet de sécurité pour la validation d’un brevet EP dans un État membre participant au cas où la demande de protection unitaire serait rejetée – cela concerne par exemple le paiement des annuités, le dépôt d’une traduction ou d’autres formalités ;
- la protection simultanée d’un brevet unitaire ou d’un brevet européen classique et d’un brevet national correspondant ;
- le champ d’application territorial d’un brevet unitaire, notamment l’effet du brevet unitaire dans les territoires et zones d’outre-mer ; et
- divers autres aspects.
La version HTML de la brochure est régulièrement mise à jour. Une version PDF sera publiée prochainement.
Les informations publiées par l’OEB dépendent des informations fournies par les États membres, et celles-ci peuvent être inexactes ou incomplètes. La brochure vise à donner un premier aperçu et, avant toute décision, les informations doivent être confirmées par un conseil en brevets national spécialisé, un mandataire en brevets ou un avocat.
19 octobre 2022
Lavoix au Forum Trium 2022
19 Octobre 2022
Nos ingénieurs seront au rendez-vous du Forum Trium pour vous faire découvrir la Propriété industrielle, le métier d’Ingénieurs Brevets et toutes les opportunités offertes par LAVOIX.
Recherche complémentaire systématique des droits nationaux antérieurs par l’OEB
L’OEB effectuera des recherches supplémentaires pour déterminer les droits nationaux antérieurs et évaluer leur pertinence prima facie à compter du 1er septembre 2022.
L’OEB réalise déjà une recherche portant sur les demandes de brevet européen antérieures, déposées avant et publiées après la date de dépôt d’une demande de brevet européen donnée. Ces demandes européennes antérieures sont pertinentes pour la nouveauté au sens de l’art. 54(3) CBE.
À compter du 1er septembre 2022, l’OEB effectuera également des recherches systématiques pour identifier les droits nationaux antérieurs et évaluer gratuitement leur pertinence prima facie.
Un droit national antérieur est une demande nationale déposée avant, et publiée après, la date de dépôt de la demande de brevet européen en question.
Les droits nationaux antérieurs ne sont pas considérés comme état de la technique dans le cadre de l’examen européen de fond, mais peuvent être invoqués dans les procédures nationales pour révoquer le brevet européen dans le pays où la demande nationale antérieure a été déposée, conformément à l’art. 139(2) CBE. Pour traiter un droit national antérieur dans un pays particulier, les demandeurs peuvent déposer des jeux de revendications distincts pour ce pays avant la fin de l’examen européen, conformément à la règle 138 CBE.
La division d’examen transmettra tout droit national pertinent accompagné d’une notification selon la règle 71(3) CBE informant de l’intention de l’OEB de délivrer un brevet européen.
Ce nouveau service proposé par l’OEB vise à aider les demandeurs à prendre des décisions éclairées lorsqu’ils envisagent de demander un brevet unitaire, lequel ne permet qu’un seul jeu de revendications pour l’ensemble des États membres participants.
Plus de détails sur cette recherche complémentaire sont disponibles à l’adresse : https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html.
JUB et exemption Bolar
La « Bolar exemption » trouve son fondement juridique dans la directive européenne 2004/27/CE modifiant la directive 2001/83/CE portant code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. L’article 10(6) de la directive 2001/83/CE indique :
5-8 octobre 2022
PTMG Autumn Conference 2022
5 – 8 Octobre 2022
LAVOIX sera présent à la Conférence d’automne de PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group) à Lisbonne (Portugal).
20-23 septembre 2022
Marques 36th Annual Conference
20 – 23 Septembre 2022
LAVOIX participe à la 36ème conférence annuelle de MARQUES à Madrid (Espagne).
Double protection entre brevet national et brevet européen avec ou sans effet unitaire
Le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») sera prochainement introduit. La phase finale des travaux préparatoires sera achevée d’ici la fin de cet été et l’Allemagne déposera alors la dernière ratification manquante.
Changement législatif au Canada
De nouvelles règles relatives aux taxes de revendication et au nombre de notifications d’examen entreront en vigueur au Canada le 3 octobre 2022.
- Nombre de revendications et évolution des règles
Actuellement, aucune taxe de revendication n’est due au Canada.
Selon les nouvelles règles, toute revendication au-delà de vingt (20) sera soumise au paiement d’une taxe de revendication.
Le nombre de revendications au moment du dépôt de la requête en examen est pris en compte pour déterminer les taxes de revendication dues à ce moment-là.
Si des modifications augmentant le nombre de revendications sont apportées au cours de l’examen, le nombre le plus élevé de revendications déposées à un moment quelconque de l’examen sera pris en considération pour déterminer le nombre final de taxes de revendication dues lors de la délivrance du brevet.
- Nombre de notifications et nouvelles règles
Pour l’instant, il n’y a pas de limite au nombre de notifications d’examen.
Selon les nouvelles règles, le demandeur pourra recevoir jusqu’à trois notifications d’examen.
Pour poursuivre l’examen, le demandeur devra demander la poursuite de l’examen (RCE) et payer une nouvelle taxe d’examen. Après le dépôt de la première RCE, une RCE supplémentaire sera nécessaire toutes les deux notifications d’examen.
- Calendrier à prendre en compte
Les nouvelles règles s’appliqueront aux demandes dont l’examen est demandé à partir du 3 octobre 2022 inclus. Cela s’appliquera aux demandes nationales, aux phases nationales des demandes internationales (PCT) et aux demandes divisionnaires.
- Stratégie à adopter
Si vous souhaitez éviter ces nouvelles règles pour une demande de brevet spécifique, il est donc recommandé de demander l’examen avant le 30 septembre 2022.
Vous pouvez envisager d’anticiper le dépôt au Canada des demandes nationales sous priorité, des demandes internationales et des demandes divisionnaires.
Des stratégies peuvent être étudiées pour limiter le nombre de revendications. La rédaction de revendications incluant des alternatives ou de revendications dépendantes à dépendance multiple est par exemple envisageable.
Des amendements peuvent être déposés pour réduire le nombre de revendications à tout moment avant ou lors du dépôt de la requête en examen.
N’hésitez pas à contacter nos professionnels en cas de questions sur ces nouveaux changements ou pour discuter de la stratégie à adopter.
L’Allemagne a déposé sa ratification de l’Accord JUB
L’Allemagne a ratifié l’Accord JUB le 17 février 2023, voir ici.
Cela signifie que l’Accord JUB entrera en vigueur le 1er juin 2023. L’Accord JUB est l’une des évolutions les plus importantes du paysage des brevets en Europe depuis plus de 40 ans.
En conséquence, la période de « sunrise » pour déposer une demande d’opt-out débute le 1er mars 2023. Cela signifie que les titulaires de brevet EP, de demande de brevet EP ainsi que de CCP peuvent à partir de cette date déposer une demande d’opt‑out conformément à l’article 83(3) de l’Accord JUB afin de se retirer de la compétence de la JUB. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre blog, voir.
Depuis le 1er janvier, un report de délivrance et une demande anticipée d’effet unitaire sont disponibles auprès de l’OEB. Pour les brevets pour lesquels un report de délivrance a été demandé, la délivrance sera publiée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord JUB ou après.
L’OEB accueille le Monténégro comme nouvel État membre
Le Monténégro a accompli la dernière étape vers son adhésion à la Convention sur le brevet européen le 15 juillet 2022, et deviendra ainsi le 39ᵉ État membre de l’Organisation européenne des brevets à compter du 1er octobre 2022.
1. Jusqu’à présent, le Monténégro avait le statut d’État d’extension et il était donc possible d’étendre au Monténégro la protection conférée par les demandes ou brevets européens moyennant le paiement de la taxe d’extension correspondante dans les six mois suivant la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européen, ou, le cas échéant, dans le délai requis pour l’entrée d’une demande internationale en phase européenne.
Le système d’extension reste applicable aux demandes de brevet européennes et internationales déposées avant la fin de l’Accord d’extension pertinent ainsi qu’aux brevets européens délivrés sur la base de telles demandes.
2. Il sera possible de solliciter une protection au Monténégro en tant qu’État désigné par le paiement de la taxe de désignation pour toutes les demandes de brevet européennes et internationales déposées à compter du 1er octobre 2022.
3. La liste actuelle des États membres de l’OEB avec leurs dates d’adhésion correspondantes peut être consultée à l’adresse : https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html.
Cette alerte PI est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas un avis juridique.
Données personnelles Mai – Juin 2022
Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période mai-juin 2022.
1. Actualités de la CNIL
Publication du rapport d’activité 2021
Le rapport annuel d’activité de la CNIL pour l’année 2021 a été publié le 11 mai dernier.
Ce rapport dresse notamment le bilan de l’activité répressive de la CNIL, à savoir un montant cumulé d’amendes inédit dépassant les 214 millions d’euros, et un nombre majoritaire de mises en demeure portant sur les cookies. Enfin, le rapport constate l’implication grandissante de la CNIL dans les travaux du CEPD et les préoccupations européennes, dont les transferts de données hors UE.
Mise en demeure de vingt-deux communes de désigner un délégué à la protection des données
Par une délibération du 5 mai 2022, la CNIL a mis en demeure 22 communes de procéder à la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) doté notamment de qualités d’expertise, d’indépendance et de moyens suffisants. Cette désignation est obligatoire pour les autorités et organismes publics selon l’article 37 du RGPD. Ces mises en demeure ont été rendues publiques en raison de la sensibilité des missions des communes et des données traitées.
Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion a récemment publié une étude sur le métier de DPO, mettant en évidence ses dynamiques et évolutions entre 2019 et 2021. Cette étude constate notamment l’augmentation du nombre de DPO en 2021, la diversification des profils, et précise les caractéristiques du métier dont une majorité de DPO internes ou mutualisés entre plusieurs entités.
Recommandations pour mettre son outil de mesure d’audience Google Analytics en conformité avec le RGPD
La CNIL publie des recommandations de mise en conformité au RGPD à destination des sites web utilisant les traceurs de mesure d’audience Google Analytics, compte tenu des transferts de données hors UE qu’ils impliquent et de l’invalidation en 2020 par la Cour de Justice de l’UE du Privacy Shield (cadre juridique de transfert de données entre l’UE et les USA).
La CNIL suggère le recours à la proxyfication, c’est-à-dire l’utilisation d’un serveur mandataire permettant une pseudonymisation avant export des données. Elle considère les mesures suivantes comme nécessaires pour limiter le transfert de données :
• L’absence de transfert de l’adresse IP vers les serveurs de l’outil de mesure ;
• Le remplacement de l’identifiant utilisateur par le serveur de proxyfication ;
• La suppression de l’information de site référent externe au site ;
• La suppression de tout paramètre contenu dans les URL collectées ;
• Le retraitement des informations pouvant participer à la génération d’une
empreinte
• L’absence de toute collecte d’identifiant entre sites ou déterministe ;
• La suppression de toute autre donnée pouvant mener à une réidentification.
Publication des premiers critères d’évaluation sur les cookies walls
La CNIL publie des premiers critères d’évaluation de la légalité des cookies walls, c’est-à-dire des bannières cookies conditionnant « l’accès à un service à l’acceptation, par l’internaute, du dépôt de certains traceurs sur son terminal (ordinateur, smartphone, etc.) ». Dans la majorité des cas, l’accès au site sans l’acceptation de certains traceurs est conditionné par le paiement d’une somme d’argent.
Les critères permettant d’évaluer la légalité des cookies walls sont les suivants :
• La proposition d’une alternative réelle et équitable permettant d’accéder au site ;
• En cas d’alternative payante, le tarif doit être raisonnable et prendre en compte des modes de consommation adaptés (pas nécessairement sous la forme d’un abonnement). Par exemple, la création d’un compte devant poursuivre des objectifs déterminés et transparents pour l’internaute ;
• Le cookie wall doit être limité aux finalités permettant une juste rémunération du service.
La responsabilité au regard du RGPD dans le cadre d’une commande publique
La CNIL publie un guide en matière de commande publique, destinés aux opérateurs économiques de marchés publics et aux administrations.
Ce guide a vocation à faciliter l’exercice de qualification de responsable de traitement, sous‑traitant ou responsable conjoint, et précise le partage des responsabilités entre l’administration et les opérateurs économiques. Les recommandations sont notamment adaptées à l’objet des contrats de marchés publics et la nature des traitements liés.
2. Actualités légales et jurisprudentielles – France
La Cour d’appel de Paris déboute une ancienne salariée de sa demande de communication de l’intégralité de sa messagerie professionnelle
Par une décision du 12 mai 2022 (CA Paris, Pôle 6, chambre 2, 12 mai 2022, n°21/02419), la Cour d’appel de Paris a confirmé une décision du Conseil de Prud’hommes de Melun ayant débouté une ancienne salariée de ses demandes formulées à l’encontre de son ancien employeur, sollicitant la communication de l’intégralité de son dossier personnel, y compris le contenu intégral de sa messagerie électronique professionnelle.
La Cour d’appel a tenu compte de l’impossibilité matérielle de faire droit à cette demande, la boîte mail de l’intéressée ayant été depuis détruite par l’employeur conformément au délai fixé dans sa politique données personnelles.
La CNIL prononce une amende de 1 millions d’euros à l’encontre de TOTALENERGIES ELETRICITE ET GAZ FRANCE
La sanction a été prononcée par une délibération du 23 juin 2022 de la formation restreinte de la CNIL.
La CNIL a condamné le fournisseur d’énergies à raison de deux séries de manquements :
• Manquement à l’obligation de permettre aux personnes de s’opposer à l’utilisation de leurs données à des fins prospection commerciale : le formulaire de souscription au contrat d’énergie mentionnait en effet que le souscripteur acceptait que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, sans offrir la possibilité de refuser ;
• Manquements à l’obligation d’information, notamment des personnes démarchées par téléphone, et au respect de l’exercice des droits, la société ne répondant pas aux demandes d’exercice de droit dans le délai approprié.
L’Autorité a néanmoins tenu compte, pour fixer le montant de l’amende, des efforts engagés par la société tout au long de la procédure afin de se mettre en conformité avec les exigences du RGPD.
Le Conseil d’Etat confirme l’amende de 35 millions d’euros prononcée par la CNIL à l’encontre d’Amazon
Par une décision du 27 juin 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours d’Amazon Europe Core et validé la sanction prononcée par la CNIL à son encontre par délibération du 7 décembre 2020, à savoir une amende de 35 millions d’euros à raison du dépôt automatique et sans consentement préalable de cookies sur le terminal de l’internaute visitant son site amazon.fr, et de l’insuffisance des informations contenues dans la bannière cookies.
Le Conseil d’Etat a estimé que le manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés était caractérisé, et a constaté l’absence d’incidence des positions divergentes d’autres Autorités européennes pour interpréter les conditions et modalités du recueil du consentement au regard du droit applicable. Il a également été retenu que le montant de la sanction était proportionné compte tenu de la mise en balance de la gravité du manquement, l’ampleur des traitements réalisés grâce aux cookies, la nature potentiellement sensible des données obtenues, l’avantage financier retiré par Amazon et son chiffre d’affaires mondial.
3. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe & international
Le CEPD publie des lignes directrices sur le calcul des amendes RGPD
Ces lignes directrices ont pour objectif d’harmoniser les sanctions prononcées en Europe, grâce à une méthodologie à destination des autorités de contrôle. Le calcul des amendes est réalisé en cinq étapes :
• Identification des opérations de traitement ;
• Détermination du point de départ du calcul de l’amende ;
• Evaluation des circonstance aggravantes et atténuantes au regard du
comportement de la personne visée ;
• Identification des maximums légaux pertinents pour les différentes infractions ;
• Analyse de la concordance entre les montants finaux calculés et les exigences d’efficacité, de dissuasion et de proportionnalité.
Le CEPD publie des lignes directrices sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les autorités publiques
Afin de répondre à l’augmentation de l’utilisation par les administrations publiques et aux risques relatifs à la protection des libertés fondamentales, le CEPD communique ses lignes directrices à destination des décideurs publics et rédacteurs de textes législatifs.
Le CEPD précise notamment qu’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données) est requise avant le commencement du traitement de données. De plus, le CEPD appelle à l’interdiction de certaines formes de traitement comme l’identification biométrique à distance de personnes dans des espaces accessibles au public, la reconnaissance faciale par intelligence artificielle classant les individus en fonction de leurs données biométriques dans des groupes selon leur ethnie, sexe, orientation politique ou sexuelle, la déduction des émotions, le traitement de données personnelles réalisé dans un contexte répressif via une collecte massive de données.
Nouveau Privacy Shield : date d’entrée en vigueur annoncée à début 2023
Le nouveau cadre juridique de transfert de données entre l’UE et les USA, censé remplacer le Privacy Shield invalidé en 2020 par la Cour de Justice de l’UE, est attendu pour le premier trimestre 2023 selon Reuters.
Belgique : sanction d’un groupe de presse pour sa gestion des cookies
Par une décision du 25 mai 2022, l’Autorité de contrôle belge a infligé une amende de 50 000 euros à l’encontre du groupe de presse Roularta pour plusieurs manquements liés au recueil du consentement concernant les cookies.
Il a été constaté que deux sites web gérés par le groupe ne respectaient pas les critères en ce que le consentement n’était pas requis préalablement à la collecte de données, l’utilisateur n’était pas suffisamment informé du traitement et le consentement était équivoque (cases pré-cochées).
Royaume-Uni : réforme de la législation sur les données personnelles
Par une communication du 10 mai 2022, le gouvernement britannique a présenté dans les grandes lignes la prochaine législation en matière de protection des données personnelles.
Les objectifs affichés sont, notamment, de tirer profit du Brexit pour créer un cadre juridique mondial sur les données, moderniser et attribuer des pouvoirs plus importants à l’autorité de contrôle, et faciliter l’accès aux données de santé.
Article rédigé par : Caroline ALET, Alix CAPELY et Camille PECNARD
METAVERS : Quelle protection pour les marques et modèles dans un univers virtuel ?
Les Métavers sont un nouveau lieu d’échange, non seulement pour des activités ludiques mais également pour des activités commerciales. Des marques et des produits connus sur les marchés traditionnels sont proposés aux utilisateurs du Métavers.
Une nouvelle tendance consiste à utiliser le Métavers comme base de lancement de nouveaux produits en particulier par le biais d’un NFT (Non Fungible Token) qui représente l’image virtuelle d’un produit présent sur le marché traditionnel. Ainsi, l’acquéreur d’un NFT représentant l’image d’un produit, pourra retirer son produit physiquement sur présentation du NFT, le NFT servant de preuve pour établir la propriété du produit acheté, de preuve d’authenticité et du droit de se faire livrer le produit sur demande.
Il existe ainsi une certaine porosité entre les marchés traditionnels et le monde virtuel des Métavers.
Par conséquent comment se protéger contre la reprise d’une marque ou d’un modèle dans le Métavers ? Inversement, une marque ou la représentation d’un produit qui aurait été créé dans le Métavers peuvent-ils être protégés contre leur reprise sur les marchés traditionnels ?
Face à ce nouveau défi économique, quelle stratégie mettre en œuvre pour protéger les marques et les créations ?
Les marques sont généralement déposées pour les produits pour lesquels elles sont destinées à être utilisées, par exemple, des vêtements, chaussures, parfums, articles de sport. Cette protection est-elle suffisante pour un usage de marque dans le Métavers ?
L’usage de la marque dans le Métavers peut être effectué à différents titres :
• Usage pour la promotion d’un produit commercialisé sur le marché traditionnel, et/ou
• Usage pour l’offre ou la vente de NFT représentant l’image virtuelle d’un produit, sur le Métavers.
Une entreprise pourrait proposer aux consommateurs d’acquérir sous la même marque à la fois le produit réel et le NFT représentant l’image virtuel de ce produit.
Dans un tel cas, il convient d’adapter la protection de la marque au marché sur lequel elle doit être utilisée, étant entendu qu’il s’agit ici d’un usage dans la vie des affaires.
Ainsi, il conviendra d’étendre la protection de la marque aux produits et services proposés sur le Métavers, tels que les images numériques de chaussures, des programmes informatiques, des services de présentation de produits par l’intermédiaire d’images virtuelles en vue de leur mise en vente et des services de présentation d’images virtuelles de produits à des fins récréatives ou d’enseignement.
Les marques utilisées sur le Métavers devront également être protégées contre leur utilisation non seulement dans le monde virtuel mais également contre leur utilisation dans le commerce traditionnel.
Quant aux modèles, s’ils sont nouveaux et présentent un caractère propre / individuel, il conviendra d’examiner l’opportunité de les déposer non seulement pour le produit « réel » (par exemple pour des chaussures) et également pour la représentation numérique de l’image du produit (par exemple l’image virtuelle de la chaussure).
Des modèles pourront également être déposés pour la représentation des avatars, des environnements virtuels, et également des logos lorsque ceux-ci font l’objet d’un usage à titre décoratif dans le Métavers.
Une surveillance doit également être mise en place pour s’assurer que des tiers n’utilisent pas la marque ou le modèle à l’insu de leur propriétaire.
Outre les surveillances sur les places de marché de type Amazon ou Alibaba, notamment, il convient de mettre en place des surveillances sur les plateformes de vente de NFT, tels qu’OpenSea, afin de pouvoir identifier et faire cesser la vente de NFT représentant des images virtuelles de produits de marques, bien souvent sous des comptes identifiés avec la marque du titulaire, à l’insu de celui-ci.
Création d’un brevet européen à effet unitaire
Qu’est-ce que le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet ? Qu’est-ce que cela va changer pour les titulaires de brevets européens ? Qu’est-ce que l’«opt out»?
3 questions à Damien Colombié, Conseil en Propriété Industrielle et Camille Pecnard, Avocat à la Cour chez LAVOIX
Pour lire l’article de La Semaine Juridique en intégralité, rendez-vous en page 5 et 6 de leur hebdomadaire en cliquant ici.
Enquête de l’OEB sur la période de grâce
1. L’Office européen des brevets a récemment publié le résultat d’une enquête concernant une période de grâce en matière de nouveauté.
À ce jour, la CBE exige une nouveauté absolue pour l’objet des brevets européens, de sorte qu’une divulgation de l’objet revendiqué avant le dépôt de la demande de brevet européen est opposable au brevet, que cette divulgation provienne ou non du demandeur.
D’autres juridictions (par ex. États‑Unis et Japon) prévoient des systèmes de période de grâce permettant d’obtenir des brevets valides même si l’objet revendiqué a été divulgué par le demandeur avant le dépôt de la demande.
L’enquête évalue l’impact du système strict actuel et l’impact potentiel d’un système incluant une période de grâce.
2. La plupart des utilisateurs du système de délivrance de l’OEB sont conscients des contraintes et, si nécessaire, se conforment à l’exigence en reportant la divulgation de leur invention. Les organisations de recherche (universités) sont celles qui subissent le plus fort impact négatif du système actuel, en raison de leur besoin de publier tôt les résultats de recherche.
Les universités présentent également le taux le plus élevé de demandes EP empêchées en raison d’une divulgation antérieure au dépôt. Après elles, ce sont les entreprises américaines dont les demandes sont empêchées du fait de divulgations préalables.
3. Les PME européennes, les universités et les entreprises japonaises/coréennes sont les plus touchées par les divulgations retardées, avec des taux d’impact négatif de 68 %, 71 % et 82 % respectivement.
Les organismes de recherche publics (PRO), les universités européennes et les entreprises japonaises/coréennes sont les plus touchés par les divulgations avant dépôt, avec des taux d’impact négatif de 100 %, 95 % et 99 % respectivement.
4. Le rapport présente également les avantages possibles et les inconvénients de quatre systèmes de période de grâce : un système illimité dans lequel le demandeur n’a aucune formalité supplémentaire à accomplir ; un système basé sur une déclaration dans lequel le demandeur doit déclarer la divulgation antérieure ; un système de droits de l’utilisateur antérieur dans lequel l’utilisation fondée sur la divulgation antérieure ne constitue pas une contrefaçon ; et un système de filet de sécurité combinant les deux précédents.
Il reste à voir si la CBE sera modifiée à l’avenir, et le cas échéant dans quelle mesure.
L’enquête complète est disponible ici.
Cette alerte PI est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas un avis juridique.
15-18 juin 2022
Lavoix présent au salon VivaTech
Retrouvez les équipes LAVOIX au Salon Viva Technology sur le stand G62 du mercredi 15 juin au samedi 18 juin à Paris Expo Porte de Versailles.
30 juin 2022
Petit déjeuner – Brevet Unitaire et Juridiction Unifiée du brevet
L’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet, commune à la majorité des États européens, va entrer en vigueur dans les mois à venir.
Vous aurez très bientôt la possibilité d’utiliser le Brevet Européen à effet unitaire, qui coexistera avec les brevets nationaux (dont le brevet français) et le Brevet Européen actuel.
Ces nouveaux outils constituent une évolution majeure pour le droit des brevets en Europe, dont il convient d’anticiper dès maintenant les conséquences sur votre Propriété Industrielle. Notamment en termes de coûts et de portée territoriale.
Camille PECNARD, Avocat à la Cour et Damien COLOMBIE, Conseil en Propriété Industrielle présenteront en détail le Brevet Européen à effet unitaire et la JUB lors d’un petit déjeuner conférence le jeudi 30 juin 2022 à 8h30.
10-13 septembre 2022
AIPPI World Congress
10 – 13 Septembre 2022
LAVOIX sera présent à l’AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) World Congress à San Francisco (Etats-Unis).
L’OEB publie la deuxième édition du Guide du brevet unitaire
Contexte
Il est prévu que l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (AJUB) entre en vigueur fin 2022 ou début 2023. En même temps, les règlements (UE) 1257/2012 et 1260/2012 entreront en vigueur concernant le brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire) et les modalités de traduction.
Le Comité restreint du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets a préparé la législation secondaire, en particulier les règles de procédure relatives à la protection unitaire conférée par un brevet et les règles relatives aux taxes pour la protection unitaire. Récemment, certaines de ces règles ont été mises à jour en même temps que le Guide du brevet unitaire.
Guide du brevet unitaire
Le Guide du brevet unitaire explique en détail la procédure auprès de l’OEB pour obtenir un brevet unitaire et les procédures annexes.
Il fournit notamment :
- des informations générales sur le brevet unitaire (Section A) ;
- des détails sur la manière et le moment de déposer la demande de protection unitaire et sur les informations à fournir à l’OEB (Section B) ;
- le régime de compensation pour certaines PME et organisations (Section C) ;
- la manière et le moment de payer les taxes annuelles (Section D) ;
- les publications de l’OEB concernant le brevet unitaire, en particulier le contenu du registre et la consultation du dossier (Section E) ;
- des détails sur l’enregistrement des transferts, licences et autres droits, ainsi que sur le dépôt de déclarations de licences de droit (Section F) ;
- d’autres questions procédurales comme le régime linguistique, la représentation et le paiement des taxes (Section G) ;
- les voies de recours contre les décisions de l’OEB, en particulier le rôle de la Juridiction unifiée du brevet et la révision préjudicielle par l’OEB (Section H) ; et
- les mesures transitoires.
La version HTML du Guide du brevet unitaire est régulièrement mise à jour.
Breaking News : Première décision d’opposition en France
La première décision en opposition en France a été émise hier par l’INPI, dans l’affaire KRONES AG contre SIDEL PARTICIPATIONS.
Dans ce cas, KRONES AG demandait la révocation totale du brevet FR 3 070 795 B1 déposé en 2018 et publié en 2020 pour plusieurs motifs parmi lesquels un défaut d’activité inventive. Ce motif a conduit à une décision de maintien du brevet FR 3 070 795 B1 sous forme modifiée.
La procédure d’opposition devant l’INPI offre ainsi aux tiers une alternative plus simple et moins coûteuse que l’action judiciaire, jusqu’alors unique procédure pour contester un brevet. Elle permet aux tiers de demander la révocation d’un brevet français dans un délai de neuf mois à compter de la date de délivrance notamment pour absence de nouveauté ou défaut d’activité inventive.
Cette nouvelle procédure instituée depuis avril 2020 par la loi PACTE permet d’aligner le droit français sur les pratiques d’autres offices européens et internationaux tels que l’OEB, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, ou encore les Etats-Unis.
LAVOIX est impliqué dans plusieurs procédures d’opposition pendantes en France. Vos interlocuteurs LAVOIX sont à votre disposition pour toute question sur le sujet.
Intelligence artificielle et secteur de l’énergie
L’intelligence artificielle est partout aujourd’hui mais peut-on la breveter dans tous les secteurs technologiques ?
Des possibilités de protection d’un outil d’intelligence artificielle relatif au secteur médical et des transports avaient été analysées dans deux précédentes IP Alert.
Posons-nous à présent cette question pour le domaine de l’énergie qui est le quatrième secteur comptabilisant le plus de dépôts européens en 2021 (voir ici les statistiques de l’Office Européen des Brevets d’avril 2022).
Des technologies d’intelligence artificielle se retrouvent-elles dans des inventions relatives au domaine de l’énergie ?
La réponse est oui. A cet effet, nous avons identifié quatre brevets de ce domaine ayant fait l’objet d’une délivrance et dont la revendication 1 porte sur l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle appliqué sur des données d’entrée pour obtenir une estimation de données de sortie souhaitées, comme illustré par le tableau suivant :
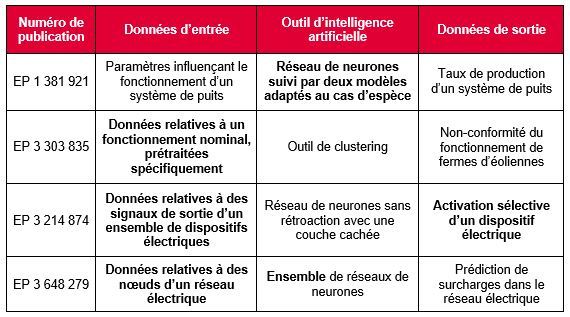 Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.
Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.
Les exemples précités mettent en évidence que le secteur de l’énergie utilise les développements de l’intelligence artificielle, et ce notamment avec la mise en œuvre de la transition écologique.
Toutefois, la brevetabilité de ces exemples n’est pas essentiellement liée à cette application. La brevetabilité est en effet conférée par des données d’entrée/sortie originales et/ou l’emploi d’un outil d’intelligence artificielle spécifique. Ceci est valable quel que soit le type d’énergie considéré.
Ainsi, comme vu précédemment pour le secteur médical ou celui des transports, protéger un outil d’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie est tout à fait possible. Pour cela, il convient d’identifier un élément original parmi les données d’entrée/de sortie et/ou l’outil d’intelligence artificielle (type d’outil et/ou manière d’obtenir l’outil).
Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous aider à une telle identification.
Données personnelles Mars-Avril 2022
Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période mars-avril 2022.
1. Actualités de la CNIL
La CNIL publie un guide pratique à destination des délégués à la protection des données (DPO)
Dans un objectif d’accompagnement des DPO et en complément de la documentation déjà disponible, la CNIL publie un guide pratique.
La CNIL développe quatre notions sous formes de questions concrètes et de méthodologie de réflexion : le rôle du DPO, la désignation du DPO, l’exercice des fonctions du DPO, et l’accompagnement des DPO par la CNIL.
Sont notamment annexés un modèle de lettre de mission (p. 45) et un mode d’emploi de l’outil de désignation du DPO (p. 47).
Trois organismes sont mis en demeure pour des transmissions de données de prospection commerciale entre partenaires sans recueil du consentement
La CNIL a mis en demeure trois organismes qui collectaient et transmettaient les coordonnées de personnes physiques à des partenaires souhaitant effectuer de la prospection commerciale par SMS et courriers électroniques, et ce sans recueillir le consentement préalable des personnes concernées.
La CNIL indique que les organismes visés disposent de trois mois pour se mettre en conformité.
La CNIL sanctionne la société DEDALUS Biologie d’une amende de 1,5 millions d’euros (fuite de données médicales de près de 500 000 personnes)
Par délibération du 15 avril 2022, la société DEDALUS, développant et commercialisant des solutions logicielles pour des laboratoires d’analyse biologique, a été sanctionnée par la CNIL à hauteur de 1,5 millions d’euros, en raison de la violation de son obligation d’assurer la protection des données prévue par l’article 32 du RGPD ainsi qu’au titre de l’article 29 (obligation du sous-traitant de suivre les instructions du responsable de traitement) et de l’article 28 du RGPD (obligation d’encadrer par un acte juridique la relation entre le sous-traitant et le responsable de traitement).
Cette sanction intervient suite à une fuite de données signalée en février 2021, ayant entraîné plusieurs contrôles de la CNIL et un blocage par le tribunal judiciaire de Paris de l’accès au site divulguant les données en question suite à une saisine de la CNIL.
L’injonction prononcée à l’encontre de SPARTOO est clôturée
La CNIL a clôturé le 31 mars 2022 l’injonction prononcée à l’encontre de la société SPARTOO par délibération publique du 28 juillet 2020.
Outre le paiement d’une amende de 250 000 euros, la société devait se mettre en conformité au RGPD afin de respecter les principes de minimisation (article 5.1, c) du RGPD), la conservation limitée des données (article 5.1, e) du RGPD), la finalité des traitements (article 5.1, b) du RGPD), l’information des salariés et des clients (article 13 du RGPD), ainsi que l’adoption de mesures de sécurité satisfaisantes (article 32 du RGPD).
La CNIL a considéré que les mesures prises étaient adéquates et a, dès lors, levé l’injonction.
La CNIL publie des ressources sur l’IA afin d’accompagner les professionnels dans leur mise en conformité
La CNIL accompagne les professionnels mettant en œuvre des traitements de données personnelles grâce à des outils basés sur l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, elle a décidé de mettre à disposition des guides et articles dédiés, destinés à être complétés et mis à jour, portant notamment sur l’intelligence artificielle, la conformité RGPD spécifique à ce secteur et des méthodes d’auto-évaluation.
Les responsables de traitements et sous-traitants sont encouragés à utiliser des termes plus clairs
Afin de respecter le principe de transparence, l’article 12 du RGPD impose de fournir une information « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples ».
La CNIL fournit ainsi des précisions et des exemples précis, considérant que les termes juridiques peuvent être incompris du grand public.
2. Actualités légales et jurisprudentielles – France
Les signalements effectués dans le cadre du dispositif de lanceurs d’alerte sont soumis au respect du RGPD
Le régime des lanceurs d’alerte avait été enrichi par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte modifie les dispositions de la loi de 2016, notamment concernant les traitements de données personnelles en précisant que « les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires » (article 5 de la loi de 2022 modifiant l’article 9 de la loi de 2016).
La chambre sociale de la Cour de cassation retient que le RGPD n’implique pas le refus de communiquer à l’expert-comptable les documents demandés
Par un arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a précisé la compétence de l’expert-comptable s’agissant de sa demande de communication d’une base de données non nominative du personnel. La chambre sociale retient que le RGPD ne peut pas constituer un fondement valable pour refuser de communiquer à l’expert-comptable les documents demandés. Il convient plutôt de vérifier si ces documents existent, puis si leur établissement est obligatoire pour l’entreprise.
L’Assurance maladie communique sur une fuite de données personnelles concernant amelipro
Par communiqué du 17 mars 2022, l’Assurance maladie a indiqué avoir subi une violation de données personnelles sur son service amelipro destiné aux professionnels de santé.
L’Assurance maladie a précisé avoir pris un certain nombre de mesures de sécurité afin de faire cesser la violation, notamment en bannissant les adresses IP concernées et en réinitialisant les comptes des professionnels de santé. Cette communication répond à l’obligation de notification de toute violation de données aux personnes concernées (art. 34 RGPD). La CNIL a également été notifiée de la violation (art. 33 RGPD).
3. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe & international
Le CEPD publie de nouvelles lignes directrices sur l’application de l’article 60 du RGPD
L’article 60 du RGPD met en place un mécanisme de guichet unique permettant à une autorité de contrôle désignée de diligenter les enquêtes sur les traitements de données transfrontaliers, tout en coopérant avec ses homologues européens, lesquels restent le point de contact du plaignant.
Par ses lignes directrices publiées le 14 mars dernier, le CEPD (Comité européen de la protection des données) s’attache à clarifier l’article 60 et les contours de la procédure de coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées, complétant son analyse par un guide synthétique de la procédure de guichet unique.
Le CEPD alerte sur les dark patterns
Les dark patterns sont des interfaces truquées, intégrées à d’autres interfaces. L’objectif de ces outils est de tromper l’utilisateur en le poussant à prendre des décisions non réfléchies et dommageables pour lui-même au profit de l’entreprise ayant créé l’interface. Les dark patterns permettent notamment de recueillir des données personnelles, par exemple en dissimulant des informations ou en incitant fortement le consentement de l’utilisateur, contrevenant ainsi à l’article 5 du RGPD. Les bandeaux d’acceptation de cookies peuvent constituer des dark patterns.
Le CEPD a donc publié des lignes directrices sur l’utilisation des dark patterns sur les réseaux sociaux en proposant des recommandations pour les responsables de traitement et également les utilisateurs de réseaux sociaux, grâce à des cas pratiques.
Accord de principe en remplacement du Privacy Shield
En application de l’article 45 du RGPD, le Privacy Shield était une décision d’adéquation prise en 2016 par la Commission européenne et encadrant les transferts de données personnelles entre l’Union européenne et les responsables de traitements ou sous-traitants basés aux Etats-Unis. La CJUE avait invalidé cette décision le 16 juillet 2020 par un arrêt dit « Schrems II », estimant que le niveau de protection offert aux ressortissants européens n’était pas assez élevé.
Le 25 mars 2022, la Commission européenne et les Etats-Unis sont parvenus à un accord de principe, mettant en avant de nouvelles garanties de nécessité et proportionnalité des politiques de surveillance américaines.
Le système de certification serait conservé, accompagné de procédures de contrôle effectif, et un tribunal dédié serait créé afin de recevoir les plaintes des ressortissants européens.
La CJUE confirme que les associations de protection des consommateurs peuvent agir en justice contre l’auteur présumé d’une violation du RGPD
L’affaire concerne la plateforme Meta à l’encontre de qui une association allemande de défense des intérêts des consommateurs avait souhaité agir en justice.
La CJUE fait application de l’article 80, §2 du RGPD et retient, par un arrêt du 28 avril 2022, que les associations de consommateurs ont qualité à agir même en l’absence de mandat et sans qu’il y ait une identification individuelle et préalable de la personne concernée par la violation du RGPD.
La CNIL irlandaise sanctionne Meta
Constatant une violation des articles 5 (transparence des informations) et 24 du RGPD (obligations du responsable de traitement), l’Autorité de contrôle irlandaise a sanctionné la société Meta Platforms, anciennement Facebook Ireland Limited, d’une amende de 17 millions d’euros par une décision du 15 mars 2022. L’enquête était intervenue dans le contexte de douze violations de données personnelles, à la suite desquelles l’Autorité avait vérifié si la société avait mis en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées.
La sanction est intervenue dans le cadre de la procédure de guichet unique prévue par l’article 60 du RGPD, les traitements concernés étant transfrontaliers. L’Autorité irlandaise agissait donc comme Autorité chef de file et sa décision est en accord avec les positions des autres Autorités ayant participé aux enquêtes.
La CNIL belge sanctionne de deux amendes les aéroports de Zaventem et Charleroi pour des contrôles de température par caméras thermiques
Dans le contexte de la crise sanitaire, les deux aéroports de Bruxelles avaient mis en œuvre un contrôle de température des passagers via des caméras thermiques identifiant ceux dépassant une température corporelle de 38°C. L’Autorité de contrôle belge les sanctionne pour défaut de base légale (article 6 du RGPD). L’Autorité s’était elle-même saisie lorsqu’elle avait appris par voie de presse l’existence de ce traitement.
S’agissant de données de santé, donc sensibles, les aéroports étaient tenus de démontrer une base légale claire et de mettre en œuvre le traitement à la suite d’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données), outil de responsabilisation des responsables de traitement en cas de traitement présentant des risques élevés. L’urgence de la crise sanitaire n’a pas suffi à justifier un tel traitement : les deux aéroports ont respectivement été condamnés à des amendes de 200 000 et 100 000 euros.
Article rédigé par : Caroline ALET, Jeanne BRETON, Alix CAPELY, Pierre-Emmanuel MEYNARD et Camille PECNARD
Dépôt record de demandes auprès de l’Office européen des brevets en 2021
Malgré la pandémie, les dépôts de demandes de brevet européen ont de nouveau augmenté. 188 600 demandes ont été reçues par l’Office européen des brevets (OEB) en 2021, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l’année précédente.
Il s’agit du plus grand nombre de demandes jamais déposées en une seule année. L’Indice des brevets 2021 de l’OEB montre que les dépôts ont fortement rebondi après une légère baisse en 2020 (-0,6 %).
De manière générale, le nombre de demandes de brevet est considéré comme un indicateur précoce de l’évolution des budgets de recherche et développement des entreprises dans le monde.
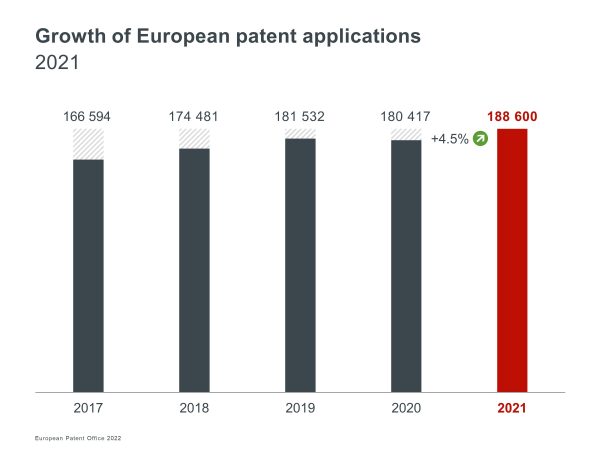
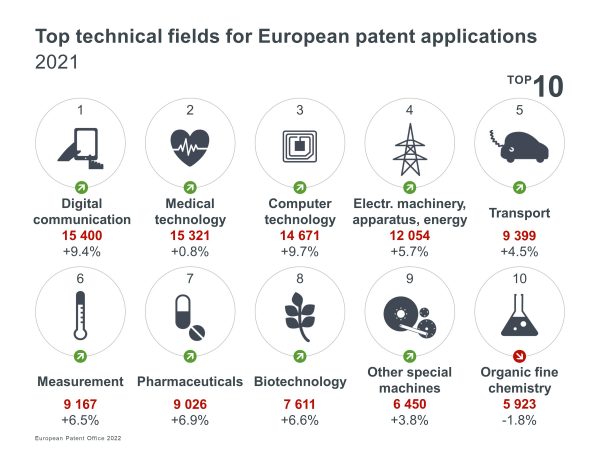
Source OEB
Pour les demandes déposées en 2021, les principaux pays d’origine étaient : États‑Unis (25 % du total), Allemagne (14 %), Japon (11 %), Chine (9 %) et France (6 %). Les dépôts sont fortement concentrés : cinq pays représentaient 64 % des demandes européennes en 2021 et les vingt premiers pays en totalisaient 95 %.
La plus forte croissance observée en 2021 provient des dépôts chinois (+24 % par rapport à 2020) et américains (+5,2 %). Les dépôts provenant de Corée du Sud ont également augmenté (+3,4 %), tandis que le Japon a connu une légère baisse (-1,2 %). Les demandes des 38 États membres de l’Organisation européenne des brevets ont connu une légère augmentation (+2,8 %). Cependant, la proportion des demandes européennes continue de diminuer, passant de 50 % du total en 2013 à 44 % en 2021. Cette tendance montre que le marché européen reste particulièrement attractif pour les entreprises non européennes, notamment asiatiques, qui souhaitent y protéger leurs inventions.
Conformément aux tendances générales, Huawei a été le premier déposant auprès de l’OEB en 2021 (comme en 2019), suivi par Samsung et LG aux deuxième et troisième places. Ericsson et Siemens ont gagné une place, se classant respectivement quatrième et cinquième. Le top 10 comprend quatre entreprises européennes, deux sud‑coréennes, deux américaines et une chinoise et japonaise.
Cette alerte PI est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas un avis juridique.
Quelle nationalité pour le brevet à effet unitaire ?
La nationalité du brevet en cas de copropriété est déterminée par l’article 7 du règlement 1257/2012 qui indique :
«1. En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l’État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:
a) le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou
b) lorsque le point a) ne s’applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.
2. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s’applique au premier codemandeur inscrit. À défaut, le paragraphe 1, point a), s’applique au codemandeur suivant, dans l’ordre d’inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s’applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s’applique en conséquence.
3. Si aucun demandeur n’est domicilié, n’a son principal établissement, ou n’a d’établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État dans lequel l’Office Européen des brevets a son siège, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CBE.
4. L’acquisition d’un droit ne peut pas dépendre d’une inscription à un registre national des brevets. »
Les solutions suivent ainsi le tableau suivant :
| Le brevet en copropriété, est conclu entre : | Nationalité du brevet |
| Deux acteurs du même Etat-membre de la JUB | Le brevet est de la nationalité des copropriétaires.
|
| Deux acteurs issus de deux Etats-membres différents de la JUB | Le brevet est de la nationalité du 1er titulaire inscrit au registre européen des brevets.
|
| Un Etat-membre de la JUB et un pays extérieur à l’Europe | Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.
|
| Un Etat-membre de la JUB et un Etat-membre de la CBE mais pas de la JUB
Liste des Etats-membres de la CBE mais pas de la JUB : Albanie, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Croatie, Islande, Italie, Liechtenstein, Monaco, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie, Saint-Marin, Turquie. |
Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.
|
| Un Etat-membre de la JUB et un Etat-membre de l’UE mais pas de la JUB
Liste des Etats-membres de l’UE mais pas de la JUB : Croatie, Espagne, Italie |
Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.
|
| Deux Etats-membres extérieurs à la JUB | Le brevet est soumis au droit allemand. |
Droit des brevets : un pas de plus en Europe vers davantage d’harmonisation
Vaccins, intelligence artificielle, télécoms… la question des brevets prend une place majeure en Europe pour ses entreprises comme pour les acteurs extra-européens attirés par ce marché unique de 450 millions de consommateurs. Dans ce contexte, un brevet européen à effet unitaire est en train de voir le jour tout comme une juridiction unifiée du brevet (JUB).
Pour lire l’article d’Option Droit et Affaires en intégralité, cliquez ici.
L’opt-out et sa réversibilité
L’opt-out : qu’est-ce ?
L’opt-out, prévu par l’article 83 de l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) permet de décider de déroger à la compétence exclusive de la JUB pendant une période transitoire de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB, renouvelable une fois.
Il sera possible de faire usage de cette dérogation dès avant le démarrage de la JUB, pendant une période préliminaire dite de « Sunrise Period ».
La possibilité d’opt-out n’est pas ouverte aux brevets à effet unitaire, mais concerne seulement les brevets européens et les demandes de brevets européens, sauf ceux pour lesquels une action aurait déjà été engagée devant la JUB.
Les formalités de l’opt-out sont très simples : une déclaration unique au greffe de la JUB suffit.
La déclaration d’opt-out doit être déposée par le titulaire effectif du brevet européen.
Cette déclaration au greffe peut être faite électroniquement via le « Case Management System » (système de gestion en ligne des procédures) mis à disposition par la JUB en utilisant un formulaire approprié.
Réversibilité de l’opt-out
Il est possible de revenir sur son choix d’opt-out sur demande depuis le système de gestion précité, pour chaque brevet individuellement. Le brevet n’apparaît alors plus dans le registre des opt-outs tenu par la JUB.
Ce retrait de l’opt-out est impossible si une juridiction nationale a déjà été saisie d’une action relevant de la compétence exclusive de la JUB.
Les actions qui ne sont pas de la compétence exclusive de la JUB, telles les actions relatives à la propriété du brevet européen ou aux contrats ayant pour objet un brevet européen, restent soumises aux juridictions nationales et n’empêchent pas de revenir sur une décision d’opt-out. Le retrait de l’opt-out est par principe définitif : aucun opt-out ne peut ultérieurement être effectué pour le brevet concerné.
L’opt-out ou son retrait : comment le corriger ?
La demande d’opt-out ou son retrait sont déclaratifs et ne sont pas contrôlés par le greffe de la JUB. C’est au moment du contentieux, que la juridiction saisie du litige pourra vérifier sa compétence en examinant la validité de la déclaration d’opt-out et de son éventuel retrait.
Il est possible de rectifier une demande d’opt-out ou son retrait par une demande de correction via le système de gestion en ligne des procédures. Toutes les informations fournies peuvent être modifiées, à l’exception du numéro de brevet : dans ce dernier cas, une nouvelle déclaration contenant le numéro correct devra être déposée.
L’opt-out est un acte juridique important déterminant votre politique en matière de contentieux. Il nécessite une tenue à jour des registres et implique une bonne maîtrise des outils informatiques de la JUB et notamment du « Case Management System », aucun contrôle n’étant effectué au moment de cette déclaration. Nos experts de LAVOIX se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.
Propriété intellectuelle : 10 conseils pour protéger vos créations
Comment protéger le fruit de ses réflexions et de son travail efficacement ?
Anne-Sophie Auriol, conseil en propriété industrielle chez LAVOIX, fait part de son expertise dans cet article de Maddyness sur la PI et les start-ups.
Pour lire l’article de Maddyness en intégralité, cliquez ici.
Cession de droit de PI à titre gratuit : le prix à payer
La cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit doit être qualifiée de donation, et à ce titre se conformer aux exigences propres à la matière. (Décision du TJ de Paris, 8 février 2022, No. 19/14142).
Il était ici question d’une marque et de dessins et modèles communautaires détenus par deux personnes physiques, MM. X et Z . Les droits ont été cédés en 2015 à la société A, dont M. Z est le seul associé et gérant.
Monsieur X a dénoncé, en 2018 la cession intervenue en 2015 et a assigné M. Z et la société A en nullité du contrat de cession.
Le tribunal Judiciaire de Paris a fait droit aux demandes de Monsieur X et a :
- Requalifié le contrat de cession de la marque et des dessins et modèles en donation ;
- Annulé celui-ci au motif du non-respect du formalisme imposé par l’article 931 du code civil.
En ce qui concerne la requalification en donation, celle-ci se justifie par le fait que le contrat conclu en 2015 emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit ».
S’agissant du formalisme à respecter, l’article 931 CC prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
La jurisprudence admet cependant deux dérogation à ce formalisme. La première est le cas des dons manuels qui imposent la remise physique de la chose donnée. La seconde concerne les donations déguisées ou indirectes dont il est admis que les conditions de forme suivent l’acte dont elles empruntent l’apparence.
Le code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune dérogation supplémentaire, mais uniquement que le transfert de propriété doit être constaté par écrit (article L. 714-1, alinéa 4 du CPI dans sa rédaction d’alors)
En l’occurrence, les choses cédées étant des droits incorporels et donc insusceptibles de remise physique, et l’acte de cession mentionnant clairement que le transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit », l’acte attaqué ne pouvait bénéficier d’aucune des deux dérogations.
Le tribunal en conclu, à juste titre, qu’il s’agit donc par définition d’une donation non dissimulée et portant sur des droits incorporels, de sorte qu’elle aurait dû être conclue devant notaire sous peine de nullité. Le contrat de cession est donc déclaré nul.
La cession en cause concernait des donataires « personnes physiques », toutefois une solution identique aurait pu être prononcée, à notre sens, s’il avait été question de donataires « personnes morales ». En effet l’article 902 du CC prévoit que « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables », ce qui n’exclue pas les personnes morales. Une telle appréciation a notamment été confirmée par la Cour de Cassation (C. Cass, com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-15.621).
La prudence est donc de mise dans le cadre de cessions de vos droits de propriété intellectuelle, et notamment en cas de cessions intra-groupe pour lesquelles il peut être tentant de s’affranchir d’une cession à titre onéreux. Les équipes de LAVOIX sont à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans ces démarches.
Lavoix élu cabinet CPI de l’année par le Palmarès du Droit
LAVOIX a été élu cabinet CPI de l’année pour la 10eme édition du Palmarès du Droit organisé en partenariat avec l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE).
Pour cette 10ème édition, le Palmarès du Droit a récompensé les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires lors d’une cérémonie au Grand Hôtel Intercontinental Opéra le 29 mars dernier.
Merci à nos clients pour leur confiance et à nos équipes pour leur implication au quotidien !
Retrouvez le classement complet ici : https://www.palmaresdudroit.fr/laureats/2022/palmares-2022.html
Données personnelles Janvier-Février 2022
Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période janvier-février 2022.
1. Actualités légales et jurisprudentielles – France
Bilan 2021 de l’action répressive de la CNIL : année record
A l’occasion de la journée européenne de la protection des données du 28 janvier 2022, la CNIL a réalisé un bilan de son action répressive pour 2021.
Le montant cumulé des amendes prononcées en 2021 s’élève à plus de 214 millions d’euros, soit une augmentation de 55% par rapport à 2020.
En 2021, la CNIL a prononcé 18 sanctions, 15 amendes et 135 mises en demeure. La moitié des sanctions concerne un manquement à la sécurité des données personnelles.
Validation par le Conseil d’Etat de la sanction prononcée par la CNIL à l’encontre de Google en matière de cookies
Par une décision du 28 janvier 2022, le Conseil d’Etat a validé la sanction prononcée par la CNIL à l’encontre de Google le 7 décembre 2020 pour plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés (LIL) en matière de cookies.
Les sociétés Google LLC et Google Ireland contestaient la compétence de la CNIL pour prononcer une telle sanction et invoquaient le mécanisme du guichet unique, qui aurait réservé une compétence exclusive de l’Autorité de contrôle irlandaise.
Dans la lignée de sa décision du 4 mars 2021, le Conseil d’Etat précise que le mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD n’est pas applicable en matière de cookies, ceux-ci étant régis par la LIL.
Le Conseil d’Etat confirme les violations de l’article 82 de la LIL prononcées par la CNIL, concernant le dépôt de cookies sans consentement préalable de l’utilisateur, le défaut d’information de l’utilisateur et la défaillance partielle du mécanisme proposé pour refuser les cookies.
Mise en demeure de la CNIL concernant l’utilisation de Google Analytics
La CNIL a été saisie de plaintes par l’association NOYB concernant le transfert vers les Etats‑Unis de données collectées lors de visites de sites web utilisant Google Analytics.
A cette occasion, la CNIL a constaté que Google Analytics implique un transfert de données vers les Etats-Unis en violation des articles 44 et suivants du RGPD, tirant les conséquences de l’arrêt Schrems II de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) ayant invalidé le Privacy Shield.
La CNIL a mis en demeure un gestionnaire de site web de se mettre en conformité avec le RGPD, de ne plus utiliser Google Analytics en l’état, et de recourir si besoin à un outil n’impliquant pas de transfert hors UE.
L’Autorité autrichienne a rendu une décision analogue le 13 janvier 2022.
Précisions de la CNIL concernant la réutilisation par un sous-traitant de données confiées par un responsable de traitement
La CNIL a précisé en janvier 2022 les modalités de réutilisation de données par un sous‑traitant, venant compléter les lignes directrices déjà établies concernant les relations entre responsable de traitement et sous-traitant.
Une réutilisation de données est subordonnée à la réalisation préalable d’un test de compatibilité, destiné à déterminer si ce traitement ultérieur est compatible avec la finalité initiale pour lesquelles les données ont été collectées. L’autorisation ne peut pas être préalable ni générale, et doit être écrite.
Une fois l’autorisation obtenue, le responsable de traitement a l’obligation d’informer les personnes concernées de l’existence de ce traitement ultérieur, et le sous-traitant (devenu responsable de traitement lui-même) est tenu de garantir la conformité du traitement à la réglementation.
Introduction d’une nouvelle procédure simplifiée de sanction CNIL pour les dossiers considérés de faible importance
Un nouveau régime de sanction CNIL a été introduit par la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et sécurité intérieure, insérant notamment un nouvel article 22-1 dans la loi Informatique et Libertés.
Ce texte aménage les pouvoirs du Président de la formation restreinte pour les dossiers considérés de faible importance. Il pourra statuer seul et prendre trois catégories de mesures : enjoindre la production des éléments demandés en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, et prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.
Cette nouvelle procédure répond à l’augmentation du nombre de plaintes reçues par la CNIL.
Le CNnum met en débat de nouveaux droits et obligations
Le Conseil National du Numérique (CNnum) a publié le 13 janvier un dossier proposant des solutions pour remédier aux problèmes créés par l’économie de l’attention, fondement des plateformes numériques via la collecte des données et la publicité personnalisée.
A cette occasion, le CNnum met notamment en débat la création de nouveaux droits pour les internautes et obligations pour les plateformes numériques, tels que la consécration d’un droit d’être informé sur les dispositifs de captation attentionnelle, le renforcement du droit à la déconnexion, et la création d’un droit à l’interopérabilité entre plateformes.
2. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe et international
Projet de règlement sur les données (« Data Act »)
La Commission européenne a publié le 23 février 2022 son projet de règlement sur les données, dit « Data Act », en faveur d’une économie des données équitable et innovante.
Les objectifs du Data Act sont notamment d’assurer l’équité dans l’environnement numérique, stimuler le développement d’un marché des données concurrentiel, ouvrir des perspectives pour l’innovation fondée sur les données et rendre les données plus accessibles à tous.
Lignes directrices du CEPD sur le droit d’accès
Le 18 janvier, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté ses lignes directrices sur le droit d’accès des personnes concernées, faisant l’objet d’une consultation publique de six semaines.
Ces lignes directrices ont vocation à préciser le champ d’application du droit d’accès, les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée, le format de la demande d’accès, les modalités d’accès et la notion de demandes manifestement infondées et excessives.
Lignes directrices du CEPD sur les violations de données
Le CEPD a publié le 3 janvier dix-huit cas pratiques, faisant office de lignes directrices, pour accompagner les responsables de traitement dans leur gestion des violations de données personnelles, conformément aux articles 33 et 34 du RGPD.
Le CEPD traite des principales menaces que peuvent rencontrer les responsables de traitement, classés en six catégories : les rançongiciels, les attaques d’exfiltration de données, les risques humains internes, la perte ou le vol de documents papier, les erreurs d’envoi et l’ingénierie sociale.
Pour chaque pratique, le CEPD présente les mesures préalables à mettre en œuvre, la méthode d’évaluation du risque, les mesures d’atténuation du risque et les obligations concrètes du responsable de traitement.
Sanction d’IAB Europe par l’autorité de contrôle belge
L’Autorité de contrôle belge a condamné l’IAB Europe à une amende de 250 000 euros pour non-respect du RGPD concernant son standard de « transparence et de consentement » (« Transparency and Consent Framework ») utilisé par les acteurs de la publicité numérique pour mettre leurs outils de profilage publicitaire en conformité avec le RGPD.
L’Autorité identifie la base légale sur laquelle se fonde l’IAB, à savoir le consentement des internautes, comme une garantie insuffisante. Sans interdire l’outil, l’Autorité ordonne des mesures de correction. L’IAB a indiqué avoir fait appel de la décision.
Injonction du CEPD au Parlement européen pour des transferts de données hors UE
Le CEPD a constaté qu’un site internet lancé par le Parlement européen pour permettre aux membres et au personnel du Parlement de réserver des créneaux pour effectuer des tests de Covid-19 n’était pas conforme au RGPD, notamment concernant des transferts de données personnelles en dehors de l’UE, vers les Etats-Unis, sans démonstration d’un niveau équivalent de protection.
Ce contrôle intervient à la suite d’une plainte. Le Parlement européen est enjoint de corriger son site internet dans un délai d’un mois.
Sanction de l’opérateur de téléphonie grec COSMOTE
L’Autorité de contrôle grecque a sanctionné le 31 janvier 2022 l’opérateur de téléphonie COSMOTE par une amende de 6 millions d’euros. Celle-ci collectait les données de trafic des abonnés et les conservait pendant une durée de 90 jours à compter de la date d’appel, puis les conservait de manière pseudonymisée pendant 12 mois supplémentaires.
L’Autorité a considéré que ce traitement portait atteinte aux principes de légalité et transparence des traitements, ne démontrait pas de mesures de sécurité suffisantes et était mis en œuvre à la suite d’une analyse d’impact dont l’évaluation était inexacte.
Article rédigé par : Alix CAPELY, Pierre-Emmanuel MEYNARD et Camille PECNARD
Mise en œuvre de la norme OMPI ST.26 pour les listages de séquences à compter du 1er juillet 2022
Le Comité des normes de l’OMPI (CWS) a adopté la nouvelle norme OMPI ST.26, qui présente les listages de séquences nucléotidiques et protéiques au format XML, en remplacement de la norme ST.25.
La représentation des listages de séquences au format XML plutôt qu’en format TXT vise à améliorer l’accès aux bases de données internationales de séquences. La nouvelle norme harmonise également davantage les pratiques entre offices de brevets et exige l’annotation obligatoire de types de séquences supplémentaires (analogues nucléotidiques, acides aminés D, séquences ramifiées), afin de rendre davantage de données de séquence recherchables.
La date de dépôt (et non la date de priorité) est la date de référence déterminant si les règles ST.26 s’appliquent. Le redépôt d’un listage de séquences lors du dépôt d’une demande divisionnaire relève du droit national ou régional. À ce jour, il est entendu que l’OEB exige qu’une demande divisionnaire déposée le ou après le 1er juillet 2022 soit accompagnée d’un listage conforme à la norme ST.26.
Un nouvel outil logiciel mondial, « WIPO Sequence », permettant de préparer des listages de séquences d’acides aminés et de nucléotides selon la norme OMPI ST.26, est disponible sur le site de l’OMPI.
Plus de détails sur la norme OMPI ST.26 peuvent être trouvés sur les sites de l’OMPI et de l’OEB .
La criticité de l’apport de preuves d’exploitation des marques dans les nouvelles procédures en nullité
La procédure en nullité a été modifiée par les dispositions de la « loi Pacte » (en vigueur depuis le 11 décembre 2019) en particulier au regard de ses conditions de recevabilité qui, en ce qui concerne les preuves d’exploitation de la marque antérieure invoquée, sont de deux ordres :
1. Preuves d’usage de la marque antérieure soumise à obligation d’usage
L’article L 716-2-3 prévoit, sous peine d’irrecevabilité que, sur requête du titulaire de la marque attaquée, le titulaire de la marque antérieure servant de base à l’action, doit apporter la preuve :
- si celle-ci est soumise à obligation d’usage à la date d’introduction de l’action, de l’usage sérieux (ou un motif de non usage) de sa marque au cours des cinq années précédant la date à laquelle cette demande en nullité a été formée ;
et
- si celle-ci était soumise à obligation d’usage à la date de dépôt ou de priorité de la marque attaquée, de l’usage sérieux (ou un motif de non usage) de sa marque au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque attaquée.
La preuve de l’exploitation doit donc porter sur deux périodes de référence distinctes.
La dernière disposition peut amener à une situation surprenante dans l’hypothèse où la marque attaquée serait très ancienne et où le titulaire de la marque antérieure invoquée se verrait refuser son action au motif qu’à la date de dépôt de la marque dont la nullité est requise, il n’exploitait pas sa marque. Cela reviendrait à interdire l’introduction d’une demande en nullité alors même que l’action est imprescriptible !
Un exemple en pratique :
Enfin et pour rappel, la preuve de cet usage a des conséquences non seulement sur la recevabilité de l’action, mais également sur l’étendue de l’opposabilité de la marque invoquée qui ne sera réputée enregistrée que pour chacun des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.
2. Preuves de la distinctivité de la marque antérieure aux fins de l’appréciation du risque de confusion
Le nouvel article L 716-2-4 dispose que la demande en nullité fondée sur une marque antérieure est irrecevable si cette marque n’avait pas acquis un caractère suffisamment distinctif à la date de dépôt de la marque attaquée justifiant l’existence d’un risque de confusion.
La question qui se pose est de savoir comment va être appréciée cette condition « d’acquisition d’un caractère distinctif ».
A notre connaissance, aucune décision n’est venue à ce jour définir cette nouvelle condition que nous interprétons comme mettant à la charge du titulaire de la marque antérieure la démonstration d’une exploitation telle de sa marque que le risque de confusion aurait été évident au jour de dépôt de la marque attaquée. Cela revient à établir un dossier notoriété de la marque antérieure !
Une attention toute particulière devra donc être portée sur la capacité du titulaire de la marque invoquée à prouver son usage et son caractère distinctif à ces différentes périodes.
Lavoix est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de protection et défenses de vos marques dans les nouvelles procédures en nullité.
Loi PACTE & Droit des Brevets : quels impacts en pratique ?
La loi Pacte a permis l’entrée en vigueur progressive de nombreuses modifications dans le droit français des brevets pour permettre de sécuriser la valeur juridique d’un brevet français et harmoniser les procédures à l’échelle européenne.
Nos ingénieurs en collaboration avec l’INPI vous proposent de faire un premier bilan des impacts pratiques de ces modifications avec un focus sur la nouvelle procédure d’opposition en France dont les premières décisions sont attendues sous peu.
L’Irak adhère au traité de coopération PCT
Le 31 janvier, le gouvernement de l’Irak a déposé son instrument d’adhésion au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) auprès du Directeur général de l’OMPI.
L’Irak devient ainsi le 155e membre de l’Union du PCT. Il entrera en vigueur pour l’Irak le 30 avril 2022.
À partir du 30 avril 2022, il sera ainsi possible d’obtenir une protection brevet en Irak via un dépôt PCT.
Brevetabilité des simulations mises en œuvre par ordinateur – Retour sur la décision G1/19 de l’OEB
Le 25 février 2022, la Chambre de Recours à l’origine de la saisine G1/19 sur les simulations mises en œuvre par ordinateur a annoncé qu’elle émettrait sa décision écrite d’ici la fin du mois de mars 2022. Cette décision viendra clore cette affaire et illustrer une application pratique des enseignements de la saisine G1/19.
Plus généralement, nous vous proposons de revenir sur la décision G1/19 qui, tout en confirmant la jurisprudence établie sur les inventions mises en œuvre par ordinateur, a introduit certaines précisions importantes, que nous aurons plaisir à vous présenter, avec quelques implications pratiques.
Webinaire : Loi Pacte, quel impact sur le droit des marques ?
Les premières mesures en matière de marques prévues par la Loi PACTE sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019.
Le rendez-vous s’est tenu le mardi 8 février et a été animé par nos juristes marques. Valérie Genin et Gwénaël Toussaint, ont fait le point sur les nouveaux types de marques, la nouvelle procédure d’opposition et les actions administratives en nullité et en déchéance devant l’INPI.
Les tendances 2022 en propriété intellectuelle
Philippe Blot, Président de Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), évoque les tendances 2022 en propriété intellectuelle dans l’émission LEX INSIDE sur DECIDEURSTV et Le Monde du Droit.
Retrouvez l’interview de Philippe Blot dans l’émission du 22 février 2022 de LEX INSIDE en intégralité, en cliquant ici.
JUB et opt-out : définition, avantages et inconvénients
Le système actuel des brevets européens délivrés par l’Office européen des brevets présente l’inconvénient qu’un même brevet, validé dans plusieurs États, peut donner lieu à plusieurs litiges parallèles dans ces juridictions.
Le paquet « brevet unifié » crée un effet unitaire pour les brevets européens englobant les États qui ont ratifié l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet (UPCA – à consulter ici). En d’autres termes, un brevet européen à effet unitaire aura les mêmes effets dans tous les États qui ont ratifié l’UPCA et où le brevet a été validé.
Il crée également une juridiction unique (la Juridiction Unifiée des Brevets – JUB) compétente pour ces brevets européens à effet unitaire.
La Juridiction unifiée du brevet (JUB)
La JUB devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année 2022. (Voir la notification sur le site officiel de la JUB).
La JUB sera une juridiction unique qui aura une compétence exclusive pour les brevets européens à effet unitaire.
Pendant une période transitoire, elle sera compétente pour les brevets européens ou les demandes sans effet unitaire, en plus des tribunaux nationaux, devant lesquels des actions en contrefaçon ou en révocation de brevets européens ou des déclarations d’invalidité d’un certificat complémentaire de protection peuvent être intentées, à condition que la compétence de la JUB ne soit pas exclue (voir ci-dessous).
Par défaut, lorsque l’UPCA entrera en vigueur, tous les brevets européens actuels, qui sont validés dans les pays qui ont ratifié l’UPCA, seront automatiquement soumis à la juridiction de la JUB. Il en ira de même pour les demandes de brevet européen en cours et les CCP fondés sur des brevets européens. Toutefois, pour obtenir une décision dans un État où un brevet européen a été validé mais qui n’a pas ratifié l’UPCA, il sera nécessaire d’intenter une action devant le tribunal national compétent (Espagne et Pologne).
Les brevets qui relèvent du système de la JUB sont susceptibles d’être contestés par des tiers devant cette Cour et, en cas de révocation, la décision s’appliquera à tous les États membres de l’UPCA : Par une décision unique, le brevet sera révoqué dans tous les États qui ont ratifié l’UPCA et où le brevet européen a été validé.
La compétence de la JUB sur les brevets délivrés ou les demandes en instance sans effet unitaire peut être exclue par choix du titulaire ou du demandeur, de sorte que seules les juridictions nationales restent compétentes. C’est ce que l’on appelle l’« opt-out ».
Définition de l’opt-out
L’opt-out est une option offerte aux demandeurs ou aux titulaires de brevets pour exclure de la compétence de la JUB les litiges liés à l’un de leurs brevets européens (en vigueur ou expirés) ou à leurs demandes sans effet unitaire. Ainsi, toute action en contrefaçon ou en révocation d’un brevet européen sera entendue par les juridictions nationales compétentes, à l’instar du système actuel.
L’opt-out produit ses effets dans tous les États membres contractants de l’UPCA dans lesquels le brevet européen ou la demande est en vigueur et pendant toute la durée de vie du brevet, sans qu’il soit nécessaire de notifier l’opt-out séparément aux États membres contractants concernés (article 83, paragraphe 3, de l’UPCA).
Les CCP pour les brevets européens opt-out seront automatiquement opt-out (CCP délivrés ou futurs CCP basés sur le brevet). Dans le cas contraire, les CCP peuvent être exclus séparément, ce qui doit être fait par le titulaire du brevet.
Selon une note explicative du comité préparatoire publiée le 29 janvier 2014, un tribunal national compétent devrait appliquer le droit national applicable et non l’UPCA. Reste à savoir si les tribunaux nationaux suivront cet avis.
Période d’opt-out
La faculté de renonciation ne sera possible que pendant une période limitée : la « période transitoire ».
L’option de refus sera initialement disponible avant l’entrée en vigueur de la CUP, pendant la période d’application provisoire précédente (« sunrise ») qui devrait commencer à la fin de l’été 2022, jusqu’à l’ouverture de la CUP (voir l’entrée en vigueur du protocole sur l’application provisoire).
Au cours de cette période, le registre de la CUP sera mis en place pour enregistrer les demandes de retrait avant que les actions en révocation puissent être introduites auprès de la CUP le premier jour du système. En effet, si une action de la CUP est introduite avant qu’un opt-out ne soit inscrit au registre, cela empêchera tout opt-out ultérieur.
L’opt-out sera alors possible pendant une période transitoire de 7 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord CUP (avec la possibilité d’une période supplémentaire de 7 ans qui peut être décidée par le comité administratif de la CUP) jusqu’à un mois avant l’expiration de la période transitoire. (Voir l’article 83.1 de l’UPCA). Après cette période transitoire d’une durée maximale de 14 ans, la CUP obtiendra la compétence exclusive sur les demandes européennes/brevets européens sans effet unitaire qui n’auraient pas fait l’objet d’une clause d’exclusion.
Procédures
Les demandes d’exclusion devront être déposées auprès du registre de la CUP. La renonciation prendra effet le jour où la notification de la renonciation sera reçue par le registre, à condition que le brevet faisant l’objet de la renonciation n’ait pas déjà fait l’objet d’un litige en cours devant la CUP. Il peut donc s’avérer crucial de déposer une demande de renonciation dès qu’elle est disponible.
La demande de renonciation doit être déposée au nom du titulaire effectif de la demande ou du brevet européen, au moment du dépôt de la demande de renonciation, faute de quoi elle sera considérée comme nulle et non avenue. Les codemandeurs ou les codétenteurs d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen devront agir en commun pour exercer l’option de retrait.
Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un conseil en brevets européens ou un avocat pour déposer une demande d’opt-out. Une personne mandatée par l’entreprise elle-même, telle qu’un employé de l’entreprise, peut demander l’exclusion d’un brevet.
Il sera possible d’identifier manuellement un nombre illimité de brevets à exclure dans le système de gestion des cas de la CUP (le site web du CMS peut être consulté ici) ou d’utiliser une « interface de programmation d’applications » qui permettra de sélectionner des brevets dans une base de données extérieure au CMS, qui seront ensuite exportés vers le CMS pour être exclus. Cette dernière option permettra d’exclure facilement et rapidement un très grand nombre de brevets.
Conformément à l’article 83, paragraphe 4, de l’UPCA, il sera possible de retirer cette option à tout moment, à condition qu’aucune action n’ait été intentée devant une juridiction nationale.
Une fois que la demande de retrait d’un opt-out est enregistrée, il ne devrait pas être possible d’exercer à nouveau l’opt-out, conformément au projet actuel de règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (règle 5 n° 10 du 18e projet).
Frais de justice
Conformément à l’article 370 du règlement de procédure, qui traite des frais de justice et des frais recouvrables, voté le 25 février 2016, il n’y aura pas de frais officiels pour l’opt-out ou pour le retrait de l’opt-out.
Conséquences de l’opt-out
Avantages de la JUB –[L’opt-out ne créerait pas d’avantage]
La JUB comprendra des juges techniques susceptibles de mieux comprendre les inventions techniquement complexes et d’avoir un meilleur raisonnement sur la contrefaçon de brevets. La nouvelle Cour évitera par définition les décisions contradictoires qui peuvent être rendues par différents tribunaux nationaux en matière de contrefaçon.
Elle est conçue pour rendre des décisions dans un délai d’un an, si le calendrier défini est respecté, ce qui réduit considérablement la durée des procédures par rapport à certaines juridictions nationales.
En outre, en cas d’infractions multiples dans plusieurs pays européens, une seule action peut être intentée devant la JUB et aura un effet sur tous les États membres de l’UPCA. Le choix de la JUB réduira donc considérablement les coûts de la procédure par rapport à plusieurs litiges devant être menés dans de nombreux pays.
Inconvénients de la JUB – [Il serait préférable d’opter pour la non-participation]
Avec la JUB, un brevet européen peut être révoqué dans tous les États par une décision unique. Cela permettra aux tiers ou aux contrefacteurs présumés de contester efficacement la validité des brevets pendant toute leur durée de vie.
En outre, l’absence de retour d’information ou de jurisprudence de la JUB peut rendre le choix de la JUB risqué, car nous ne connaissons pas encore la position qui sera adoptée par la Cour, en particulier en ce qui concerne la validité des brevets. En outre, les règles et les procédures de la JUB n’ont pas encore été testées ; il faudra plusieurs années pour parvenir à des décisions cohérentes.
Un autre élément à prendre en compte lors du choix des brevets opt-out est que tous les titulaires de toutes les désignations d’un brevet européen, dans tous les États qui ont signé l’accord de la JUB, doivent accepter l’opt-out. La première difficulté qui peut découler de cette règle est d’identifier les véritables titulaires du brevet, qui ne seront pas nécessairement les titulaires enregistrés, en particulier lorsque les brevets ont été cédés par un tiers. La propriété doit être vérifiée, bien qu’il ne soit pas nécessaire de mettre à jour/corriger les registres. La seconde est la nécessité pour tous les propriétaires de s’associer à la demande de retrait.
En outre, si l’infraction est concentrée dans un seul pays ou dans un petit nombre de pays, les coûts de la JUB peuvent être plus élevés que ceux d’une procédure devant les tribunaux nationaux correspondants.
Décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande
Par ordonnance du 23 juin 2021, la Cour constitutionnelle fédérale allemande (FCC) a rejeté deux demandes de mesures provisoires contre la loi d’approbation adoptée le 18 décembre 2020 en vue de la ratification de l’Accord du 19 février 2013 sur une Juridiction unifiée du brevet (loi d’approbation JUB).
Cette décision était très attendue, car le processus de ratification de la loi d’approbation JUB — et donc la mise en place de la JUB — avait été paralysé jusqu’au prononcé de la décision.
La violation des droits fondamentaux alléguée par les requérants est jugée par la FCC comme insuffisamment étayée et motivée.
Les requérants n’ont pas démontré pourquoi et comment la loi d’approbation, dans la structuration organisationnelle de la Juridiction unifiée du brevet et dans le statut juridique accordé aux juges, pourrait violer le principe de l’État de droit consacré à l’article 20(3) de la Loi fondamentale allemande, d’une manière susceptible d’interférer avec le principe de démocratie.
Cette décision semble ouvrir la voie au dépôt des instruments allemands de ratification.
Les nombreux obstacles à la mise en œuvre de la JUB et du brevet unitaire semblent être progressivement surmontés.
Certains estiment que le nouveau système pourrait entrer en vigueur d’ici 2022 tout au plus.
Encore et toujours : l’accord JUB est à nouveau contesté en Allemagne
Bien que le Parlement allemand (« Bundesrat ») ait récemment voté en faveur de la ratification de l’Accord unifié sur la compétence en matière de brevets (UPCA) (que nous avons rapporté ici), et malgré la volonté politique (voir ici), la ratification de l’UPCA par l’Allemagne est une fois de plus en suspens.
La Cour constitutionnelle fédérale allemande (FCC) a fait savoir que deux nouvelles plaintes constitutionnelles ont été déposées le jour même où le Bundesrat a approuvé la ratification (18 décembre 2020).
L’une des plaintes, déposée par l’avocat de Düsseldorf Ingve Stjerna, qui avait déjà déposé une plainte constitutionnelle en 2017, vise à obtenir une ordonnance provisoire pour interrompre le processus de ratification jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond.
Le contenu des plaintes n’est pas encore connu.
En tout état de cause, et suite à ces plaintes, la présidence fédérale a déjà confirmé que le processus de ratification sera reporté jusqu’à ce que l’affaire soit vidée par la FCC.
Le Parlement allemand (Bundestag) a déjà déposé le 8 janvier 2021 une déclaration dans le cadre de la procédure d’injonction provisoire. En outre, le 13 janvier 2021, la commission allemande des affaires juridiques et de la protection des consommateurs a recommandé que le Bundestag prenne part à la procédure et dépose d’autres déclarations dans le cadre de la procédure principale.
La FCC peut rejeter les plaintes comme irrecevables ou les examiner sur le fond. Si l’injonction provisoire est acceptée et que la décision n’est prise que dans le cadre de la procédure principale, cela retarderait considérablement le processus. En effet, la première décision de la FCC a été rendue trois ans après le dépôt de la première plainte.
Ce nouvel obstacle, ainsi que le départ du Royaume-Uni de l’UE et de la CUP, ouvre un nouveau chapitre dans la longue histoire de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures relatives au brevet unitaire dans l’UE.
Le gouvernement fédéral allemand a officiellement ratifié la loi d’approbation de la JUB le 13 août
La publication de la loi au Journal officiel fédéral met enfin un terme aux complications juridiques qui bloquaient le processus de ratification allemand et, par conséquent, l’établissement de la Juridiction unifiée du brevet (JUB).
Mais cela ne signifie pas que la JUB peut enfin commencer à fonctionner.
Avant que la JUB ne puisse réellement ouvrir ses portes, la phase préparatoire doit débuter.
L’Allemagne prévoit de ratifier le Protocole sur l’application provisoire au début de l’automne.
Selon ce Protocole, certaines parties de l’Accord JUB seront appliquées provisoirement avant son entrée pleinement en vigueur.
Pour que ce Protocole entre en vigueur, deux autres États membres de l’Accord JUB doivent encore le signer.
La mise en œuvre de ce Protocole dépend désormais d’un processus de ratification rapide par les juridictions des États membres.
Selon Alexander Ramsay, chef du Comité préparatoire de la JUB, il pourrait y avoir une JUB opérationnelle fin 2022, ou éventuellement début 2023 « si tout se passe bien ».
L’état d’avancement actuel vers la mise en place de la Juridiction unifiée du brevet
L’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet entrera dans une phase préparatoire provisoire lorsque 13 États signataires de l’Accord, dont l’Allemagne, la France et le Royaume‑Uni, ayant ratifié ledit accord, auront ratifié le Protocole sur l’application provisoire ou auront exprimé leur consentement à être liés par celui-ci (art. 3(1) du Protocole).
La France a ratifié l’Accord et a également ratifié le Protocole le 23 mai 2017.
Dernièrement (le 27 septembre 2021), l’Allemagne a déposé son instrument de ratification du Protocole et devrait ratifier l’Accord une fois que les travaux préparatoires auront suffisamment progressé et que les États membres participants seront convaincus que la JUB peut démarrer de manière ordonnée.
Le même jour, la Slovénie a également ratifié le Protocole, mais n’a pas encore ratifié l’Accord.
À ce jour, 10 des 13 États requis ont ratifié le Protocole (France, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, Italie, Luxembourg, Pays‑Bas, Suède). L’Autriche et Malte devraient être les prochains.
Comme l’a rapporté le Comité préparatoire de la Juridiction unifiée du brevet, « il est attendu que les deux ratifications supplémentaires requises soient bientôt obtenues, déclenchant ainsi la mise en place de la JUB en tant qu’organisation internationale ».
Le protocole sur l’application provisoire de l’accord JUB
Le Protocole à l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet sur l’application provisoire (le PAP‑Protocole) a été initialement signé le 1er octobre 2015 pour établir une phase d’application provisoire (PAP) afin d’assurer « une transition en douceur vers la phase opérationnelle et garantir le bon fonctionnement de la Juridiction unifiée du brevet avant l’entrée en vigueur de l’Accord ».
Entrée en vigueur du protocole d’application provisoire de l’accord JUB
Le Conseil européen vient d’indiquer sur son site que le protocole à l’accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet sur la demande provisoire est entré en vigueur hier, le 19 janvier 2022.
Ceci fait suite au dépôt des instruments de ratification dudit protocole par l’Autriche, qui a pris effet le 18 janvier 2022, ce qui fait que le PAP est ratifié par son treizième État membre.
Comme nous l’avons expliqué dans un article précédent, la ratification du PAP déclenche l’existence de la Cour unifiée des brevets (CUP) en tant qu’organisation internationale, ce qui constitue une étape historique dans le domaine de la propriété intellectuelle européenne, après tant d’évolutions en dents de scie.
Il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant que la CUP puisse commencer à fonctionner de manière efficace. Il s’agit notamment de l’obtention des budgets, de la sélection des juges, de la mise en place des organes administratifs et de la mise au point du système de gestion des dossiers entièrement dématérialisé. Selon un avis publié par la CUP, il faudra au moins huit mois pour pouvoir déclencher le système.
C’est l’Allemagne qui aura le dernier mot pour lancer le système, quatre mois après le dépôt de ses instruments de ratification de l’accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet.
L’Office européen des brevets a simultanément annoncé qu’il serait également prêt à mettre en place le brevet unitaire, qui devrait commencer à fonctionner le même jour que la JUB (https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220117.html).
De nouvelles opportunités apparaîtront avec la naissance de ces nouveaux outils. De nouvelles stratégies devront être définies pour la protection des brevets et les litiges en matière de brevets en Europe.
Dans les mois à venir, les équipes professionnelles intégrées de LAVOIX, comprenant des mandataires en brevets européens et des avocats pleinement qualifiés, s’engageront à développer ou à rafraîchir vos connaissances des nouvelles procédures, et à vous aider à préparer vos organisations au démarrage effectif de la JUB et du brevet unitaire, afin que vous soyez en mesure d’utiliser le nouveau système de manière optimale.
Les équipes de LAVOIX seront prêtes à agir dès le premier jour, profitant de notre position géographique au cœur de la JUB à Paris et à Munich.
Nous continuerons à mettre régulièrement à jour le blog avec des informations sur les progrès de la JUB et les préparatifs de l’UP. Nous fournirons également des articles de fond sur des sujets cruciaux tels que l’opt-out ou le stay-in, et divers détails sur les procédures du brevet unitaire et de la JUB.
Restez en contact avec nous, alors qu’une nouvelle ère historique s’ouvre pour la propriété intellectuelle européenne…
Comment sélectionner le brevet européen à effet unitaire (Brevet unitaire)
Le brevet unitaire : une protection unique pour 17 États en Europe
Avec la récente ratification de l’Autriche, le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») sera prochainement introduit.
Laguiole et Thiers jouent du couteau pour l’obtention d’une appellation géographique
Les communes de Thiers et de Laguiole s’opposent pour obtenir l’appellation « indication géographique » (IG) pour la production de leurs célèbres couteaux. L’Institut national de la propriété industrielle aura le dernier mot.
Pour lire l’article de La Croix en intégralité, cliquez ici.
Austrian parliament choses to ratify the PAP-Protocol
Yesterday, December 2nd, 2021, the Austrian Bundesrat (second chamber of the Austrian Parliament) approved unanimously the Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application (the PAP-Protocol) of the Unified Patent Court Agreement (UPCA).
This means that once the Austrian Government will have deposited the corresponding instrument of ratification, Austria will be the 13th country to join the PAP-Protocol and the UPCA will enter into the provisional preparatory stage.
As explained previously on this blog (see here), this choice of the Austrian Parliament may render possible the beginning of the United Patent Court by the end of 2022.
L’OEB annonce une hausse des taxes à compter du 1er avril 2022
Les règles relatives aux taxes de l’OEB ont été modifiées par décision du Conseil d’administration du 15 décembre 2021. La version modifiée des règles entre en vigueur le 1er avril 2022.
Une évaluation des ajustements montre une augmentation générale d’environ 2,5 % pour la plupart des taxes.
Les hausses concernent notamment :
- Taxe de dépôt (phase régionale EP) : 130 EUR (augmentation de 5 EUR),
- Taxe de dépôt (demande EP directe) : 130 EUR (augmentation de 5 EUR),
- Taxe de recherche : 1390 EUR (augmentation de 40 EUR),
- Taxe de désignation : 630 EUR (augmentation de 20 EUR),
- Taxe d’examen : 1750 EUR (augmentation de 50 EUR),
- Taxe d’opposition : 840 EUR (augmentation de 25 EUR),
- Taxe de recours : 2785 EUR (augmentation de 80 EUR),
- Taxe de délivrance (≤ 35 pages) : 990 EUR (augmentation de 30 EUR),
- Taxe de délivrance (> 35 pages) : 990 EUR (augmentation de 30 EUR) + 16 EUR pour la 36ᵉ et chaque page suivante (augmentation de 1 EUR).
En conséquence, si des étapes procédurales pour des brevets ou demandes EP interviennent à la mi‑2022, ou si vous souhaitez utiliser l’un des services concernés par la hausse, il peut être opportun d’accomplir les démarches nécessaires pour permettre un paiement avant le 1er avril 2022.
Pour plus de détails sur la nouvelle grille tarifaire, veuillez consulter la communication correspondante de l’OEB : https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a2.html.
Invention de salariés : la Cour de cassation affine sa jurisprudence
Cour de cassation, 5 janvier 2022, n°19 22.030
La Cour de cassation a rendu, au début du mois de janvier 2022, une décision intéressante en matière d’inventions de salariés.
L’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une dévolution automatique des droits à l’invention réalisée par un salarié investi d’une mission inventive au profit de l’employeur.
La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, rendue dans une affaire aux faits complexes, était stricte quant à la qualité de celui qui pouvait se prévaloir de ces droits. Cela autorisait ainsi un salarié à revendiquer la propriété d’un brevet déposé sur ses travaux par un cessionnaire de l’employeur[1].
La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence par une décision du 5 janvier 2022.
En substance, la Cour juge (points 9 et 10) que :
– En vertu des dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle, les droits sur les inventions de mission sont la propriété de l’employeur,
– Aucune disposition n’empêche l’employeur de céder ses droits à un tiers,
– Le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer le fait que le brevet porte sur une invention de mission au salarié qui en revendique la propriété, considérant que ce dernier n’a jamais eu aucun droit à cet égard.
Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, les employeurs sont donc libres de céder leurs droits sur les inventions de leurs employés à tout tiers qu’ils souhaitent, sans que la titularité sur d’éventuels brevets soit remise en question.
Les conséquences pratiques peuvent être importantes au sein de groupes de sociétés, dont les portefeuilles de brevets ne sont pas toujours détenus par l’entité employant les salariés. Ceci pouvait causer des incertitudes dans la gestion des portefeuilles de brevets.
Bien que cette décision soit intéressante, elle soulève plusieurs questions importantes, laissées sans réponse.
En particulier, il n’est pas clair comment évaluer le brevet s’il est cédé à une autre société du groupe, ou à un tiers. Dans ce cas, la valeur économique de l’invention est difficile à évaluer et la rémunération supplémentaire due à l’employé (qui est largement basée sur ladite valeur économique en vertu de la jurisprudence) est difficile à définir correctement.
Cette décision laisse plus de liberté aux employeurs dans la gestion et la valorisation des travaux de leurs salariés.
Néanmoins, elle leur impose toujours de faire preuve de rigueur dans l’élaboration de chaînes de droits sur ces travaux et de surveiller de près les réclamations qui pourraient être faites par leurs employés inventeurs, ainsi que leurs conséquences.
[1] Cour de cassation, 31 janvier 2018, n°16-13.262
Préparation du brevet européen à effet unitaire à l’OEB
Le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») sera prochainement introduit. La dernière étape des travaux préparatoires sera achevée d’ici la fin de cet été et la dernière ratification manquante sera ensuite déposée par l’Allemagne.
Afin de permettre aux déposants d’obtenir une protection unitaire pour les demandes EP qui doivent être délivrées entre le dépôt de la dernière ratification et l’entrée en vigueur effective du brevet unitaire, l’OEB a annoncé la mesure suivante visant à différer la délivrance.
Pour les demandes pour lesquelles une notification selon la règle 71(3) CBE a été émise, le demandeur peut déposer une requête en report de la délivrance jusqu’à l’entrée en vigueur du brevet unitaire.
La requête en report de délivrance doit respecter plusieurs conditions formelles : le formulaire 2025 correspondant doit être utilisé. Le demandeur ne doit pas encore avoir donné son accord sur le texte proposé pour la délivrance.
En outre, le délai de quatre mois pour répondre à la notification selon la règle 71(3) CBE n’est pas modifié.
Afin de faciliter l’obtention de la protection unitaire, durant la même période, l’OEB acceptera des requêtes anticipées en effet unitaire, permettant ainsi aux demandeurs d’effectuer les démarches administratives avant la date effective d’entrée en vigueur du brevet unitaire.
Les conditions formelles de ces requêtes anticipées en effet unitaire comprennent : la notification selon la règle 71(3) CBE doit avoir été émise. Bien que la requête puisse être déposée par d’autres moyens, il est vivement recommandé de la déposer en ligne au moyen du formulaire UP7000.
Veuillez garder à l’esprit que ces mesures ne sont pas encore en vigueur, mais dépendent de la date à laquelle l’Allemagne ratifiera l’accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet.
Cette alerte PI est fournie uniquement à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique.
Appellation d’indication géographique : Thiers et Laguiole
« L’intérêt de tous est de s’entendre »
David Millet, conseil en propriété industrielle chez Lavoix, fait part de son expertise.
Quel est l’enjeu de ces dossiers d’obtention d’IG ?
Il existe deux dossiers, l’un autour de Laguiole et l’autre, un peu plus ouvert qui part de Thiers et qui englobe Laguiole, ce qui est, de mon point de vue, un peu plus malin. L’enjeu est de déterminer où peut être fabriqué le couteau à l’abeille, avec la mention » couteau de Laguiole.
Avec des exceptions des couteliers qui ont déjà déposé il y a plusieurs années cette marque qui pourront continuer à les utiliser y compris pour des produits qui ne sont pas conformes à l’IG. Ils n’auront juste pas le droit d’apposer le logo » IG. Pour ceux qui n’ont pas déposé de marque, ils ne pourront plus commercialiser leurs couteaux sous la mention » Laguiole. C’est évidemment un enjeu très important qui se chiffre en millions d’euros.
Pour lire l’article de Midi Libre en intégralité, cliquez ici.
Lavoix ouvre un bureau en Suisse
Lavoix, acteur majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), poursuit son développement international et annonce l’ouverture d’un bureau en Suisse, à Lausanne.
Ouvert depuis le 17 janvier, ce nouveau bureau est animé par Maxim Kuzmin, associé, qui travaille au sein du cabinet en matière de brevets depuis près de 10 ans après plusieurs expériences dans le milieu de la R&D, au sein d’une multinationale spécialisé dans les gaz, les technologies et les services pour l’industrie de la santé ainsi que dans un centre de recherche spécialisé dans la modélisation et la simulation numérique.
La performance de la Suisse en matière d’innovation est l’une des meilleures au monde, grâce notamment à de solides institutions dans la recherche, tant dans le secteur public que privé et à une économie basée sur la connaissance et la production de biens et services à forte valeur ajoutée.
 |
« La Suisse a développé au cours des trente dernières années, un environnement sûr et efficace pour la gestion des droits de propriété intellectuelle. LAVOIX accompagne déjà plusieurs clients qui déposent leurs brevets en Suisse. Cette implantation à Lausanne va nous permettre de renforcer notre présence en Europe et à l’international et offrir ainsi à nos autres clients de nouvelles opportunités pour développer leur stratégie PI… » Philippe Blot, Président de LAVOIX. |
Ce nouveau bureau est la 5e implantation en Europe de LAVOIX. Présent depuis plus de 120 ans en France, depuis plus de 10 ans en Allemagne, avec un bureau à Munich à quelques mètres du siège de l’OEB (Office Européen des Brevets), LAVOIX est également installé en Italie à Milan, au Luxembourg depuis 4 ans et bénéfice d’un réseau de correspondants établis dans 170 pays.
Adresse du bureau LAVOIX de Lausanne : Voie du chariot 3, 1003 Lausanne Suisse.
Données personnelles Novembre-Décembre 2021
Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période novembre-décembre 2021.
1. Délibérations de la CNIL
La CNIL sanctionne Google d’une amende de 150 millions d’euros et Facebook d’une amende de 60 millions d’euros pour manquement aux obligations en matière de cookies
Par une délibération du 31 décembre 2021, la CNIL a caractérisé un manquement aux obligations en matière de cookies par les sociétés Google LLC et Google Ireland Ltd.
La CNIL a été saisie de plusieurs plaintes dénonçant les modalités de refus des cookies des sites internet google.fr et youtube.com mis à la disposition des utilisateurs situés en France.
Après un contrôle en ligne, la CNIL a constaté que les sociétés Google LLC et Google Ireland Ltd, responsables conjoints de traitement, ne permettent pas aux utilisateurs de google.fr et youtube.com de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter.
La CNIL a sanctionné Google LLC d’une amende de 90 millions d’euros et Google Ireland Ltd d’une amende de 60 millions d’euros.
Par une délibération du 31 décembre 2021, la CNIL a caractérisé un manquement similaire par Facebook Ireland Ltd, et prononcé une sanction de 60 millions d’euros à son encontre.
La CNIL sanctionne Free Mobile d’une amende de 300 000 euros pour manquement aux droits des personnes et à la sécurité des données des utilisateurs
Par délibération du 28 décembre 2021, la CNIL a caractérisé des manquements aux droits des personnes concernées, à l’obligation de protéger les données dès la conception ainsi qu’à la sécurité des données par l’opérateur de téléphonie mobile Free Mobile.
La CNIL a été saisie de plusieurs plaintes faisant notamment état des difficultés rencontrées par des personnes dans l’exercice de leurs droits d’accès ou d’opposition à recevoir des messages de prospection commerciale.
Après un contrôle sur place et un contrôle sur pièces, la CNIL a constaté plusieurs manquements au RGPD par Free Mobile.
S’agissant des manquements aux droits des personnes (droit d’accès et droit d’opposition), la CNIL a constaté que Free Mobile n’a pas donné suite aux demandes formulées par les plaignants dans les délais, et qu’elle n’a pas pris en compte les demandes des plaignants demandant à ne plus recevoir de message de prospection commerciale.
S’agissant des manquements à la sécurité, il est constaté un manquement à l’obligation de protéger les données dès la conception car Free Mobile a continué d’envoyer des factures à des utilisateurs ayant résilié leur abonnement. Il est également constaté un défaut de sécurité en raison de la communication par Free Mobile aux utilisateurs d’un mot de passe en clair, ni temporaire, ni à usage unique et dont le renouvellement n’était pas imposé.
La CNIL sanctionne Slimpay d’une amende de 180 000 euros pour protection insuffisante des données personnelles et manquement à l’obligation d’information d’une violation de données
Par délibération du 28 décembre 2021, la CNIL a caractérisé plusieurs manquements relatifs à la sécurité des données par Slimpay, établissement de paiement agréé qui propose notamment des solutions de paiements récurrents.
La CNIL a constaté un manquement à l’obligation d’encadrer, par un acte juridique formalisé, les traitements effectués par un sous-traitant, en raison de l’absence de tout ou partie des mentions obligatoires de l’article 28 du RGPD au sein des contrats conclus entre Slimpay et ses sous-traitants.
La CNIL a également constaté plusieurs manquements à la sécurité des données des utilisateurs, ainsi qu’un manquement à l’obligation d’information d’une violation de données personnelles aux personnes concernées. Cette violation avait été notifiée à la CNIL.
2. Documentation de la CNIL
La CNIL publie un guide du délégué à la protection des données
La CNIL a publié en novembre 2021 un guide pratique rassemblant les principales connaissances et bonnes pratiques destinées à aider les organismes et accompagner les DPO.
Ce guide aborde quatre thématiques (le rôle du DPO, la désignation du DPO, l’exercice de la fonction du DPO, l’accompagnement du DPO par la CNIL) illustrées par des cas concrets, des réponses aux questions les plus courantes, et fournit un modèle de lettre de mission.
La CNIL publie un guide pratique pour les associations
La CNIL a publié en novembre 2021 un nouveau guide de sensibilisation au RGPD pour les associations, visant à accompagner les associations dans leur mise en conformité.
Ce guide explique les grands principes à respecter et propose un plan d’action adapté, en donnant des exemples pratiques selon les différents secteurs (caritatif, sportif, social, etc.).
La CNIL adopte un référentiel sur les entrepôts de données de santé
La CNIL a adopté en novembre 2021 un référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en œuvre à des fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé, suite à une consultation publique.
Les entrepôts de données de santé sont des bases de données qui ont vocation à être utilisées notamment à des fins de recherches, d’études ou d’évaluation dans le domaine de la santé. Les traitements associés à ces entrepôts peuvent être soumis à l’autorisation préalable de la CNIL.
Ce référentiel s’adresse aux responsables de traitements qui souhaitent, dans le cadre de leurs missions d’intérêt public, réunir des données en vue de leur réutilisation, pour les finalités mentionnées ci-dessus.
Ce référentiel permet aux organismes souhaitant mettre en œuvre un entrepôt de données conforme au référentiel de ne pas solliciter d’autorisation préalable auprès de la CNIL, sous réserve de se conformer à ce texte.
La CNIL publie un nouveau guide RGPD pour les développeurs
La CNIL a publié en décembre 2021 une nouvelle version de son guide destiné à accompagner les développeurs dans les développements projet web ou applicatif.
Ce guide contient 18 fiches thématiques proposant des conseils et bonnes pratiques à tout stade du développement. A titre d’exemple, le guide accompagne les développeurs dans l’identification et la minimisation des données personnelles, la sécurisation des sites/applications/serveurs, la prise en compte des bases légales dans l’implémentation technique, la gestion de l’exercice des droits des personnes et des durées de conservation, l’analyse traceurs sur les sites/applications, et la prévention des attaques informatiques.
Ce guide open source est disponible sur GitHub. Il est publié sous licence GPLv3 et sous licence ouverte 2.0, permettant à chacun de contribuer à son enrichissement.
3. Actualités légales et jurisprudentielles – France
La Cour de cassation précise les conditions d’utilisation d’images de vidéosurveillance à titre de preuve obtenues de manière illicite par un employeur
Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis en balance la protection des données personnelles et le droit à la preuve dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Une salariée avait été licenciée pour faute grave sur la base de faits constatés par des images de vidéosurveillance. L’employeur avait notifié la mise en place des caméras postérieurement à leur mise en place et précisait l’utilisation de système de vidéosurveillance à des fins de sécurité uniquement.
La Cour de cassation précise que l’illicéité d’un moyen de preuve « n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats ».
Elle indique que le juge doit « apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Intégration dans le Code de la consommation de notions relatives à la protection des données personnelles
L’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 modifie le Code de la consommation afin d’y intégrer des notions relatives à la protection des données personnelles en ce qui concerne la fourniture de contenu numérique sans support matériel ou un service numérique (articles L. 221-I, III et L. 221‑26-1, I et II).
Les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur le 28 mai 2022.
Ceci poursuit l’intégration au sein du Code de la consommation de la notion de données personnelles et des obligations correspondantes des professionnels, figurant notamment aux articles préliminaire, L.111-1 et L.112-4-1 (obligation d’information) et L. 217-6 (défaut de conformité), applicables à compter du 1er janvier 2022.
L’Assemblée nationale adopte en première lecture la proposition de loi pour la mise en place d’un « cyberscore »
Le 26 novembre 2021, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi « pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinées au grand public », adoptée par le Sénat en octobre 2020.
Le texte propose l’insertion d’un nouvel article L.111-7-3 au sein du Code de la consommation, afin d’imposer de nouvelles obligations en matière de cybersécurité aux grandes plateformes numériques, aux messageries et aux sites de visioconférences, dont l’activité dépasserait un ou plusieurs seuils définis par décret.
Ces opérateurs devraient, après avoir fait réaliser un audit de sécurité par des prestataires qualifiés par l’ANSSI, informer les internautes des résultats de l’audit portant sur la « sécurisation et la localisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et sur leur propre sécurisation ».
Le résultat de l’audit serait « présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et [serait] accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel », à l’image du Nutriscore pour les produits alimentaires.
4. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe
Projet de lignes directrices du CEPD sur les transferts internationaux de données
Le 18 novembre 2021, le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) a publié un projet de lignes directrices sur l’articulation entre l’article 3 du RGPD (champ d’application territorial) et le chapitre V du RGPD (transferts de données personnelles hors UE), soumis à consultation jusqu’à fin janvier 2022.
Ce texte vise à aider les professionnels à identifier si un traitement constitue un transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale et, par conséquent, s’ils sont tenus d’encadrer ce transfert conformément au chapitre V du RGPD.
Le CEPD a identifié trois critères cumulatifs permettant de qualifier un tel transfert. Le responsable de traitement ou le sous-traitant doit être soumis au RGPD selon l’article 3. Ce responsable du traitement ou ce sous-traitant (« exportateur ») doit divulguer par transmission ou rendre les données accessibles par tout autre moyen à un autre responsable du traitement ou un sous-traitant (« importateur »). L’importateur doit se trouver dans un pays tiers ou être une organisation internationale, indépendamment du fait que cet importateur soit soumis au RGPD pour ce traitement.
Assimilation par la CJUE d’une publicité affichée dans une boîte de réception électronique à de la prospection commerciale
Par un arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que l’affichage, dans la boîte de réception électronique, de messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique, s’apparente à une « utilisation […] de courrier électronique à des fins de prospection directe » au sens de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE telle que modifiée par la directive 2009/136/CE).
La CJUE considère que de telles communications constituent des « sollicitations répétées et non souhaitées » en l’absence de consentement donné par l’utilisateur préalablement à cet affichage.
Article rédigé par : Alix CAPELY, Pierre-Emmanuel MEYNARD et Camille PECNARD
Système d’intelligence artificielle DABUS
Le système d’intelligence artificielle appelé DABUS ne peut pas être désigné comme inventeur selon les décisions J 8/20 et J 9/20 de la Chambre de recours juridique de l’OEB.
Cadre juridique
L’article 81 CBE stipule que la demande de brevet européen doit désigner l’inventeur.
L’article 60 définit que le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
La règle 19(1) CBE prévoit que la requête en délivrance d’un brevet européen doit contenir la désignation de l’inventeur.
Affaire en cause
Un demandeur a déposé deux demandes de brevet dans lesquelles un système d’intelligence artificielle appelé DABUS était désigné comme inventeur dans les formulaires de demande. Des demandes correspondantes ont été déposées dans d’autres juridictions.
Le demandeur a soutenu que les inventions avaient été créées de manière autonome par DABUS.
La section de dépôt de l’OEB a rejeté les deux demandes, estimant que seul un être humain pouvait être considéré comme inventeur au sens de la CBE et qu’une machine ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 81 et de la règle 19(1) CBE. Elle a également considéré qu’une machine ne pouvait transférer aucun droit au demandeur, de sorte que l’argument selon lequel le propriétaire de la machine serait l’ayant droit ne répondait pas aux exigences de l’article 81 CBE combiné à l’article 60(1) CBE.
Dans le cadre du recours, le demandeur a déposé, à titre subsidiaire, une description modifiée fournissant des informations sur la conception de l’invention par le système d’IA DABUS, ainsi qu’un formulaire de désignation d’inventeur modifié précisant qu’aucune personne n’était identifiée comme inventeur, accompagné d’une annexe indiquant qu’il n’existait aucun autre emplacement approprié pour indiquer que le demandeur tirait son droit au brevet européen du fait d’être le propriétaire et créateur de DABUS.
Décisions de la Chambre de recours juridique de l’OEB
La Chambre de recours juridique a confirmé la décision de la section de dépôt de l’OEB.
La désignation de l’inventeur est une exigence formelle que doit remplir une demande de brevet selon l’article 81 CBE. L’examen de cette exigence formelle intervient donc avant et indépendamment de l’examen au fond.
L’inventeur doit être une personne dotée de la capacité juridique. La Chambre a également rejeté la requête subsidiaire selon laquelle aucune personne n’était identifiée comme inventeur mais une personne physique était seulement indiquée comme ayant « le droit au brevet européen en tant que propriétaire et créateur » du système d’intelligence artificielle DABUS, jugeant qu’une déclaration relative à l’origine du droit au brevet européen au titre de l’article 81 doit être conforme à l’article 60(1) CBE. Elle a en outre confirmé la compétence de l’OEB pour apprécier cette question.
Ainsi, selon les dispositions actuelles, l’inventeur doit être une personne juridiquement capable.
Lutte contre la contrefaçon sur Internet : Quels outils dans l’arsenal législatif & quelles zones d’ombres ?
Selon une enquête de l’Union des fabricants – Unifab, ce sont près de 27 millions d’annonces illicites qui ont été retirées des sites internet en 2021. La contrefaçon sur Internet touche désormais tous les secteurs d’activités sans exception et implique de nombreux acteurs (prestataires techniques et de services web) avec des responsabilités en cascade. Avec l’explosion du e-commerce, le risque et la pression sur les entreprises augmentent.
Dans ce contexte, la proposition de loi « visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon » adoptée en première lecture à l’unanimité par l’Assemblée Nationale le 25 novembre dernier, envoie un signal intéressant : l’étendue du fléau est prise en compte par les députés.
Pour autant, l’arsenal juridique français sur ce sujet est déjà riche. Que prévoient les dispositifs existants pour prévenir et lutter contre la contrefaçon ? Quels sont les apports de cette proposition ? Quelles mesures sont utiles et quels points restent à éclaircir pour une lutte contre la contrefaçon en ligne plus efficace en pratique ?
Les apports de la proposition de loi
Le texte adopté en première lecture fin novembre propose de nouvelles mesures de différentes natures.
Il vient ajouter au code des douanes un chapitre V visant à prévenir les infractions commises par l’intermédiaire d’internet. Les nouvelles dispositions viendraient, entre autres, contraindre les opérateurs de plateforme en ligne ainsi que les hébergeurs à figurer sur une liste rendue publique si les agents de douane constatent qu’il existe un risque que les infractions relatives à différents délits douaniers (faits de contrebande, opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’un délit douanier…) sont susceptibles d’être commises par l’intermédiaire de leurs services.
Si malgré cette procédure préventive l’infraction se réalise, les agents des douanes pourraient demander au tribunal judiciaire la suspension ou la suppression d’un ou plusieurs noms de domaine / comptes de réseaux sociaux.
S’agissant du droit des marques, une série de mesures vient modifier le Code de la propriété intellectuelle (CPI) : mise en place d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros en cas d’achat marchandises contrefaites 1 et possibilité pour le titulaire d’une marque de demander la suppression des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès.2
1 Modifiant ’article L 716-10 du CPI
2 Article L 713-7 du CPI
Que prévoit le droit en matière de responsabilité des différents acteurs ?
Depuis 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) organise les règles de responsabilité applicables sur Internet à l’égard des différents acteurs et prestataires techniques :
– L’éditeur, en raison de son rôle actif, a une obligation de surveillance du site et est responsable de tout contenu contrefaisant qui y serait diffusé.
– le fournisseur d’accès à internet (FAI) bénéficie, lui, d’une irresponsabilité totale, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, du fait de son rôle purement technique qui se réduit à « offrir un accès à des services de communication au public en ligne »3
– l’hébergeur, qui assure le stockage de contenus, est soumis à une responsabilité conditionnée non pas à son activité mais à son inaction. La LCEN impose ainsi à l’hébergeur de retirer promptement tout contenu illicite porté à sa connaissance par le biais d’une notification au risque d’engager sa responsabilité4.
D’une manière générale, les prestataires techniques bénéficient d’un régime qui leur est favorable. La LCEN les dispense de toute obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent ou transmettent et ils ne sont pas soumis à une obligation de recherche des faits à l’origine des activités illicites.
En pratique, se pose alors souvent la question de savoir si tel ou tel acteur doit être qualifié d’éditeur ou d’hébergeur, les distinctions pouvant parfois être fines…
3 article 6, I, 1 LCEN
4 article 6, I, 2 et 3 LCEN
Quels sont les mécanismes d’action existants pour faire face à la contrefaçon en ligne ?
Le droit a conçu des moyens de lutte face au flux de contenus illicites sur Internet.
La LCEN a implémenté un blocage judiciaire qui prend la forme d’un « référé-internet » : l’autorité judiciaire peut prescrire à l’hébergeur ou au FAI toute mesure pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu en ligne.
Les prestataires techniques sont soumis à une obligation de coopération : FAI et hébergeurs doivent transmettre à l’autorité judiciaire les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu au sein de leurs services5. Le juge peut les contraindre à effectuer une surveillance de façon ciblée et temporaire.
Enfin, toute personne ou entreprise peut solliciter la procédure extrajudiciaire UDRP6 pour combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine. Cette voie a pour objectif, pour le titulaire de la marque, d’obtenir un transfert du nom de domaine litigieux à son profit. En parallèle, en matière de droit d’auteur, l’ordonnance du 12 mai 20217 retient la responsabilité des fournisseurs de services comme contrefacteurs du fait de la présence d’une oeuvre non autorisée sur leurs services lorsqu’ils ne peuvent prouver avoir accompli leurs meilleurs efforts et qu’ils ne se sont pas montrés suffisamment diligents.
5 L’article 6, II de la LCEN
6 Uniform Domain-Name Dispute Resolution
7 Ordonnance qui a transposé une partie des articles de la directive droit d’auteur (UE) 2019/790 du 17 avril 2019
Et des zones de flous
On s’interroge toutefois sur l’étendue de la contrefaçon : est-ce le nom de domaine / le compte en lui-même qui doit porter atteinte à la marque ? ou alors retient-on que la contrefaçon de marque est qualifiée au regard du contenu du site associé au nom de domaine / de la page associée au compte du réseau social ?
Le texte ne précise pas non plus si la demande peut être faite en référé et ce qu’il faut entendre par « toute mesure propre à en empêcher l’accès » pour justifier la demande de suppression auprès du juge.
Enfin et surtout, même s’il est utile de renforcer la protection des titulaires de marques particulièrement sur Internet, on peut s’interroger sur la réelle utilité ou efficacité d’un tel dispositif en pratique, car la possibilité de demander la suppression d’un site, d’une page d’un réseau social ou d’un nom de domaine contrefaisant existe déjà, les textes actuels suffisent à cet égard.
Le texte n’envisage pas non plus une des questions centrales de la contrefaçon en ligne : le caractère international d’Internet. Il ne répond pas à la question de savoir comment le titulaire de droit peut interdire ou supprimer de manière certaine un site / une page de réseau social lorsque ledit site est édité et hébergé hors Union Européenne.
Il serait intéressant que la proposition ou son décret d’application nous éclairent sur ces sujets.
La responsabilité du FAI et de l’hébergeur va aussi pouvoir être recherchée lorsque l’action ne sera pas exercée contre le propriétaire du nom de domaine ou du compte (alinéa 28). La rédaction du texte laisse ici planer un doute sur les modalités d’engagement de la responsabilité des prestataires techniques. Leur responsabilité est-elle subsidiaire dans la mesure où le propriétaire du nom de domaine ou du compte n’est pas identifiable ? C’est ce que prévoyait la proposition de loi dans sa rédaction initiale. L’ensemble des protagonistes semble désormais être sur le même plan.
Alors même que la LCEN permet au juge de demander la communication des données de nature à permettre l’identification d’un potentiel contrefacteur qui utiliserait les services des prestataires techniques, ce filtre semble occulté en permettant au titulaire d’une marque d’agir directement contre ceux-ci.
La disposition donne l’impression de faire fi du régime instauré par la LCEN en retenant la responsabilité du FAI qui pourtant bénéficie d’un principe d’irresponsabilité et celle de l’hébergeur en l’absence de toute notification préalable portée à sa connaissance.
Les prochains débats seront sûrement intéressants pour voir si le dispositif est complété.
8 « L’action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux ou contre une des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique »
Droit de la PI et inventions de non salariés
Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs, ni salariés, ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.
Une ordonnance publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 modifie les règles sur la titularité des droits sur les travaux réalisés par le personnel accueilli par des entités de recherche, publiques ou privées.
L’ordonnance a des conséquences pratiques importantes pour les services de propriété intellectuelle des entreprises. Elle s’intéresse à deux domaines du droit de la propriété intellectuelle : les logiciels et les inventions.
1/ Le contexte légal de l’ordonnance
Jusqu’à présent, les droits sur les logiciels et les inventions n’étaient soumis à un régime particulier que s’ils étaient réalisés par des salariés ou des agents publics (articles L.113-9 et L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle). Cela devait s’entendre de manière stricte. Toute autre personne membre d’une entreprise, mais non salarié (stagiaire, intérimaire, ou autre) était considérée comme un tiers à l’entité l’accueillant[1].
Cela posait des difficultés pratiques pour les entités accueillant des stagiaires ou ayant recours à des intérimaires, ou d’autres membres du personnel ne bénéficiant pas d’un contrat de travail.
L’Ordonnance vise à étendre les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et les brevets à toute personne physique « accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ». Cela peut s’entendre de manière large. Le Rapport au Président de la République fait état des « stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d’une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche. »
[1] Cour de cassation, 25 avril 2006, n°04-19.482, CNRS c. M. Puech
2/ Les droits sur les logiciels
Les droits patrimoniaux d’auteurs sur les logiciels réalisés par ces personnes sont régis par un nouvel article L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que ces droits sont immédiatement dévolus à la structure d’accueil.
Pour s’adapter à la spécificité des contrats de stage, notamment, cette dévolution de droits n’intervient qu’à la condition que la personne physique perçoive une « contrepartie » et soit placée sous l’autorité d’un responsable de la structure d’accueil.
3/ Les droits sur les inventions
Les droits sur les inventions sont régis par un nouvel article L.611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il reprend la classification fixée à l’article L.611-7 du même Code pour les inventions de salariés, entre les inventions de missions, les inventions hors missions attribuables et les inventions hors missions non attribuables, selon des critères identiques.
La personne physique accueillie ne bénéficie pas d’une rémunération supplémentaire, mais d’une « contrepartie financière ».
Le texte prévoit aussi que l’attribution d’une invention hors mission attribuable réalisée par une personne accueillie se fera « pendant la durée de son accueil ». Il conviendra alors pour les entités de recherche de veiller à réagir à temps, si elles souhaitent profiter de cette prérogative.
L’ordonnance renvoie aussi à un décret, qui prévoira les modalités pratiques de déclaration d’invention, comme c’est le cas pour l’article L.611-7 (articles R.611-1 et suivants du Code).
L’ordonnance élargit enfin le recours à la CNIS pour toute invention réalisée par une personne accueillie par une personne morale réalisant de la recherche.
4/ Conséquences
L’ordonnance vise donc à simplifier la gestion des travaux de recherche réalisés dans les entreprises, en étendant les mécanismes de dévolution automatique de droits de propriété intellectuelle à leur profit.
Elle repose néanmoins sur certaines définitions ambigües (en particulier celle de « personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche »), que la jurisprudence pourra venir clarifier à l’avenir.
Si l’objectif du législateur est clair, la mise en place de ce mécanisme pourra poser quelques questions d’ordre pratique. Il faudra veiller, en particulier, à la rédaction des clauses prévues dans les conventions d’accueil et à réagir suffisamment tôt pour l’attribution d’inventions hors mission.
Marques pharmaceutiques et demandes en déchéance auprès de l’INPI (loi Pacte)
I. Appréciation de l’usage au regard des produits
Dans le cadre de notre précédente revue de jurisprudence sur les marques pharmaceutiques nous avions examiné les différences de pratique entre les instances de l’Union Européenne et les tribunaux français pour identifier les produits dont la marque faisait l’objet d’un usage sérieux lors de l’examen d’une demande en déchéance pour non usage.
Il avait ainsi été constaté que l’EUIPO procède à une requalification du libellé de produits en le restreignant aux produits spécifiques qu’il considère comme faisant l’objet d’un usage, alors que les tribunaux français identifient dans le libellé les produits correspondants aux produits dont il est fait usage, sans modifier la portée du libellé.
Il convient donc d’examiner à présent la position qu’adopte l’INPI dans le cadre de la nouvelle procédure en déchéance prévue par les articles L.716-1 et suivants le Code de la Propriété Intellectuelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi Pacte.
La décision CD20-0005 du 3 juin 2021 relative à une demande en déchéance engagée le 2 avril 2020 contre la marque GELOX N°1533727 présente un double intérêt dès lors que :
(i) L’INPI doit se prononcer sur la qualification d’une sous-catégorie de produits pharmaceutiques
(ii) Et que, pour ce faire, il se base sur :
a. les critères dégagés par la jurisprudence de la CJUE récemment rappelé dans les décisions des 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, Ferrari SpA / DU et 16 juillet 2020, C‑714/18 P, ACT / EUIPO) et
b. une appréciation concrète des produits en tenant compte des définitions des produits pharmaceutiques et médicaments résultant de la jurisprudence et du code de la santé publique.
L’INPI décide ainsi que l’usage de la marque pour un médicament prescrit contre les douleurs, brûlures ou aigreurs d’estomac ou de l’œsophage constitue un usage sérieux de la marque pour la sous-catégorie des « médicaments à usage humain » dans la mesure où les médicaments sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des produits pharmaceutiques, qui se distinguent par leur destination humaine ou animale.
L’appréciation de l’INPI diffère donc de celle de l’EUIPO en ce qu’elle identifie une sous-catégorie autonome d’un produit identifié dans le libellé, et qu’elle ne reformule donc pas le libellé.
L’INPI écarte ainsi (i) la requête du demandeur à l’action consistant à réduire le libellé de cette marque aux « produits pharmaceutiques pour combattre les brûlures d’estomac qui seraient selon lui une sous-catégorie autonome des « produits pharmaceutiques », et (ii) l’argument du titulaire selon lequel la marque devrait être reconnue valablement utilisée pour la sous-catégorie des « médicaments à usage humain » au motif que la définition des sous-catégories des « produits pharmaceutiques », devrait être fonction de leur usage humain ou vétérinaire.
L’analyse de l’INPI se fonde sur les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE et rappelle en particulier :
- qu’il faut apprécier de manière concrète si les produits dont il est fait usage constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits couverts par la marque de manière à mettre en relation les premiers avec les seconds, (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46)
- que le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constituée du critère de la finalité et de la destination des produits en cause, (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, point 41 ),
- que, « lorsque les produits visés par une marque revêtent …/…plusieurs finalités, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 47).
Concrètement, l’INPI rappelle que :
- les « produits pharmaceutiques » s’entendent des médicaments et compositions ayant un but thérapeutique, curatif ou préventif (CA Paris, 25 septembre 2020, RG 19/16330),
- selon l’article L5111-1 du Code de la santé publique, « on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonction physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique »,
puis l’INPI considère qu’il ressort
- de la définition des produits pharmaceutique précité que les produits pharmaceutiques ont la même finalité, à savoir traiter les affections de l’organisme, et que prendre en considération isolément chaque indication thérapeutique spécifique pour déterminer une sous-catégorie autonome, pourrait conduite à limiter excessivement les droits du titulaire de la marque,
- et de cette définition ainsi que de la définition des médicaments, que les médicaments sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des produits pharmaceutiques, qui se distinguent par leur destination humaine ou animale,
- des preuves d’usage que la marque est utilisée pour des « médicaments à usage humain ».
Dans une décision précédente, en date du 15 février 2021 (DC20-0015) relative à une demande en déchéance engagée le 29 avril 2020 contre une marque française ODEX N°11/3860413 au nom de SC IOHNSON PROFESSIONNEL SA, l’INPI avait pu identifier les produits d’usage au sein du libellé de la marque attaquée, considérant que l’usage de cette marque pour (i) des mousses lavantes pour les mains et le corps, gels douches corps et cheveux, crèmes lavantes nacrées pour mains et corps, crèmes lavantes d’atelier pour les mains sans solvants et (ii) pour des mousses et lotions lavantes bactéricides pour les mains démontrent un usage sérieux respectivement pour (i) les « préparations pour nettoyer et dégraisser; savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux » et (ii) pour les « produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants » couverts par l’enregistrement de marque, et non pas pour les autres produits dont notamment les produits pharmaceutiques.
II. Appréciation de l’usage au regard des signes
a. Usage du signe sous une forme modifiée
Selon l’article L714-5, 3° du code de la propriété intellectuelle, constitue un usage valable de la marque « L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Dans la décision en date du 15 février 2021 (DC20-0015) relative à une demande en déchéance engagée le 29 avril 2020 contre une marque française verbale ODEX N°11/3860413 au nom de SC JOHNSON PROFESSIONNEL SA, l’INPI a considéré que la marque avec une stylisation et l’ajout d’un élément figuratif telle que représentée ci-dessous ne modifient pas l’impression générale produite par celle-ci et valide donc cet usage.
La position de l’INPI est en phase avec la jurisprudence de l’Union Européenne dès lors que le terme distinctif constitutif de la marque est repris à l’identique et que le graphisme ajouté ne possède qu’un faible pouvoir distinctif et n’est donc pas de nature à modifier l’impression d’ensemble produite par la marque.
b. Usage de la marque en combinaison avec une autre marque
Dans la décision du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à une demande en déchéance déposée le 7 avril 2020 contre une marque ASSAINOL N° 96614247 l’INPI a considéré que l’usage de cette marque avec l’ajout d’un élément figuratif sous la forme complexe ne modifie pas l’impression générale produite par la marque et n’altère donc pas son caractère distinctif.
L’INPI a également considéré que la marque ASSAINOL était bien utilisée à titre de marque et non pas à titre de référence d’un panel de produits vendus sous la marque ombrelle DEO, la marque ASSAINOL ayant vocation à distinguer plus spécifiquement certains produits de la gamme, et que la seule présence du symbole ® du mot « Registered »accompagnant le signe DEO, sans valeur juridique en France, n’est pas de nature à démontrer que les produits sont commercialisés sous la marque DEO et non sous le signe ASSAINOL.
III. Lieu de l’usage
Aux termes de l’article L.714-5, 4°) du Code de la propriété intellectuelle est assimilé à un usage de marque « L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. »
Dans la décision précitée du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à la demande en déchéance contre la marque ASSAINOL N° 96614247 l’INPI considère que les pièces présentées par le titulaire (factures, brochures, bon à tirer daté de 2015 d’une étiquette destinée à être apposée sur les flacons 5L sur laquelle figure la marque ainsi que la mention « Formulé et produit en France ») démontrent que les produits sur lesquels est apposée la marque ont été vendus depuis la France à destination de la Russie.
IV. Point de départ de la période suspecte
Au titre de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée ».
Dans la décision précitée du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à la demande en déchéance déposée le 7 avril 2020 contre lamarque ASSAINOL N° 96614247 , le demandeur en déchéance invoque avoir adressé au titulaire le 3 décembre 2019 une lettre le mettant en demeure de justifier l’usage sérieux de la marque si bien que les pièces produites datées postérieurement à ce courrier ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier l’usage de la marque car relevant de la période suspecte issue de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
L’INPI refuse de retenir cette date et au contraire considère que le point de départ de la période suspecte à prendre en considération est le 7 janvier 2020, soit trois mois avant la demande en déchéance formée le 7 avril 2020, dès lors que l’article précité vise un « délai de trois mois précédant la demande en déchéance ».
Or, comme le titulaire de la marque avait déposé des preuves de l’usage de sa marque pour la période quinquennale précédant la période suspecte, l’INPI aurait dû écarter cet argument.
En outre, si la période quinquennale à prendre en compte doit en effet exclure la période suspecte de trois mois précédant le dépôt de la demande en déchéance, il convient de considérer que le point de départ de la période suspecte est la date à laquelle le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée contrairement au point de vue de l’INPI dans la décision précitée.
V. Date d’effet de la déchéance
L’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle stipule que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu »
Par application de cette disposition, et contrairement aux prétentions des demandeurs réclamant que la déchéance prenne effet à compter de la date de la publication de l’enregistrement de la marque attaquée, l’INPI décide que la déchéance des droits prend effet à compter de la date de la demande en déchéance (décision du 15 mars 2021 (DC20-0009) – marque ASSAINOL N° 96614247).
VI. Répartition des frais
L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
Dans la décision du 28 juillet 2021 (DC 20-0047) relative à une demande en déchéance formée contre la partie française de la marque internationale n°756236 P’tit Chambourcy, l’INPI a déclaré que la demande en déchéance est devenue sans objet suite à l’annulation pour déchéance de la marque dans le cadre d’une procédure parallèle dont le demandeur à l’action (ainsi que l’INPI) ne pouvait pas avoir connaissance
Par conséquent, la demande en déchéance est clôturée pour défaut d’objet et non pour irrecevabilité, et il n’a donc pas été fait droit à la demande en déchéance, si bien qu’aucune des deux parties ne peut être déclarée gagnante et que leursdemandes de répartitions des frais ont été rejetées.
Dans la décision CD20-0005 du 3 juin 2021 – marque GELOX N°1533727 on peut relever que suite à la renonciation partielle de la marque attaquée GELOX le demandeur à l’action en déchéance n’a pas justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond pour ces produits si bien que l’INPI ne s’est pas prononcé sur le remboursement des frais suite à cette renonciation.
Par conséquent, suite à une renonciation partielle, il est recommandé de faire valoir un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond afin de pouvoir obtenir le remboursement des frais.
VII. Délais pour rendre une décision
On relève que l’INPI rend des décisions dans un délai compris entre 5 à 6 mois lorsque le titulaire de la marque attaquée ne dépose pas de preuves d’usage (décisions des 05 juillet 2021 (DC21-0027) et du 19 mars 2021 (DC 20-0097) suite à des demandes en déchéance respectivement du 8 février 2021 et du 30 septembre 2021), et 10 à 15 mois en cas de dépôt de preuves et d’échanges d’arguments entre les parties
Nous recommandons donc de recourir aux demandes en déchéance auprès de l’INPI à l’encontre de marques françaises ou de désignations françaises de marques internationale qui constituent la base d’une réclamation précontentieuse ou si de telles marques ont été révélées dans le cadre d’une recherche d’antériorités.
L’Office européen des brevets classé premier pour la qualité des brevets et des services
L’Intellectual Asset Management (IAM) a une nouvelle fois lancé une enquête comparative et invité les utilisateurs à voter parmi les cinq plus grands offices de brevets au monde pour la qualité de leurs brevets et de leurs services. Une fois encore, l’OEB arrive en tête cette année dans les deux catégories, comme c’est le cas depuis le lancement de cette enquête annuelle par IAM en 2010.
Les résultats de l’enquête montrent que 26 % des participants qualifient les brevets de l’OEB d’« excellents ». Cela constitue une augmentation par rapport aux 23 % de l’année précédente et place l’OEB largement devant les autres offices IP5. Les répondants confirment également que l’OEB maintient son haut niveau de qualité. Au total, plus de 87 % des participants décrivent le service de l’OEB comme « bon », « très bon » ou « excellent », ce qui place également l’OEB très largement en tête des offices IP5.
De plus, l’OEB est le seul office des IP5 pour lequel la qualité des brevets constitue la principale motivation de dépôt pour les répondants. Dans les autres juridictions, l’importance commerciale du marché local est le facteur déterminant pour déposer une demande de brevet.
L’enquête de cette année a été réalisée en septembre et octobre 2021 auprès de plusieurs centaines de professionnels de la propriété intellectuelle. Les participants ont été interrogés au sujet de l’OEB, du Japan Patent Office (JPO), du Korean Intellectual Property Office (KIPO), du US Patent and Trademark Office (USPTO) et de la China National Intellectual Property Administration (CNIPA).
Volonté politique en Allemagne pour que l’Accord JUB soit soumis à un nouveau vote dès que possible
Alors que la Cour constitutionnelle fédérale a jugé, le 20 mars 2020, que la loi d’approbation de l’Accord JUB n’était pas conforme à la Constitution et était donc nulle, un communiqué de presse du 26 mars 2020 du ministre fédéral de la Justice a clarifié la volonté politique actuelle en Allemagne.
JUB : cadre juridique de l’ordonnance de préservation de preuves (Saisie)
Bien que l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (« Accord JUB ») prévoie une liste large et non limitative de moyens de fournir et d’obtenir des preuves (article 59), il semble accorder un rôle clé à l’ordonnance de préservation de preuves prévue à l’article 60, visant à accorder des mesures provisoires rapides et efficaces pour préserver des preuves pertinentes d’une contrefaçon alléguée.
Les règles de procédure de la Juridiction unifiée du brevet n° 192 à 198 (« Règles de procédure ») donnent des précisions supplémentaires concernant les conditions et la mise en œuvre de ces mesures de préservation de preuves.
JUB – Mise à jour du calendrier
Le Comité préparatoire de la JUB a publié hier une mise à jour (https://www.unified-patent-court.org/news/upc-timetable-update-june-2017) confirmant les retards attendus pour l’entrée en vigueur de l’Accord JUB.
Le Comité confirme que l’entrée en vigueur de la JUB n’aura pas lieu en décembre 2017 comme prévu, en raison de retards dans plusieurs pays, en particulier en Angleterre, concernant la finalisation des procédures nationales de ratification de l’Accord JUB et de participation au Protocole sur l’application provisoire.
Nous surveillons la publication du nouveau calendrier que le Comité doit diffuser.
Représentation : Comment un mandataire en brevets européen pourra‑t‑il obtenir un droit indépendant pour représenter des clients devant la JUB ?
Selon l’article 48(2) de l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (Accord JUB), les mandataires agréés près l’OEB (European Patent Attorneys – EPAs) habilités à agir comme représentants professionnels devant l’Office européen des brevets conformément à l’article 134 CBE peuvent représenter les parties devant la JUB, à condition qu’ils disposent de qualifications appropriées telles que le Certificat européen de contentieux des brevets (EPLC).
Le texte de cet article suggère que les EPAs peuvent prouver leurs qualifications par différents moyens, l’EPLC n’étant que l’un d’eux.